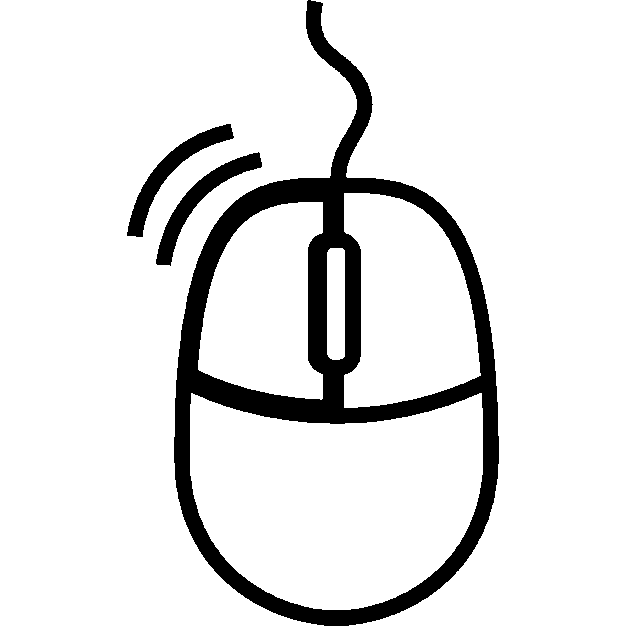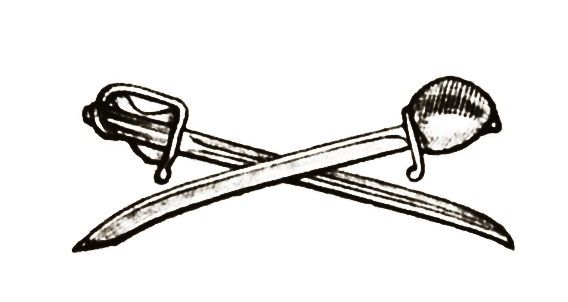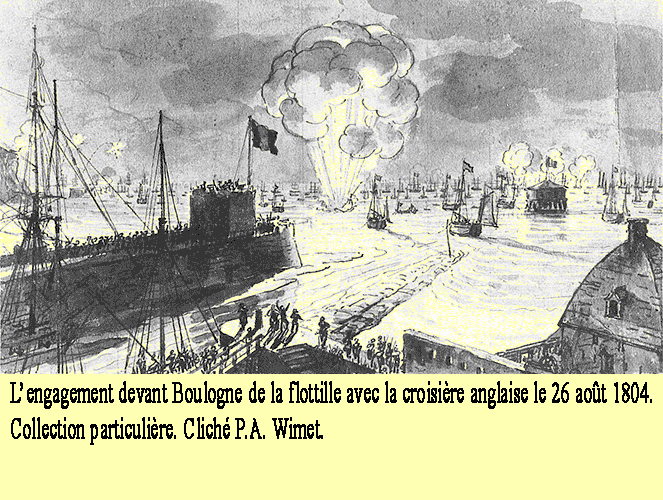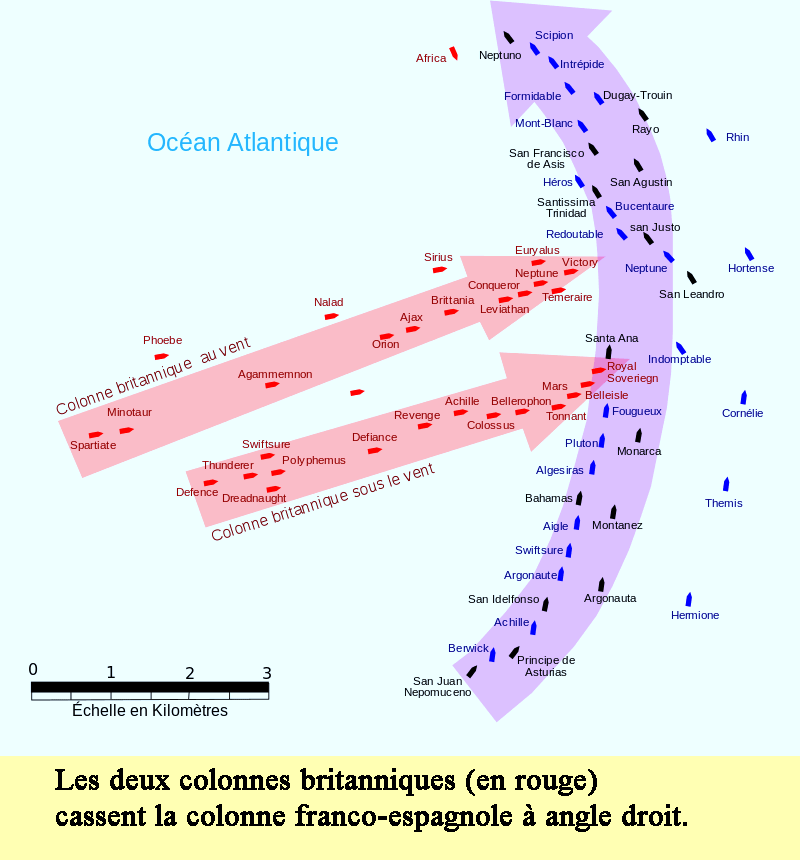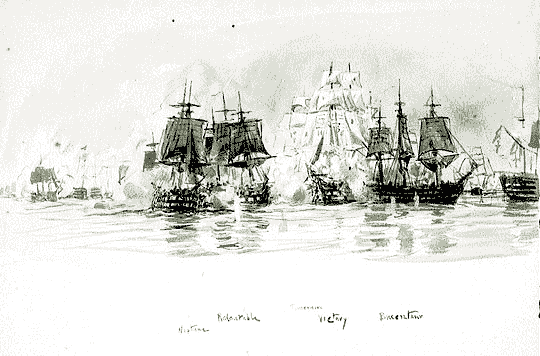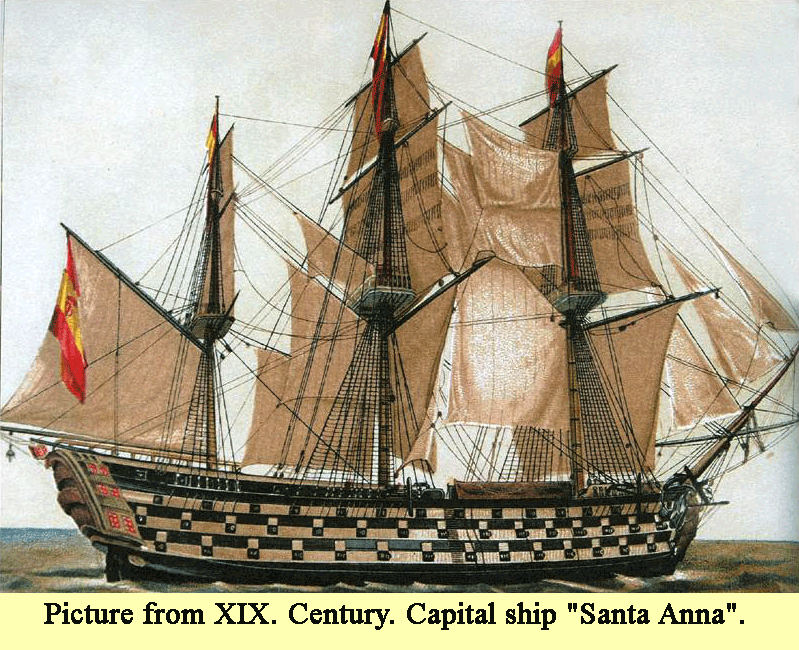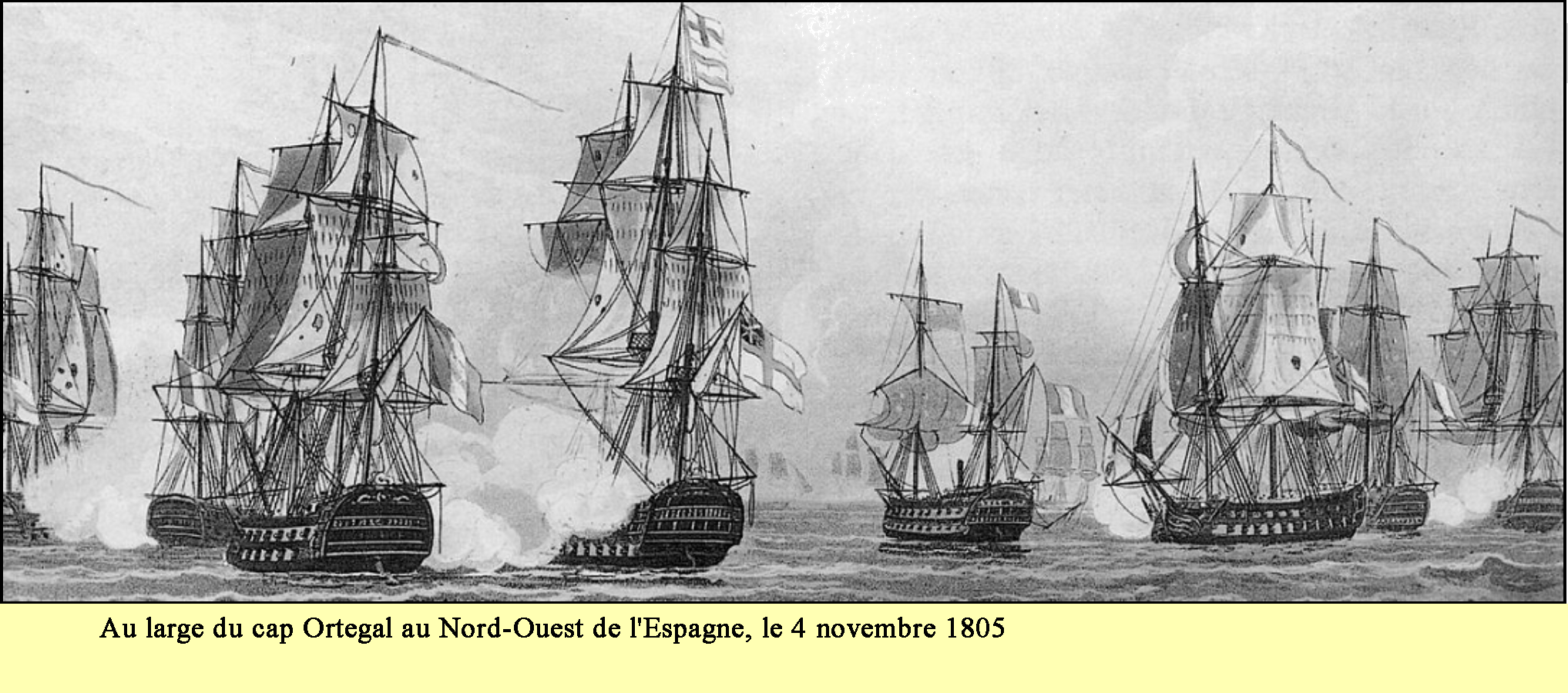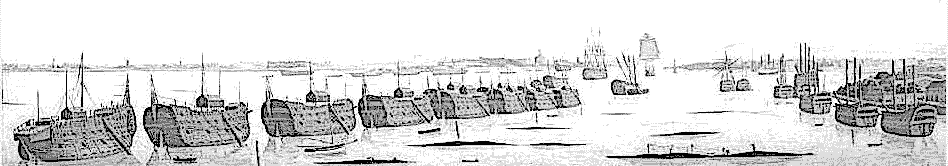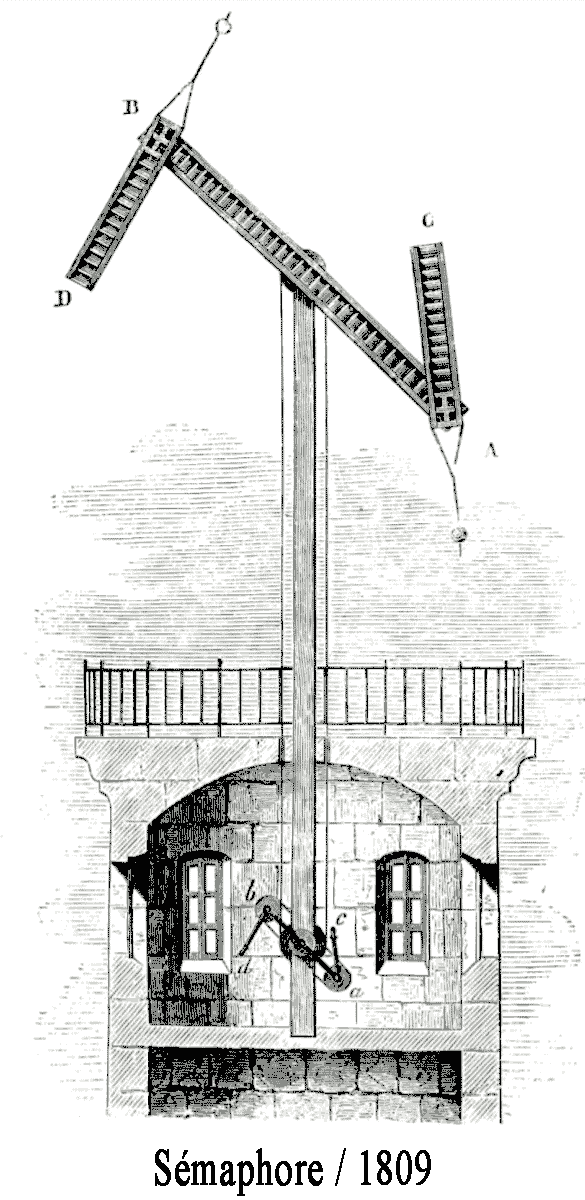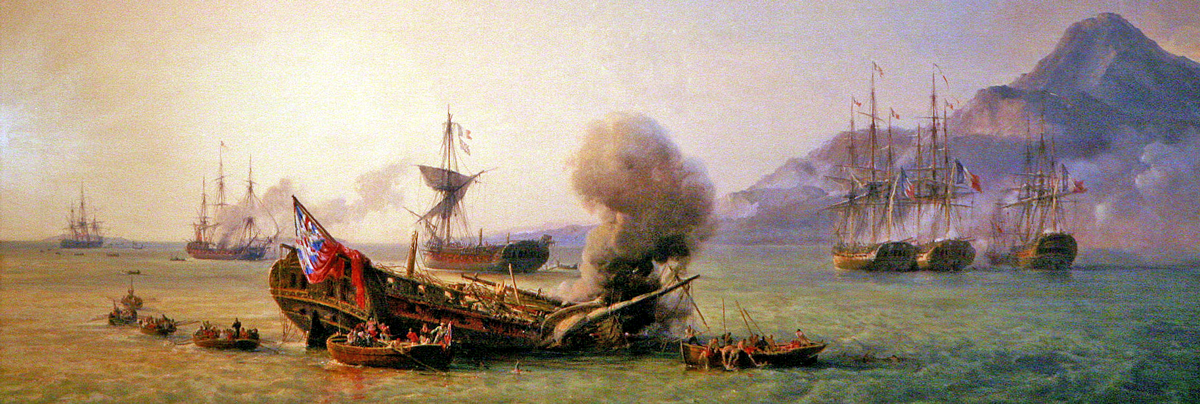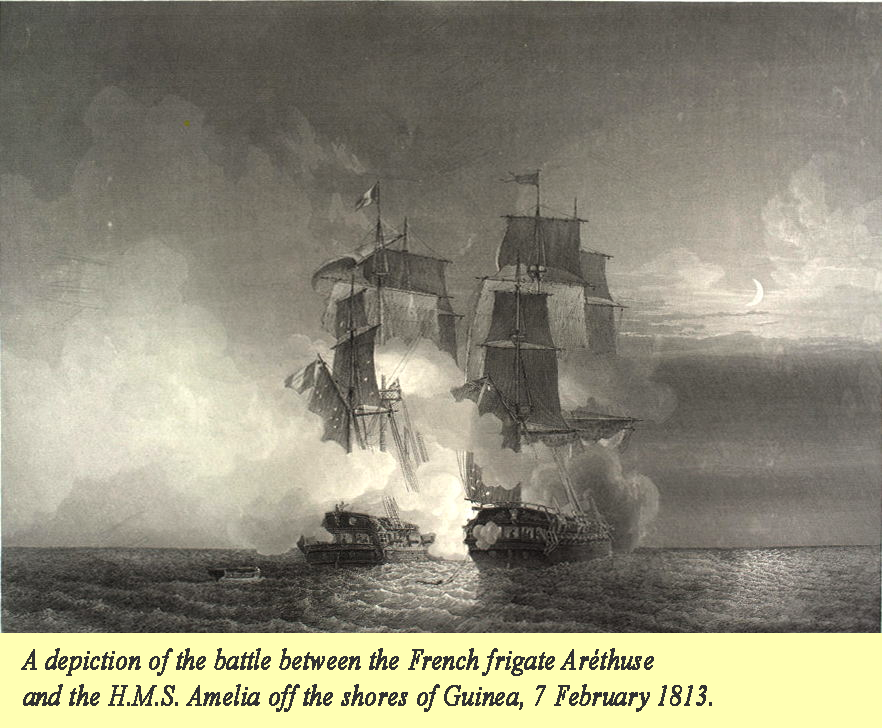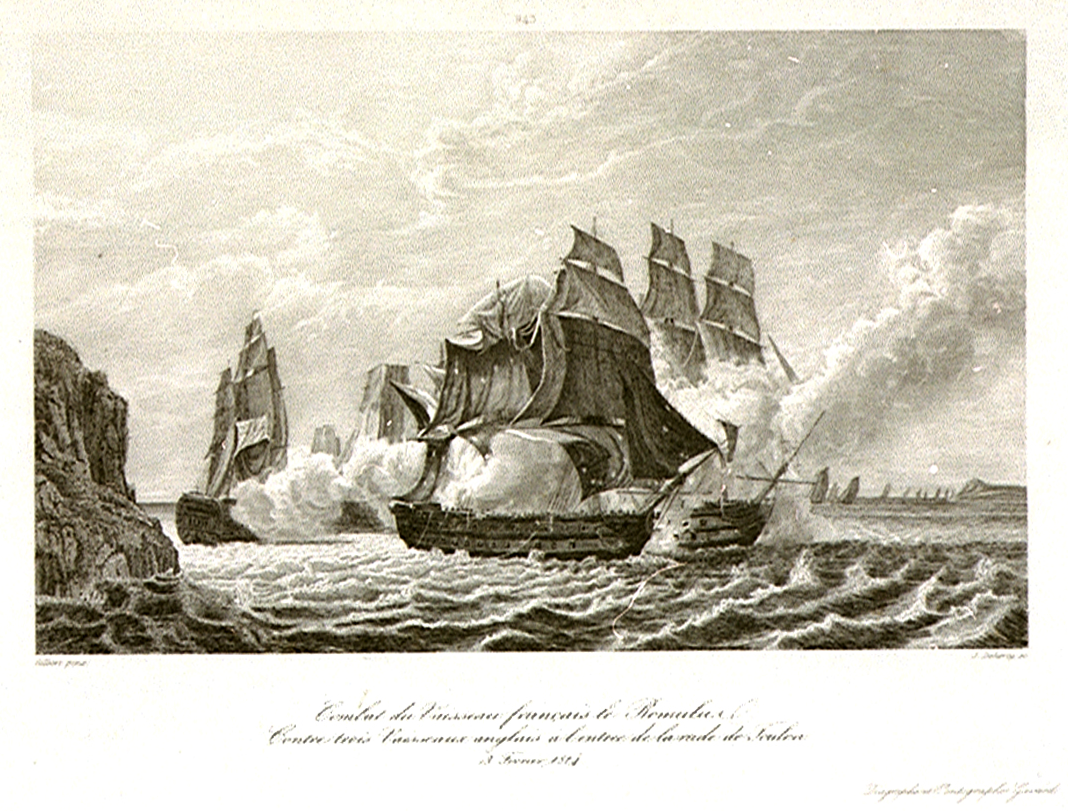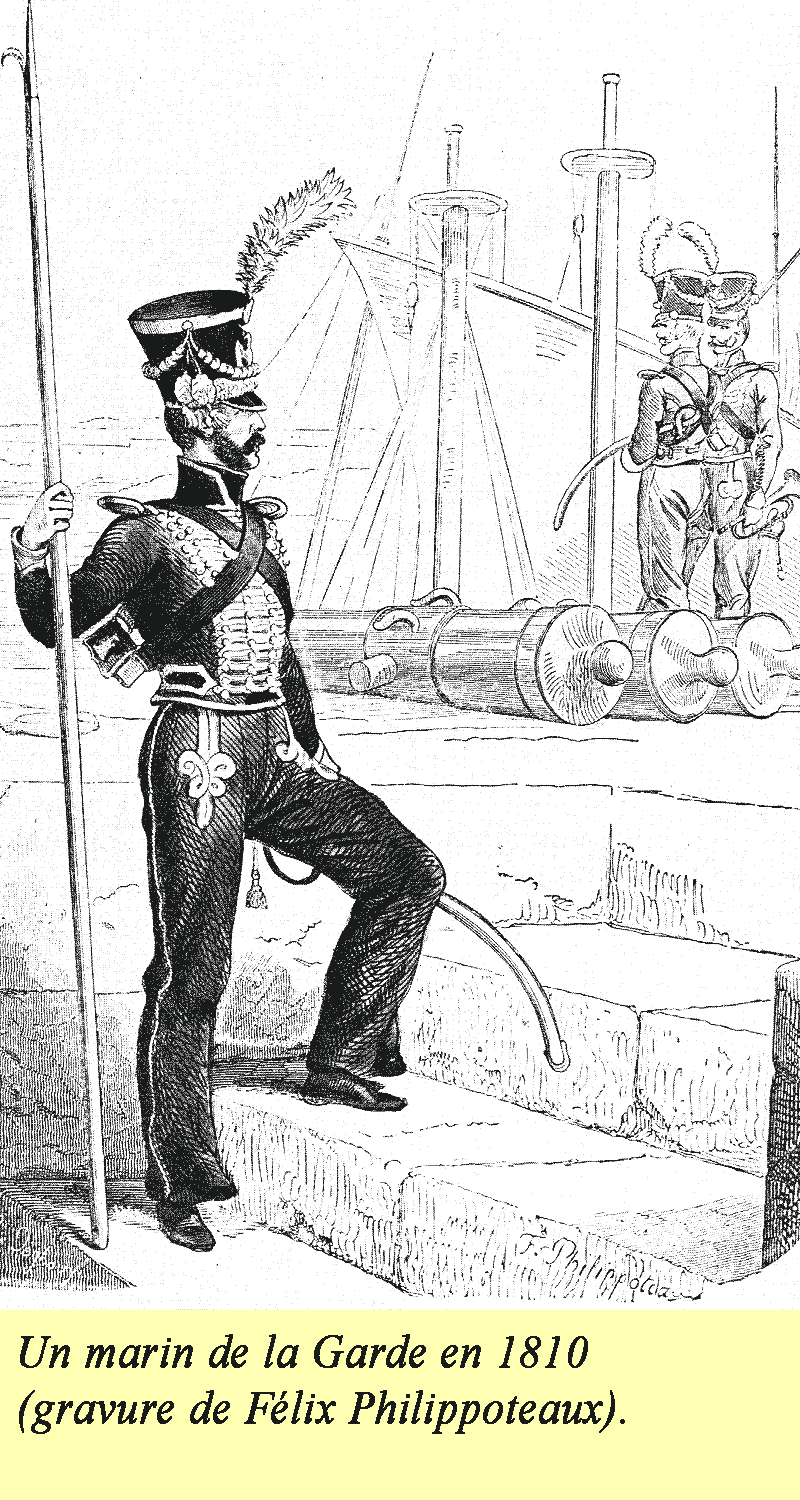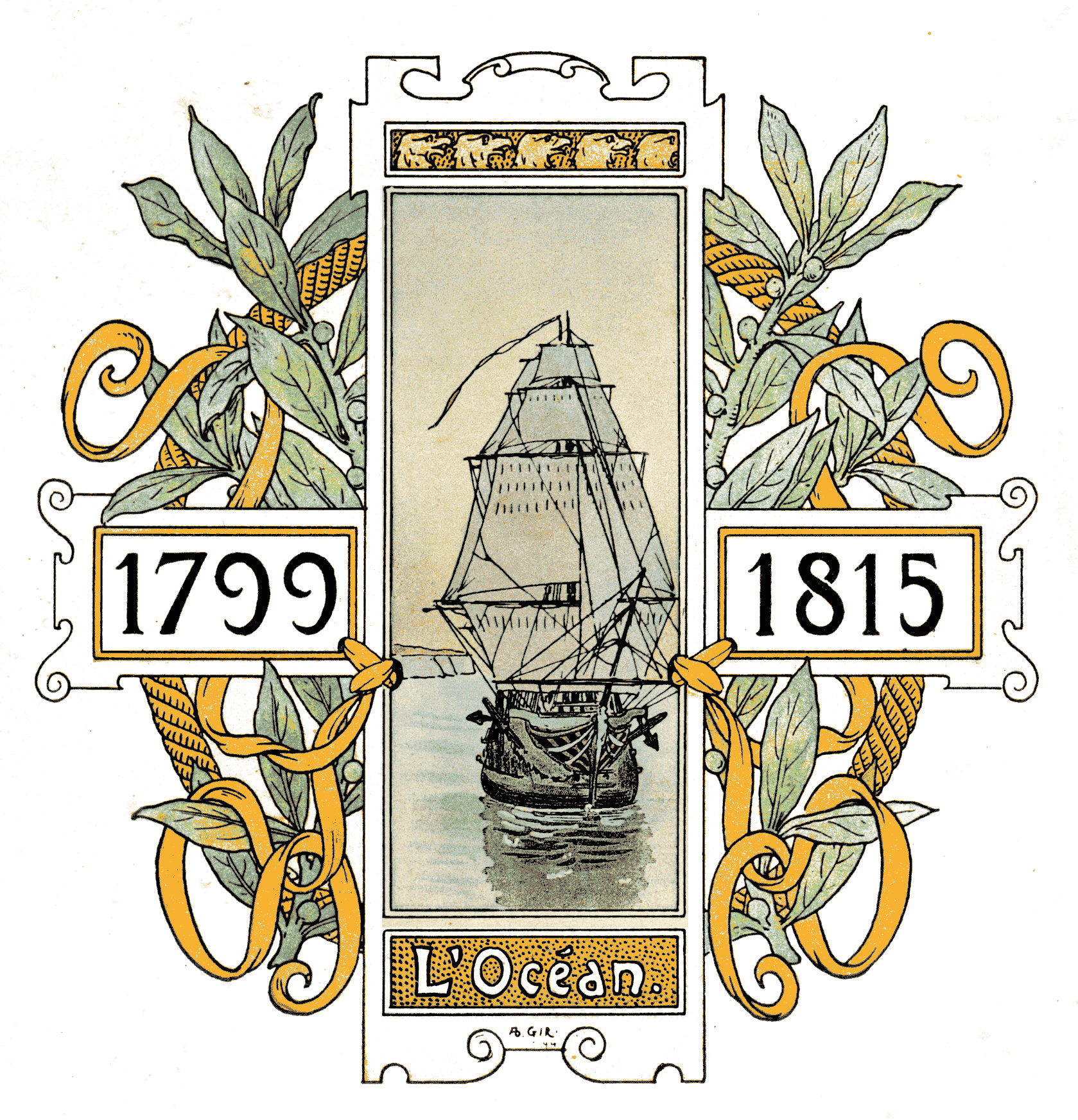
Gloires et Souvenirs Maritimes
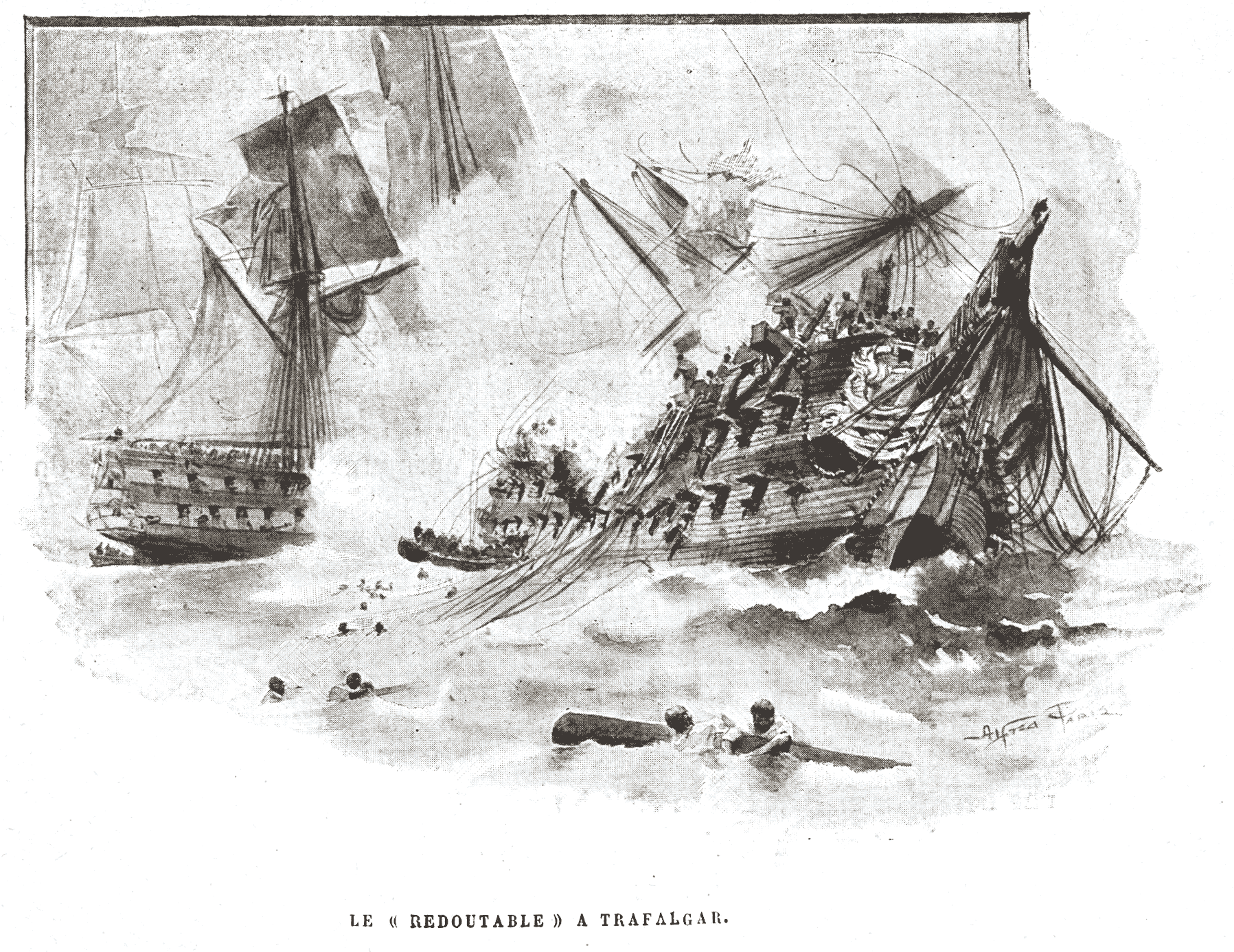
1799 -1815
Un combat de neuf heures
Après le désastre d'Aboukir, Decrès avait conduit son vaisseau à Malte. Mais le général Vaubois, qui commandait l'île, ne voulut pas garder des navires qui ne pouvaient lui rendre service et qui consommaient ses vivres. Il donna l'ordre à Decrès de gagner la France avec le Guillaume-Tell.
1er floréal an VIII (20 avril 1800).
Citoyen Ministre,
J'ai le malheur d'avoir à vous rendre compte de la prise du vaisseau le Guillaume-Tell, commandé par le capitaine Saunier, et sur lequel j'avais récemment porté mon pavillon. C'est le 9 germinal dernier que, quelques heures après son départ de Malte, et après une résistance dont je vais vous donner les détails, il m'a fallu céder à la cruelle nécessité de le rendre à l'ennemi, à environ sept lieues dans le sud du cap de Passaro, île de Sicile.
Cinq vaisseaux anglais, une frégate et plusieurs corvettes croisaient devant La Valette. Nous étions assurés que l'ennemi était instruit du projet de notre départ : mais, quels que fussent les périls, ce départ était trop nécessaire pour balancer à l'effectuer.
Ce fut le 8 germinal qu'il s'exécuta, à onze heures du soir, environ une heure après le coucher de la lune.
Malgré cette précaution, pour éviter d'être vu, le vaisseau avait à peine largué les amarres, que les postes anglais l'aperçurent et le signalèrent. On fit feu sur lui de toutes parts.
Courant près et plein, le Guillaume-Tell avait déjà doublé plusieurs vaisseaux ennemis qui l'avaient pris pour un des leurs, lorsque, vers onze heures trois quarts, il fut reconnu par une frégate qui vira sur lui, en se couvrant de feux pour signaler sa chasse, et rallier tous les ennemis.

C'était la Pénélope, de 44 canons, qui malheureusement avait sur le Guillaume-Tell un grand avantage de marche. Elle gagna de manière qu'à une heure du matin, elle en était à très petite portée, lorsqu'elle lança des deux bords, et envoya ainsi dans sa poupe, deux bordées auxquelles il riposta par ses canons de retraite. Plus d'une fois, elle en fut atteinte; mais cela ne l'empêcha pas de réitérer cette manœuvre toute la nuit, ayant tout l'avantage qui résultait pour elle de la supériorité de sa marche et du choix de ses positions, attendu la nécessité où j'étais de fuir.
Vingt fois je fus tenté de faire manœuvrer pour la mettre hors de combat, ainsi que quelques corvettes qui tiraillaient de l'arrière; mais, comme le vent était très frais, et que, malgré l'obscurité de la nuit, on voyait à l'horizon les bâtiments qui les appuyaient, je ne pus me dissimuler que, pour peu que je m'arrêtasse, je fusse joint incessamment par tous les chasseurs, et ne pouvais plus échapper. Nous fûmes donc ainsi incommodés toute la nuit par cette frégate, qui parvint à démâter le vaisseau de son grand mât de hune, vers cinq heures du matin. Presque au même instant survint le vaisseau le Lion de 64 canons, qui se mit à portée de mousquet, par le travers de bâbord du Guillaume-Tell, tandis que la Pénélope le canonnait de l'arrière. Pendant trois quarts d'heure environ que le Lion prêta le côté, il reçut et fit un feu très vif; mais enfin le sien faiblit, et nous étions à demi-portée de pistolet, lorsque je m'aperçus qu'il n'avait plus personne sur ses gaillards.
J'ordonnai au capitaine Saunier de saisir le premier moment pour l'aborder. La première tentative que cet officier en fit ne put réussir par les soins que l'ennemi mit à l'éviter : mais l'ayant tenté une seconde fois, il parvint à engager le beaupré du Guillaume-Tell dans les haubans d'artimon du Lion; et l'abordage réussissait certainement, si par la rupture du bout-dehors du premier, les deux vaisseaux ne se fussent dégagés au moment même où un matelot amarrait le gréement, et où une troupe de braves se présentait pour se jeter à bord. Ce coup de main manqué, le Lion, désemparé de toutes ses voiles, ayant son gréement haché, sa mâture chancelante, fut obligé de faire vent-arrière, ses écoutes en bande, sans tirer un coup de canon.
Le Guillaume-Tell le poursuivit quelques minutes, puis fut contraint de revenir sur bâbord pour recevoir le Foudroyant qui venait prendre part au combat.
Il était environ six heures. Ce Foudroyant de 86 canons, l'un des plus beaux vaisseaux de l'Angleterre, passa de l'arrière du Guillaume-Tell, en lui criant de se rendre, et lui envoyant aussitôt sa bordée. Par le conflit de leurs manœuvres, les deux vaisseaux se trouvèrent bientôt par le travers l'un de l'autre, le Foudroyant à tribord, et la Pénélope dans la hanche. Le feu, dans ce moment, fut terrible de part et d'autre, et dura ainsi près d'une heure, d'aussi près qu'on peut l'être sans s'aborder.
Il y avait environ trente-six minutes que le mât d'artimon du Guillaume-Tell était tombé, lorsque, vers les sept heures moins un quart, son grand mât eut le même sort. Les voiles et le gréement du Foudroyant étaient en pièces; il avait été quelques moments sans gouverner; et comme il présentait la poupe, son mât d'artimon avait été coupé, et plusieurs de ses vergues étaient en pantenne.
Cependant, retiré du combat depuis une heure, le Lion s'était réparé et revenait à la charge par bâbord. Dans l'état où était le Guillaume-Tell, j'avoue qu'il y avait peu à espérer pour son salut d'un combat aussi inégal : mais la détermination de son équipage était telle, que j'étais au moins sûr de le vendre cher à l'ennemi, et d'ailleurs, tant que le vaisseau gouvernait, il pouvait encore tout entreprendre, sans avoir rien à ménager pour lui-même ; c'est pourquoi j'ordonnai au capitaine Saunier de tâcher d'aborder le Foudroyant, dont nous voyions que le feu avait beaucoup faibli. L'ennemi, jugeant de notre intention, manœuvra pour éviter l'abordage, en coiffant ses voiles, et les deux vaisseaux se touchèrent presque, mais ne purent s'accrocher.
II résulta au moins de cette manœuvre que le Foudroyant, qui avait déjà son mât d'artimon à bas, fut battu à bout portant, de l'avant en arrière; son petit mât de hune tomba; il s'éloigna ayant ce qui restait de mâture extrêmement maltraité, et se tint le reste du combat à une distance qui ne permettait plus d'abordage. Ce fut alors que le capitaine Saunier, qui jusque-là avait commandé la manœuvre avec une habileté peu commune, fut blessé grièvement et remplacé dans le commandement par le premier lieutenant Donnadieu, officier d'un très grand mérite.
Depuis sept heures, le Guillaume-Tell n'ayant plus que son mât de misaine et son petit mât de hune eut à combattre à la fois les deux vaisseaux et la frégate; il répondait à tous, tirant toujours des deux bords, et souvent de l'arrière en même temps.
Le feu avait pris plusieurs fois dans les hauts, et chaque fois on était parvenu à l'éteindre : plusieurs explosions que j'avais vues à bord des ennemis m'assuraient que le même accident leur était arrivé. Malheureusement le démâtage engageait une grande partie de nos batteries de bâbord et nous étions obligés d'arroser continuellement ce côté, où les débris de voilures et de gréements dont nos efforts ne suffisaient pas à nous débarrasser s'embrasaient à chaque instant.
A huit heures (et je cite ce moment parce que je ne puis pas préciser de combien l'état des batteries s'était empiré à la fin de l'action) il y avait un canon de crevé, un de cassé par les boulets, et dix-neuf de démontés, sans comprendre ceux des gaillards. Comme le grand mât avait été coupé deux fois, un de ses troncs, d'environ quatorze pieds de long, barrait le gaillard d'arrière tout encombré d'ailleurs des débris de la lunette. Malgré cet accident et le spectacle de beaucoup de sang répandu, la détermination de l'équipage allait en croissant, et, malgré le feu réuni des trois bâtiments ennemis, la défense du Guillaume-Tell était encore très rigoureuse à huit heures et demie, lorsque son mât de misaine tomba sur bâbord. Tout ce côté battu par le Lion se trouva alors engagé par les mâtures. L'ennemi, profitant de l'embarras de cette position, put choisir celle qui lui convenait et où il nous devenait impossible de lui répondre. Le Foudroyant, qui était le plus maltraité, ne pouvait se tirer du travers de tribord : mais dans la hanche de bâbord était le Lion, ayant ses voiles et son gréement hachés et quelques vergues cassées; enfin la Pénélope, qui était la moins maltraitée, avait passé de l'avant, et tous réunissaient leur feu sur le Guillaume-Tell, qui, rasé de tous ses mâts, ne gouvernait plus. Il était ballotté par une grosse houle qui, depuis qu'il n'était plus appuyé par la mâture, le forçait à chaque roulis de fermer les sabords de la batterie basse pour ne pas remplir.
Dans cette position, il ne me fut que trop évident non seulement que le salut du vaisseau était impossible, mais encore que je n'avais plus de mal à faire à l'ennemi. Je ne pus donc me dissimuler que les hommes que je perdrais par une plus longue résistance soient gratuitement sacrifiés à une vaine ostentation. Sur cette conviction et celle que la défense du Guillaume-Tell avait été assez soutenue pour n'avoir rien que d'honorable, je crus de mon devoir de céder à la fortune, et à neuf heures trente-cinq minutes environ, après le complet démâtement, le pavillon fut amené.
La frégate la Pénélope fut seule en état d'amariner le vaisseau, et lui donna la remorque pour se rendre à Syracuse. Après vingt-quatre heures de réparation, le Lion la donna au Foudroyant, dont toutes les vergues étaient criblées; et en voyant après ce combat ce qui restait de mâture à ce vaisseau, Français et Anglais ne concevaient pas qu'elle pût tenir encore debout. Après le combat, vergues et mâts quelconques, tout a été changé à Minorque.
Le capitaine Saunier vous transmet, citoyen ministre, l'état des hommes tués ou blessés dans le combat. L'ennemi n'a pas dissimulé qu'il avait perdu beaucoup de monde ; et, d'après ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit immédiatement après l'affaire, il paraît certain qu'à cet égard les vainqueurs n'ont pas été plus heureux que les vaincus.
Je crois superflu de m'étendre sur la conduite de l'état-major et de l'équipage du Guillaume-Tell. Le seul fait de son combat et trois tentatives d'abordage, où, malgré la supériorité de l'ennemi, nous avons été voisins du succès, vous disent assez, citoyen ministre, quelle confiance m'inspiraient les talents du capitaine, le dévouement des officiers et la bravoure de tous ceux, de quelque grade qu'ils fussent, que j'avais l'honneur de commander.

DECRÈS.
Algésiras
(6 JUILLET 1801)
Le cabinet de Madrid, désirant acheter l'amitié de la France par quelques sacrifices, offrit d'armer plusieurs vaisseaux à Cadix. Ces vaisseaux espagnols devaient être rejoints par une division commandée par Linois, qui partit de Toulon le 13 juin 1801. Sa division comptait trois vaisseaux et une frégate. Le 6 juillet, elle se trouvait au mouillage d'Algésiras, appuyée par les batteries de la côte espagnole. À SEPT heures et demie il me parvint de terre l'avis que l'ennemi passait le détroit. Immédiatement je l'aperçus doublant le cap Carnero. Je ne doutai pas qu'il n'eût le projet de nous combattre. J'ordonnai les dispositions pour le recevoir, regrettant de n'avoir pas eu le temps de prendre la position la plus avantageuse. Nous comptâmes six vaisseaux ennemis, une frégate et un lougre.
À huit heures un quart la batterie de l'île verte tira sur l'ennemi, j'avais fait le signal de commencer le feu quand on serait à portée. À huit heures et demie, l'Indomptable commença le combat, qui devint bientôt général. La manœuvre du chef de file m'annonçait l'intention de me doubler (c'est-à-dire de me prendre entre deux feux). Je fis à neuf heures et demie le signal de couper les câbles et je me servis des focs et voiles d'étai pour m'échouer. Les manœuvres étaient déjà bien endommagées, de sorte que le mouvement fut extrêmement long. Je fus exposé à recevoir des bordées par la tranche. Sur les onze heures, le Formidable toucha le fond en présentant le travers à peu près au large. Le chef de file de la ligne ennemie toucha aussi en avant de lui, et ces deux vaisseaux, se présentant l'avant, ne purent se tirer que quelques pièces de chasse.
Deux vaisseaux anglais mouillèrent à petite distance des bâtiments de la République. La frégate le Muiron était exposé au feu de l'ennemi, auquel elle répondait avec vivacité. Son capitaine s'aperçut à neuf heures que la batterie de l'île verte cessait son feu et que des embarcations anglaises menaçaient de s'en emparer, il détacha cent trente militaires passagers sous le commandement d'un capitaine d'infanterie, qui arriva à temps pour empêcher l'ennemi d'aborder. Un de leurs canots fut coulé et l'autre pris. Le commandant du Desaix y avait aussi envoyé du monde, et cette batterie renforcée par les Français fut servie avec activité. Un vaisseau ennemi toucha, vis-à-vis la batterie, dont il essuyait le feu ainsi que celui du vaisseau l'Indomptable. Son pavillon fut amené, mais des chaloupes le remorquèrent au large.
La batterie de St-Jacques, située au nord de la ligne, avait ralenti son feu. Le général de brigade Devaux s'y précipita avec des troupes qu'il fit demander au Desaix : alors il porta à l'ennemi les coups les mieux dirigés. Sept chaloupes canonnières espagnoles prirent une part si active à l'action, que cinq d'entre elles furent coulées ou mises hors de combat.
Les vaisseaux ennemis ne purent résister à notre feu ; ceux qui étaient mouillés coupèrent leurs câbles, et le vaisseau échoué près du Formidable, essuyant le feu de la batterie de St-Jacques et surtout celui du vaisseau le Desaix qui pendant toute l'action s'était fait remarquer par son extrême vivacité, amena son pavillon à deux heures. À deux heures et demie, le combat cessa, les ennemis ayant laissé arriver sur Gibraltar, en nous abandonnant l'Annibal de soixante-quatorze canons. Ils eurent trois vaisseaux démâtés d'un ou deux mâts de hune et ils furent tous très avariés dans leur voilure et leur mâture. Chacun a fait honorablement son devoir. Officiers, passagers, soldats et marins ont montré la bravoure la plus réfléchie et la plus exacte subordination. Les armes de terre et de mer réunies dans cette action ont rivalisé de courage et d'enthousiasme pour me seconder.
Le vaisseau l'Annibal portait le second général de la division ennemie. Aussitôt qu'il eut amené son pavillon, il s'embarqua dans une petite yole sur laquelle je fis tirer, mais on ne put atteindre un si petit objet, fuyant très vivement vers Gibraltar.
Dans la soirée, plusieurs embarcations ennemies vinrent à bord de l'Annibal pour y prendre les blessés. Comme elles n'avaient point de pavillon parlementaire et qu'elles étaient armées, je les fis arrêter et fis les équipages prisonniers.
Mon premier soin fut de faire mettre tous nos vaisseaux à flot ainsi que le vaisseau pris, et de leur faire prendre de suite des positions plus avantageuses pour rendre plus redoutable notre feu réuni à celui des batteries dont s'occupait le général Devaux, afin de protéger efficacement la division.
Nous aperçûmes le 18 à Gibraltar deux vaisseaux qui avaient été obligés de rentrer dans le port. Les trois autres étaient sur rade, mais un seul paraissait en état de reprendre la mer.
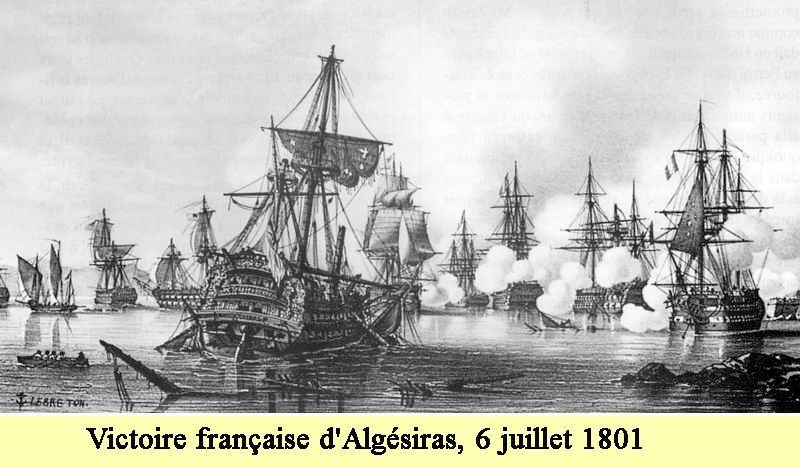
Il m'est bien agréable, citoyen ministre, d'avoir à vous rendre compte de quelques succès remportés sur un ennemi dont la supériorité, en raison du nombre, paraissait aussi décidée. Six grandes heures d'un engagement opiniâtre n'ont servi qu'à animer les braves qui se sont distingués dans cette journée. Je vous demande, citoyen ministre, avec instance, d'accorder des secours aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans cette action, ainsi qu'aux blessés grièvement, qui ne pourront désormais pourvoir à leur subsistance. J'aurai l'honneur de vous en adresser l'état au premier jour.
Des trois commandants des vaisseaux, deux sont morts glorieusement sur leurs gaillards. Je ne m'en suis point aperçu par la manière dont se sont comportés leurs successeurs dans le combat.
Il ne nous est resté que le commandant Christy Pallière qui a montré dans le courant de la campagne autant de zèle et de talent dans la conduite de son vaisseau que de courage pour le défendre.
Le 20, une division espagnole aux ordres de Son Excellence M. le lieutenant général Moreno, est arrivée de Cadix, ce qui nous donne l'espoir que, protégés par nos braves et fidèles alliés, nous irons dans un port où nous trouverons les moyens de nous réparer et de donner au gouvernement de nouvelles preuves de notre dévouement.
Immédiatement après l'affaire, présumant être attaqué de nouveau, l'on fut forcé de jeter à l'eau les tués et d'envoyer à terre les blessés. Il en résulte depuis cette époque que n'ayant pas eu un moment pour faire réunir tout le monde à bord et y faire un appel, ce ne peut être que par approximation que j'évalue dans la division le nombre des tués à 186, et celui des blessés à 300, dont 43 sont sans espoir d'être sauvés et 40 très grièvement atteints.
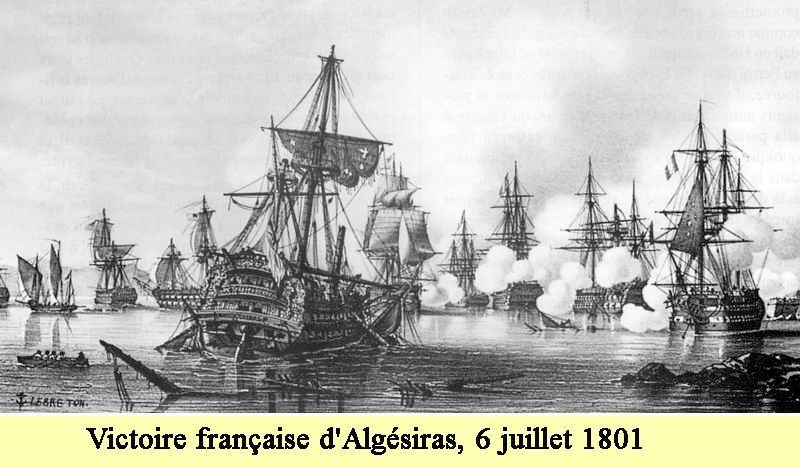

(Mémoires de Linois.)
Héroïsme du capitaine Troude
commandant le "Formidable"
commandant le "Formidable"
(12 JUILLET 1801)
Quelques jours après le combat d'Algésiras, la division Linois prit le large pour se rendre à Cadix. Elle fit pendant ce court trajet la rencontre d'une escadre anglaise.
Au Général Vence, préfet maritime à Toulon.
CITOYEN général, ma position à Algésiras était des plus inquiétantes. J'avais des espions à Gibraltar qui m'annonçaient que les dispositions de l'ennemi étaient de venir nous incendier. Je ne pouvais craindre que cela, car j'avais pris une position militaire qui rendait notre division redoutable. Enfin le 20 messidor, par suite des démarches multipliées de Dumanoir et mes pressantes lettres, une division sous les ordres de Son Excellence le général Moreno, venant de Cadix, mouilla à Algésiras pour venir protéger notre entrée à Cadix. Cette division était forte de six vaisseaux, dont un français, le Saint-Antoine, commandé par Le Ray, et trois frégates, dont deux Françaises. Quoique tous les secours nous fussent prodigués par l'escadre espagnole, nous ne pûmes avec les débris de nos mâtures être prêts à faire voile que le 23 au soir, l' Annibal à la remorque d'une frégate. Cinq vaisseaux anglais appareillèrent de Gibraltar ainsi que deux frégates et deux corvettes.
Ayant l'avantage du vent, ils nous observèrent à petite distance, disposés à profiter, sans doute, de nos fautes pour nous attaquer, mais ils n'en trouvèrent pas l'occasion dans le jour ; on leur présenta le combat, qu'ils refusèrent.
Le général Moreno, par ses instructions, avait l'ordre de passer sur une frégate en présence de l'ennemi. Il m'avait instamment invité pendant deux jours à me réunir à lui, m'observant la nécessité de nous concerter dans les signaux à faire aux bâtiments respectivement sous nos ordres, la célérité du départ ne permettant pas de communiquer les signaux espagnols aux bâtiments français. Je lui représentai que nos ordonnances, mes principes et nos préjugés ne m'autorisaient pas à quitter mon vaisseau ; il m'écrivit alors officiellement et me mandait qu'une équivoque dans les signaux pouvait compromettre la sûreté de l'escadre. J'étais bien convaincu de la force de ses raisons et des avantages qui pouvaient en résulter pour le succès de la mission. Je fis alors le sacrifice de mon amour-propre en me réunissant au général espagnol à bord de la frégate et m'exposant peut-être par là aux traits satiriques de mes ennemis; mais j'ai déjà prouvé, et le prouverai encore dans l'occasion, que je ne crains point les boulets de l'ennemi.
Le 23, au soleil couchant, nous étions tous réunis, à l'exception de l'Annibal, qui ne pouvait pas à l'aide d'une remorque doubler le cap Carnero. Je fus obligé de le faire relâcher à Algésiras. Nous, arrivâmes alors dans le détroit en formant une ligne de front qui couvrait les trois vaisseaux français avariés et qui laissait la faculté de présenter le travers à l'ennemi, s'il entreprenait de nous attaquer; nous l'avions laissé en panne dans la Méditerranée sur la fin du jour. La frégate où nous nous trouvions conserva toute la nuit trois feux de poupe et un à la tête du mât, signal de ralliement. Le vent augmenta avec violence, nous n'avions que les huniers amenés tout bas et le perroquet de fougue cargué. À onze heures et demie, je comptais de la dunette de la frégate tous nos bâtiments bien réunis, quoique la nuit fût très obscure. Dix minutes après, nous entendîmes une canonnade et presque aussitôt nous vîmes deux bâtiments en feu. Nous supposâmes que c'étaient deux brûlots que l'ennemi envoyait en nous attaquant. La canonnade devint à peu près générale. Nous eûmes un homme tué à bord de la frégate et cinq de blessés, plusieurs coups dans le corps du bâtiment, dans les voiles et dans le gréement, et l'on eut bien de la peine à empêcher de tirer à bord de la frégate. Je suis encore bien incertain si les coups que nous avons reçus sont venus de l'ennemi. Nous étions alors dans la partie la plus resserrée du détroit.
Chacun cherchait à s'éloigner des bâtiments embrasés ; il en résulta nécessairement de la confusion, nous n'eûmes d'autre parti à prendre que de continuer notre route à petites voiles, en conservant nos feux de distinction pour rallier nos bâtiments. Au jour nous étions à six lieues dans l'ouest de Cadix et nous nous vîmes environnés des nôtres, à l'exception des deux vaisseaux à trois-ponts, le Royal Carlos, l'Hermenegilde, le Saint-Antoine et le Formidable. Nous aperçûmes à Cadix ce dernier. Au point du jour il eut à combattre deux vaisseaux et une frégate ; quoique désemparé, en une heure et demie il démâta de tous ses mâts le Vénérable, vaisseau ennemi, et se fit abandonner des autres. Ce combat honorable auquel on n'en peut comparer aucun dans les fastes de la marine, a été soutenu par le brave Troude.
J'espère que le gouvernement s'empressera de lui témoigner la reconnaissance nationale. Je lui avais donné la veille le commandement du Formidable; bien convaincu que mon pavillon ne pouvait qu'être honorablement défendu par lui. Son combat a été vu de tout Cadix et de l'île. On est dans l'enthousiasme de cette action et j'ai le regret de n'avoir pas participé à sa gloire.
En approchant de Cadix, nous apprîmes les malheurs de la nuit. Le vaisseau le Royal Carlos en venant au vent démâta de son mât de misaine, le feu des canons de ses batteries mit le feu aux débris de la mâture; au même instant il fut abordé par l'Hermenegilde. Ils se crurent ennemis, se canonnèrent et s'incendièrent en un moment; trente hommes seulement furent sauvés, parmi lesquels était le second du Royal Carlos.
Le Saint-Antoine, enveloppé la même nuit par l'ennemi, fut forcé de se rendre. Le Ray fut blessé à la jambe d'un biscaïen dès les premières volées; son équipage, composé de toutes espèces de nations, ne pouvait pas promettre une longue et vigoureuse résistance.
D'ailleurs, cerné par trois de ceux de l'ennemi, il fut promptement dégréé. Il se trouvait de l'arrière pour l'infériorité extraordinaire de sa marche; de sorte que l'extrême dévouement du lieutenant général Moreno, ses savantes instructions et combinaisons, n'ont pu prévenir les malheurs de la nuit, parce qu'on n'a pas suivi littéralement ses ordres, d'où il est résulté un abordage et un incendie qui a mis de la confusion et a occasionné des méprises funestes. On préparait des fêtes à Cadix pour nous recevoir et notre arrivée a été un jour de deuil.
 Tous les rapports s'accordent à assurer que l'ennemi s'est servi de boulets incendiaires ; il le désavoue, et malgré les indices que nous avons, je ne pourrais pas l'affirmer positivement.
Tous les rapports s'accordent à assurer que l'ennemi s'est servi de boulets incendiaires ; il le désavoue, et malgré les indices que nous avons, je ne pourrais pas l'affirmer positivement.
J'ai été bien satisfait de mon fils : dans l'action il a montré un courage héroïque. Après quatre heures de combat, nous ne restions plus que trois sur les gaillards. Je descendis aux batteries, où je rencontrai mon fils : son premier mot fut de me dire : « Papa, cela va très bien ici. » Je vous avoue qu'en pareille circonstance un fils est trop rapproché de son père. Tous les aspirants se sont conduits avec distinction.
Je vous prie de présenter mes respectueux hommages à Mme Vence. Je désespère cette année d'avoir le plaisir de manger du bon raisin de Plaisance et des noisettes comme je m'en étais flatté.
Agréez, mon cher Général, les assurances de mon parfait attachement et de mon respect,

LINOIS.
Échec de Nelson
contre la flottille de Boulogne
contre la flottille de Boulogne
(4-15 AOÛT 1801)
En 1801, le Premier Consul organisa une flottille de petits navires qu'il réunit à Boulogne dans le but de tenter un grand débarquement en Angleterre. Latouche-Tréville en reçut le commandement. Les Anglais conçurent les plus vives alarmes de ce rassemblement de forces.
LA presse anglaise, interprète exigeant de l'opinion publique, ne cessait de harceler le gouvernement et de répéter que c'était dans les ports ennemis qu'il fallait aller écraser la flottille française. L'amirauté se vit donc contrainte, par condescendance pour de folles alarmes, de prescrire à Nelson de bombarder le port de Boulogne ; mais l'amiral Latouche fut informé de ce projet : il sortit du port, où ses bâtiments entassés auraient pu courir de grands risques, et forma en avant des jetées une longue ligne d'embossage composée de six bricks, deux goélettes, vingt chaloupes canonnières et un grand nombre de bateaux plats. Le 4 août, Nelson vint lui-même au point du jour mouiller ses bombardes devant la ligne française ; il espérait que pour éviter cette attaque la flottille se réfugierait dans le port de Boulogne, et il se proposait la nuit suivante de diriger ses brûlots sur la masse de bâtiments ainsi resserrés dans un étroit espace. Vers neuf heures du matin, le bombardement commença ; il ne put ébranler la ligne d'embossage, et ne produisit d'autre effet que la destruction d'une canonnière et d'un bateau plat. Pas un homme à bord de la flottille ne fut atteint, tandis que, nos canonnières et les batteries de terre répondant par un feu très vif au feu des bombardes anglaises, un éclat de bombe vint blesser, à bord d'un de ces bâtiments, un capitaine d'artillerie et deux matelots.
Cette première tentative avait donc complètement échoué ; mais Nelson en préparait une autre plus sérieuse et dont il ne mettait point le succès en doute. Le 15 août, il vint mouiller à six mille mètres environ de la flottille française, encore embossée devant le port de Boulogne. Il amenait avec lui des chaloupes et péniches de toute grandeur, à l'aide desquelles il voulait enlever ou incendier nos canonnières. Ces embarcations étaient au nombre de 57 ; il les partagea en quatre divisions, qu'il plaça sous les ordres des capitaines Somerville, Parker, Cotgrave et Jones. La perte de son bras lui interdisait de prendre lui-même une part active à cette expédition ; mais il s'efforça d'en assurer la réussite par les dispositions les mieux entendues et les soins les plus propres à racheter l'imprudente audace d'une pareille entreprise. Dans chaque division, deux canots étaient particulièrement chargés de couper le câble et les amarres des navires qu'on allait attaquer. Ces canots, munis d'une corde terminée par un croc qu'on pût jeter à bord du navire ennemi, ne devaient point songer à l'assaillir, mais s'occuper de le prendre à la remorque et de l'entraîner au large. Les autres embarcations se chargeaient de combattre et de réduire les bâtiments ainsi entraînés hors de la ligne. Chacune d'elles d'ailleurs avait reçu une hache bien affilée, une mèche; une chemise soufrée ou toute autre composition incendiaire, et se trouvait par conséquent en mesure d'enlever ou de brûler le navire qu'elle aborderait.
Les matelots étaient armés de piques, de sabres et de haches ; les soldats de marine, de leurs fusils et de leurs baïonnettes. Nelson avait voulu, dans cette occasion, comme à Ténériffe, que les canots de chaque division se donnassent mutuellement la remorque, afin d'arriver en force suffisante sur l'ennemi.
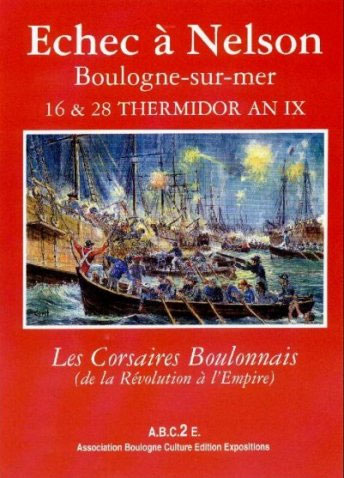 À dix heures et demie du soir, les embarcations reçurent leurs équipages, et à onze heures, au moment où la frégate la Méduse, que montait Nelson, montra six fanaux à la hauteur de sa batterie, elles poussèrent au large et vinrent se former, dans un ordre arrêté à l'avance, sur l'arrière de la Méduse. De ce point de ralliement, à un signal convenu, elles partirent toutes ensemble et se dirigèrent par des routes divergentes vers la plage de Boulogne. Le mot d'ordre était Nelson; le mot de ralliement Broute. La première division, que commandait le capitaine Somerville, chargé d'attaquer l'aile droite de la flottille, se trouva, en approchant de terre, entraînée par la marée dans l'est de la baie de Boulogne. Les capitaines Parker et Cotgrave ne rencontrèrent point le même obstacle ; ils avaient, en partant, gouverné directement sur l'entrée du port, et à minuit et demi ils assaillirent le centre de notre ligne. Parker, à la tête d'une partie de sa division, aborda le brick l'Etna, qui portait le guidon de commandement du brave capitaine Pevrieux; mais les filets d'abordage qui entouraient ce brick opposèrent une barrière insurmontable aux Anglais. Deux cents soldats d'infanterie réunis à nos matelots les reçurent par un feu nourri de mousqueterie et les rejetèrent dans leurs canots à coups de baïonnette. Parker lui-même fut blessé grièvement à la cuisse, et eût été pris sans le dévouement d'un de ses midshipmen. D'autres canots de sa division avaient essayé d'enlever le brick le Volcan, et avaient été également repoussés. L'attaque dirigée par le capitaine Cotgrave n'avait point eu un meilleur succès, et ces deux premières divisions étaient en pleine retraite quand le capitaine Somerville atteignit le port. Ce brave officier ne se laissa point émouvoir par la défaite de ses compagnons : il se jeta sur notre aile droite, et se croyait déjà maître d'un de nos bricks, quand une fusillade très vive, partie des navires environnants, vint l'obliger à se retirer précipitamment. Il gagna le large après avoir essuyé des pertes considérables. La quatrième division, qui devait se diriger sur notre aile gauche, avait rencontré, comme celle du capitaine Somerville, la marée contraire ; ne pouvant remonter suffisamment vers l'ouest, elle n'arriva sur le lieu de l'action que pour recueillir les blessés et assister les autres colonnes d'attaque dans leur fuite. Ce combat corps à corps tourna donc entièrement à notre avantage; il coûta aux Anglais cent soixante-dix hommes mis hors de combat, et produisit une vive impression de l'autre côté de la Manche.
À dix heures et demie du soir, les embarcations reçurent leurs équipages, et à onze heures, au moment où la frégate la Méduse, que montait Nelson, montra six fanaux à la hauteur de sa batterie, elles poussèrent au large et vinrent se former, dans un ordre arrêté à l'avance, sur l'arrière de la Méduse. De ce point de ralliement, à un signal convenu, elles partirent toutes ensemble et se dirigèrent par des routes divergentes vers la plage de Boulogne. Le mot d'ordre était Nelson; le mot de ralliement Broute. La première division, que commandait le capitaine Somerville, chargé d'attaquer l'aile droite de la flottille, se trouva, en approchant de terre, entraînée par la marée dans l'est de la baie de Boulogne. Les capitaines Parker et Cotgrave ne rencontrèrent point le même obstacle ; ils avaient, en partant, gouverné directement sur l'entrée du port, et à minuit et demi ils assaillirent le centre de notre ligne. Parker, à la tête d'une partie de sa division, aborda le brick l'Etna, qui portait le guidon de commandement du brave capitaine Pevrieux; mais les filets d'abordage qui entouraient ce brick opposèrent une barrière insurmontable aux Anglais. Deux cents soldats d'infanterie réunis à nos matelots les reçurent par un feu nourri de mousqueterie et les rejetèrent dans leurs canots à coups de baïonnette. Parker lui-même fut blessé grièvement à la cuisse, et eût été pris sans le dévouement d'un de ses midshipmen. D'autres canots de sa division avaient essayé d'enlever le brick le Volcan, et avaient été également repoussés. L'attaque dirigée par le capitaine Cotgrave n'avait point eu un meilleur succès, et ces deux premières divisions étaient en pleine retraite quand le capitaine Somerville atteignit le port. Ce brave officier ne se laissa point émouvoir par la défaite de ses compagnons : il se jeta sur notre aile droite, et se croyait déjà maître d'un de nos bricks, quand une fusillade très vive, partie des navires environnants, vint l'obliger à se retirer précipitamment. Il gagna le large après avoir essuyé des pertes considérables. La quatrième division, qui devait se diriger sur notre aile gauche, avait rencontré, comme celle du capitaine Somerville, la marée contraire ; ne pouvant remonter suffisamment vers l'ouest, elle n'arriva sur le lieu de l'action que pour recueillir les blessés et assister les autres colonnes d'attaque dans leur fuite. Ce combat corps à corps tourna donc entièrement à notre avantage; il coûta aux Anglais cent soixante-dix hommes mis hors de combat, et produisit une vive impression de l'autre côté de la Manche.
C'était le second échec de ce genre qu'éprouvait Nelson. À Boulogne comme à Ténériffe, il avait rencontré des difficultés imprévues; mais il avait aussi fait une trop large part au hasard et trop compté sur la négligence de ses ennemis. Cependant, si, à Ténériffe, il n'eût point, par deux tentatives infructueuses, éveillé l'attention des Espagnols, si à Boulogne il n'eût point eu affaire à un homme tel que Latouche-Tréville, il est probable qu'il eût réussi dans cette double attaque : les Anglais ont, pendant la dernière guerre, obtenu de nombreux succès dans des entreprises analogues, et ils les ont toujours dus à notre défaut de surveillance. Une vigilance soutenue, un service régulier, se rencontrent moins souvent à bord de nos navires que le dévouement le plus exalté et l'intrépidité la plus héroïque. Heureusement Latouche-Tréville gardait sa flottille comme une place forte; il tenait son monde sans cesse en alerte, et exigeait que le service se fît devant le port de Boulogne, sur ses bricks et ses canonnières, comme il doit se faire en présence de l'ennemi. Les chaloupes anglaises trouvèrent nos bâtiments préparés à les recevoir, leurs filets d'abordage hissés, leurs canons chargés et leurs équipages sur le pont : aussi leur attaque eut-elle le sort que le courage de nos matelots réservait à de plus formidables entreprises, s'il eût trouvé des chefs tels que Latouche pour le diriger.
(Jurien de la Gravière, Guerres maritimes sous la République et l'Empire.)
(Charpentier, éditeur.)
Le camp de Boulogne
ON s'apprêtait pour la descente d'Angleterre, disait-on. On faisait faire des hamacs pour toute la garde, avec une couverture pour chacun. Le camp de Boulogne était en grande activité, et nous faisions la belle jambe à Paris. Mais notre tour arriva pour prendre part aux manœuvres de terre et de mer, après de grandes revues et de grandes manœuvres dans la plaine de Saint-Denis, où il fallut endurer la pluie toute la journée; les canons de nos fusils se remplissaient d'eau, l'arme au bras. Le grand homme ne bougeait pas; l'eau lui coulait sur les cuisses : il ne nous fit pas grâce d'un quart d'heure. Son chapeau lui couvrait les épaules, ses généraux baissaient l'oreille, et lui ne voyait rien. Enfin, il nous fit défiler et, rendus à Courbevoie, nous barbotions comme des canards dans la cour, mais le vin était là, et l'on n'y pensait plus.
Le lendemain, on nous lit à l'ordre du jour qu'il fallait se tenir prêt à partir. « Faites vos sacs, dirent nos officiers, faites vos adieux à tout le monde, car il ne reste que les vétérans. »
L'ordre arrive, il faut porter toute la literie au magasin et coucher sur la paillasse, prêts à partir pour Boulogne. On nous campa au port d'Ambleteuse, où nous formâmes un beau camp. Le général Oudinot était au-dessus de nous avec douze mille grenadiers, qui faisaient partie de la réserve. Et tous les jours à la manœuvre. Nous fûmes embrigadés pour faire le service sur mer chacun notre tour. On nous mit très loin, sur une ligne de deux cents péniches. Toute cette petite flottille, divisée par sections, était commandée par un bon amiral, qui était monté sur une belle frégate, au milieu de nous. Pendant vingt jours, toujours manœuvrant les pièces, nous étions canonniers et marins. Les marins, canonniers et soldats, tout ne faisait qu'un seul homme, l'accord était parfait à bord. La nuit on criait : Bon quart ! et le dernier criait : Bon quart partout ! Le matin, les porte-voix demandaient le rapport de la nuit :
« Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à votre bord? — On vous fait savoir qu'il y a deux grenadiers qui se sont jetés à l'eau. — Sont-ils noyés? répétait le porte-voix. — Oui, répétait l'autre ; oui, mon commandant. — À la bonne heure ! » (Il disait à la bonne heure, parce qu'il avait compris le mot d'ordre.)
Une fois, j'étais monté sur une corvette avec dix pièces de gros calibre, cent grenadiers et un capitaine couvert de blessures. J'étais servant de droite d'une pièce, car il fallait tout faire, et la moitié restait sur le pont la nuit. Lorsque mon tour arrivait de descendre pour me coucher dans mon hamac, je disais : « Allons, vieux soldat, te voilà donc dans ton hamac ! Allons, repose-toi ! »
Le maître cambusier m'entendit : « Où est-il le vieux soldat? — Me voilà, lui dis-je. - Où est votre hamac? Je vais vous mettre dans une bonne place. »
Et il descendit mon hamac près des caisses de biscuit, et leva une planche : « Mangez du biscuit, et demain je vous donnerai le boujaron » (c'est la petite mesure d'eau-de-vie).
On mangeait dans des vases de bois, avec les cuillers de même, des fèves qui dataient de la création du monde ; toutes les rations par ordinaire étaient dans des filets ; c'était de la viande fraîche et de la sole.
Un jour, messieurs les Anglais vinrent nous faire une visite avec une forte escadre ; un vaisseau de soixante-quatorze fut assez insolent pour arriver près du rivage, il s'embosse et nous envoie des boulets à toute volée dans notre camp. Nous avions de gros mortiers sur la hauteur, un sergent de grenadiers demanda la permission de tirer sur ce vaisseau, disant qu'il répondait de le couler du premier ou du second coup. « Mets-toi à l'œuvre ! comment te nommes-tu? dit le Consul. — Despienne. — Voyons ton adresse. »
La première bombe passe par-dessus : « Tu as manqué ton coup, dit notre Petit Caporal. — Eh bien, dit-il, voyez celle-ci. »
Il ajuste et fait tomber sa bombe sur le milieu du vaisseau. Ce ne fut qu'un cri de joie. « Je te fais lieutenant dans mon artillerie », dit-il à Despienne.
Voilà les Anglais qui tirent à poudre pour appeler à leur secours, et voilà le feu dans le vaisseau. Les Anglais sautaient dans nos barques comme dans les leurs. Notre petite flottille poursuivit leurs gros bâtiments : il fallait voir tous ces petits carlins avec des gros dogues! c'était curieux. Les Anglais voulurent revenir à la charge, mais ils furent mal reçus; nous étions en règle. Nos petits 'bateaux faisaient des dégâts; tous les coups portaient, et leurs bordées passaient par-dessus nos péniches. Nous eûmes l'ordre de rentrer dans le port pour faire une grande manœuvre sur toute la ligne. Jamais on n'avait vu cent cinquante mille hommes faire des feux de bataillon ; tout le rivage en tremblait.
Tous les préparatifs se faisaient pour la descente; c'était un jeudi soir que nous devions mettre à la voile pour arriver sur les côtes d'Angleterre le vendredi. Mais, à dix heures du soir, on nous fit débarquer, sac au dos, et partir pour le pont de Briques pour déposer nos couvertures.
(Cahiers du Capitaine Coignet.)
(Hachette et Cie, Éditeurs.)
Portrait de Latouche-Tréville
ESPRIT impétueux et persévérant, Latouche-Tréville était fait pour arracher notre marine à la torpeur où avaient dû la jeter ses derniers revers. À l'âge de cinquante-neuf ans, miné par la fièvre dont il avait rapporté le germe de Saint-Domingue, il montrait encore une activité qui eût honoré la plus robuste jeunesse. C'était la quatrième guerre à laquelle il prenait part, car il avait fait ses premières armes sous M. de Conflans, livré trois combats pendant cette lutte mémorable qui avait affranchi le continent américain, et porté en 1792, sous les murs de Naples et de Cagliari, ce glorieux pavillon tricolore devant lequel il brûlait d'humilier l'orgueil de l'Angleterre.
À son arrivée à Toulon, il avait trouvé sept vaisseaux et quatre frégates mal armées et mal tenues. En quelques jours, tout changea de face. Avant que l'amiral Latouche prît le commandement de l'escadre, les frégates anglaises venaient impunément à l'entrée du goulet reconnaître nos vaisseaux et juger des progrès de nos armements. Un vaisseau et une frégate, désignés pour croiser à tour de rôle en dehors de la rade, les obligèrent à se tenir au large. Si l'ennemi faisait avancer des forces plus considérables, un autre vaisseau et une autre frégate mettaient immédiatement sous voiles, et l'escadre entière se tenait prête à les soutenir.
Du haut du cap Sépet, où il s'établissait chaque matin en observation, l'amiral surveillait les croisières ennemies et dictait les mouvements de son escadre. Plus d'une fois, les divisions avancées des deux flottes se trouvèrent ainsi à portée de canon. Les sorties fréquentes, cette attente continuelle du combat animait nos marins et les remplissait d'enthousiasme et d'ardeur. Essayant dans ces escarmouches la tranche de ses vaisseaux et de ses capitaines, Latouche recueillait avec émotion, comme un précieux gage des succès à venir, le moindre trait de fermeté et de bravoure. S'il gourmandait sans pitié la plus légère faiblesse, il avait aussi pour le vrai courage de ces hommages qui transportent les âmes et créent les dévouements sublimes. C'est ainsi qu'on le vit, après une belle manœuvre qui fut mal secondée, appeler à bord du Bucentaure le brave capitaine de Péronne, alors commandant du vaisseau l'Intrépide, pour le féliciter de sa noble conduite et le recevoir sur le gaillard d'arrière, comme on reçoit les princes, à la tête de son état-major et de son équipage.
Tout semblait présager le succès, quand la mort de l'amiral Latouche survint à bord du Bucentaure, le 20 août 1804. Les officiers de l'escadre voulurent que ses restes reposassent aux lieux mêmes d'où leur chef regretté avait vu pour la dernière fois s'éloigner les vaisseaux ennemis. Sur le sommet du cap Sepet, ils élevèrent un monument à sa mémoire. Le corps de Latouche y fut transporté, et, au milieu d'une foule attendrie, Villeneuve prononça sur sa tombe ces touchantes paroles : « De cette hauteur qui domine la rade et nos vaisseaux, l'ombre de Latouche-Tréville inspirera nos entreprises. Il sera pour ainsi dire toujours présent au milieu de nous. Les yeux souvent tournés vers son tombeau, nous puiserons dans cette vue ce zèle infatigable, ce courage à la fois prudent et intrépide, cet amour de la gloire et de la patrie qui, sujets éternels de notre estime et de nos regrets, doivent l'être, encore de notre constante émulation. Mais ils seront sans cesse l'objet de la mienne; le successeur de Latouche vous le promet. Promettez-lui qu'aux mêmes titres il sera sûr d'obtenir de vous la même fidélité et le même attachement. »
(Jurien de la Gravière,
Guerres maritimes sous la République et l'Empire.)
(Charpentier éditeur.)
Trafalgar
(21 OCTOBRE 1805)
Napoléon avait conçu en 1805 un vaste plan qui consistait à faire partir à la fois, des ports de France, trois escadres qui devaient se rendre aux Antilles pour y attirer les escadres britanniques et pour laisser ainsi le champ libre à la flottille française dans la Manche. Villeneuve, qui commandait l'escadre sortie de Toulon, s'attarda, à son retour des Antilles, le long de la cote d'Espagne. Il fut bloqué à Cadix par les Anglais. Napoléon lui envoya l'ordre d'agir avec plus de vigueur. Il quitta donc Cadix escorté par une escadre espagnole que commandait l'amiral Gravina.
Au Ministre.
5 novembre 1805.
À bord de la frégate anglaise l'Euryalus.
DANS la situation où j'ai le malheur de me trouver, Votre Excellence ne peut attendre de moi qu'un rapport fidèle des événements qui ont suivi mon départ de Cadix, exempt de toute observation sur les motifs qui ont dirigé mes mouvements. J'ai eu l'honneur de vous écrire jusqu'au dernier moment de ma sortie de la baie de Cadix et c'est de ce moment même que je dois reprendre ma narration.
Le 20 octobre, à midi, toute l'armée combinée était sous voiles, dirigeant sa route à l'ouest-nord-ouest, le vent frais de la partie du sud-sud-ouest. J'ai fait le signal de prendre les ris que comportait l'apparence du temps et de la mer. Vers les quatre heures du soir, le temps s'étant éclairci et le vent ayant changé, j'ai pris les amures à tribord, manœuvré pour rallier quelques vaisseaux qui étaient tombés très sous le vent et signalé l'ordre de marche sur trois colonnes, l'escadre d'observation prenant la droite de l'armée combinée. Je n'avais connaissance que de deux frégates ennemies dans le sud, que j'ai donné ordre aux frégates de l'armée de chasser. La nuit est venue sans que j'aie eu connaissance de l'escadre ennemie et j'ai continué la même route, en proportionnant ma voilure sur celle des plus mauvais voiliers de l'armée combinée. À sept heures et demie du soir, j'ai vu des signaux en avant que je ne pouvais pas distinguer, et à huit heures et demie l'Argus est venu me dire de la part de l'amiral Gravina que le vaisseau l'Achille avait eu connaissance, à l'entrée de la nuit, de dix-huit vaisseaux ennemis dans le sud-sud-ouest. J'ai couru ainsi toute la nuit sans changer de direction. Nous avons eu connaissance des feux et des signaux de l'ennemi dans le vent à nous. Dès que le jour s'est fait, nous avons aperçu l'ennemi à l'ouest au nombre de trente-trois voiles, à la distance d'environ deux lieues et demie. Le cap Trafalgar a été aussi aperçu à l'est-sud-est, à quatre lieues. J'ai fait signal aux frégates d'aller reconnaître l'ennemi et à l'armée de former la ligne de bataille, tribord amures, ordre naturel. L'amiral Gravina a en même temps fait à l'escadre d'observation celui de se placer à la tête de l'armée combinée. Le vent très faible à l'ouest ; la mer très houleuse.
L'escadre ennemie, qui a été bientôt reconnue composée de vingt-sept vaisseaux de ligne, me paraissait se diriger en masse sur mon arrière-garde, avec le double motif de la combattre avec avantage et de couper à l'armée combinée sa retraite sur Cadix. Mon seul objet était de garantir l'arrière-garde des efforts de la totalité des forces de l'ennemi. Dans le nouvel ordre signalé, la troisième escadre, sous les ordres du contre-amiral Dumanoir, formait l'avant-garde, ayant pour chef de file le vaisseau espagnol le Neptuno, commandé par don Gaetano Valdes, officier estimé. J'étais au centre, avec la première escadre, sur le Bucentaure; le lieutenant général don Alava suivait avec la deuxième escadre ; et l'escadre d'observation, sous les ordres de l'amiral Gravina, formait l'arrière-garde de l'armée, ayant sous lui le contre-amiral Magon, sur le vaisseau l'Algésiras.
L'ennemi continuait à faire porter sur nous toutes voiles dehors, et, à neuf heures, je commençais à distinguer qu'il se développait sur deux colonnes, dont l'une se dirigeait sur mon vaisseau amiral et l'autre sur l'arrière de l'armée. Le vent était très faible, la mer houleuse, et notre formation s'effectuait avec beaucoup de peine ; mais dans le genre d'attaque que je prévoyais que l'ennemi allait nous faire, cette irrégularité même dans notre ligne ne me paraissait pas un inconvénient, si chaque vaisseau eût continué à serrer le vent sur son matelot et l'eût conservé à petite distance. J'ai fait néanmoins au vaisseau de tête le signal de serrer le vent et de forcer de voiles, pour éviter que l'engorgement ne fût trop grand, et à onze heures, signal à l'arrière-garde de tenir le vent pour la mettre ci même de couvrir le centre de l'armée qui paraissait être le point sur lequel l'ennemi semblait vouloir porter ses plus grands efforts. Cependant l'ennemi approchait sensiblement, quoique le vent fût extrêmement faible. Il avait à la tête de ses colonnes ses plus forts vaisseaux; celle du nord avait en tête quatre vaisseaux à trois ponts. À midi j'ai fait le signal de commencer le combat, dès qu'on serait à portée, et, à midi un quart, les premiers coups de canon ont été tirés des vaisseaux le Fougueux et la Santa Anna, sur le vaisseau le Royal Sovereign, chef de file de la colonne ennemie de droite, portant le pavillon du vice-amiral Collingwood. Le feu a été interrompu un moment; il a repris un instant après avec plus de vivacité par tous les vaisseaux qui ont été à portée de le faire, ce qui n'a pas empêché ce vaisseau ennemi de couper la ligne en arrière de la Santa Anna. La colonne de gauche, conduite par le Victory, portant le pavillon de l'amiral Nelson, faisait la même manœuvre et paraissait vouloir couper en arrière de la SantisimaTrinidad et sur l'avant du Bucentaure ; mais, soit qu'il ait trouvé la ligne trop serrée sur ce point, ou qu'il ait changé d'avis pour tout autre motif, il était à demi-portée de pistolet et nous étions prêts à l'aborder, les grappins prêts à être jetés, quand il a lancé tout sur tribord et il est venu pour passer à poupe du Bucentaure. Le Redoutable occupait derrière moi la place du Neptune (ce vaisseau était tombé sous le vent) ; il a honorablement rempli le devoir d'un vaisseau matelot d'arrière d'un pavillon amiral. Il a abordé le Victory, mais cela n'a pas empêché que, par la faiblesse du vent qui rendait tous les mouvements lents et difficiles, ce vaisseau, qui était entraversé sous la poupe du Bucentaure, ne lui ait envoyé plusieurs bordées à triple charge qui ont été extrêmement meurtrières et destructives. C'est dans ce moment que j'ai fait le signal aux vaisseaux qui, par leur position actuelle, ne combattaient pas, d'en prendre une quelconque qui les ramène promptement au feu. Il m'était impossible de distinguer l'état des choses au centre et à l'arrière-garde, par la grande fumée qui nous enveloppait. Au vaisseau le Victory avaient succédé deux autres vaisseaux à trois ponts et plusieurs vaisseaux de 74, qui défilaient lentement sur l'arrière du Bucentaure, quand le grand mât et celui d'artimon sont tombés. Les vaisseaux qui m'avaient ainsi passé à poupe me prolongeaient sous le vent, sans qu'ils eussent beaucoup à souffrir du feu de nos batteries, une grande partie de nos canons étant déjà démontés et d'autres engagés par la chute des mâts.
Dans un moment d'éclaircie, je m'aperçus que tout le centre et l'arrière-garde de l'armée avaient plié, et que je me trouvais le vaisseau le plus au vent. Le mât de misaine qui nous restait pouvait faciliter notre retraite sous le vent où se trouvaient plusieurs de nos vaisseaux qui ne paraissaient pas endommagés, mais il finit par tomber. J'avais fait conserver un canot à la mer, prévoyant le cas d'un démâtement et dans l'intention de me transporter sur un autre vaisseau. Dès que le grand mât eut tombé, j'ordonnai de le faire réparer; mais soit qu'il ait été coulé par les boulets ou écrasé par la chute des mâts, il ne fut pas retrouvé. Je fis héler à la Santisima Trinidad qui était en avant à nous, si elle pouvait envoyer un canot et nous donner une remorque. Je n'en eus pas de réponse. Ce vaisseau était lui-même fortement engagé avec un vaisseau à trois ponts qui le canonnait en hanche. Enfin, étant environné de vaisseaux ennemis qui s'étaient accumulés sur les hanches, sur l'arrière et par le travers sous le vent, étant dans l'impossibilité de leur faire aucun mal, les gaillards et la batterie de 24 étant abandonnés, jonchés de morts et de blessés, toute la première batterie démontée ou embarrassée par les gréements et les mâts qui étaient tombés, le vaisseau isolé au milieu des vaisseaux ennemis, sans mouvement et dans l'impossibilité de lui en donner, il fallut céder à ma destinée et arrêter une effusion de sang déjà immense et désormais inutile.
Toute la partie de l'armée en arrière du Bucentaure, comme je l'ai dit, avait plié, plusieurs vaisseaux étaient démâtés; quelques-uns combattaient encore en faisant leur retraite sur un gros de vaisseaux qui me restaient à l'est. Les vaisseaux de l'escadre du contre-amiral Dumanoir qui avaient couru en avant paraissaient manœuvrer; plusieurs des vaisseaux qui la composaient arrivaient pour se rallier aux vaisseaux le plus sous le vent, tandis que cinq autres viraient de bord et prenaient les amures à tribord. Ces vaisseaux ont passé au vent des deux armées en échangeant des coups de canon, le plus souvent à grande distance. Le dernier de ces cinq vaisseaux, qui était, je crois, le Neptune, espagnol, un peu plus sous le vent que les autres, a été obligé de se rendre.
Dans le genre d'attaque que l'ennemi a fait sur nous, il en devait résulter un pêle-mêle et une réunion de combats partiels qui ont été soutenus avec la plus noble audace. L'ennemi doit ses avantages à la force de ses vaisseaux (dont sept à trois ponts, et dont le moindre ne porte pas moins de 114 bouches à feu) ; à la force de son artillerie toute de gros calibre, au moyen de ses caronades ; à l'ensemble, à la célérité de ses manœuvres ; à l'expérience de trois ans de mer sans interruption, expérience qui manquait entièrement à une grande partie de l'armée combinée. Le courage et le dévouement à la patrie et à l'Empereur des états-majors et équipages des vaisseaux de Sa Majesté ne pouvaient être surpassés ; il s'est manifesté au signal de mettre sous voiles, à celui de se préparer au combat, par les applaudissements et les cris de vive l'Empereur ! dont ces signaux ont été accueillis. Je n'ai pas vu un homme ébranlé à la vue de la formidable colonne de l'ennemi précédée de quatre vaisseaux à trois ponts qui se dirigeait sur le vaisseau le Bucentaure. Je ne doute pas, Monseigneur, que vous n'ayez déjà recueilli les traits les plus honorables de la valeur qui a été déployée dans cette journée malheureuse, par les rapports qui ont dû déjà vous être adressés par les différents chefs qui se sont trouvés à portée de le faire. Tant de courage et de dévouement méritait une meilleure destinée, mais le moment n'était pas encore arrivé où la France aura à célébrer ses succès maritimes, ensemble avec ses victoires sur le continent. Quant à moi, Monseigneur, profondément pénétré de toute l'étendue de mon malheur et de toute la responsabilité que comporte un aussi grand désastre, je ne désire rien tant que d'être bientôt à même d'aller mettre aux pieds de Sa Majesté, ou la justification de ma conduite, ou la victime qui doit être immolée, non à l'honneur du pavillon qui, j'ose le dire, est demeuré intact, mais aux mânes de ceux qui auraient péri, par mon imprudence, mon inconsidération ou l'oubli de quelqu'un de mes devoirs.
P. S. — J'ai été enlevé de mon vaisseau dès qu'il a été rendu, et conduit sur un vaisseau ennemi avec le capitaine Magendie, l'adjudant-commandant Contamine, un lieutenant de vaisseau, M. Baudran, et un aspirant attaché à mon état-major général. Le capitaine Magendie, le chef d'état-major Prégny, MM. Dandignon, lieutenants de vaisseau, Gaudran, id., ont été blessés ; presque tous ceux qui étaient sur le pont ont été tués ou blessés. Il m'est impossible de donner d'autres renseignements sur le nombre des morts et blessés du Bucentaure et des autres vaisseaux de l'armée, mais il a dû être très considérable. Votre Excellence aura reçu tous les renseignements nécessaires par les officiers arrivés à Cadix. Aucun des vaisseaux français pris par l'ennemi (le Swiftsure excepté) n'ont pu être relevés de la côte, dans le coup de vent qui a suivi l'action ; tous étaient entièrement démâtés et extrêmement maltraités dans toutes leurs autres parties.
Le Swiftsure et trois autres vaisseaux espagnols ont été conduits à Gibraltar; un seul, le San Juan Nepomuceno, qui n'était pas démâté, pourra être remis en état de servir.
L'ennemi a fait des pertes très sensibles, entre autres celle de l'amiral lord Nelson et de plusieurs officiers marquants. La plus grande partie de cette flotte est obligée de rentrer dans les ports de l'Angleterre pour s'y réparer.
AMIRAL VILLENEUVE.
Dernière lettre de Villeneuve
Villeneuve revint en France en avril 1806. Il débarqua à Morlaix et prit aussitôt le chemin de Paris. Arrivé à Rennes, il écrivit à Decrès pour l'informer de son retour et le prévenir qu'il attendait sa réponse avant de continuer sa route. Le 21 avril, n'ayant rien reçu du ministre, il se crut à jamais déshonoré, et il prit la funeste résolution de se tuer d'un coup de poignard. On trouva sur sa table la lettre suivante adressée à sa femme.
Ma tendre amie, comment recevras-tu ce coup, hélas ! Je pleure sur toi plus que sur moi. C'en est fait, je suis arrivé au terme où la vie est un opprobre et la mort un devoir. Seul ici, frappé d'anathème par l'Empereur, repoussé par son ministre qui fut mon ami, chargé d'une responsabilité immense dans un désastre qui m'est attribué et auquel la fatalité m'a entraîné, je dois mourir! Je sais que tu ne peux goûter aucune apologie de mon action. Je t'en demande pardon, mille fois pardon, mais elle est nécessaire et j'y suis entraîné par le plus violent désespoir. Vis tranquille, emprunte les consolations des doux sentiments de religion qui t'animent ; mon espérance est que tu y trouveras un repos qui m'est refusé. Adieu, adieu, sèche les larmes de ma famille et de tous ceux auxquels je puis être cher.... Je voulais finir, je ne puis. Quel bonheur que je n'aie aucun enfant pour recueillir mon horrible héritage et qui soit chargé du poids de mon nom ! Ah! je n'étais pas né pour un pareil sort, je ne l'ai pas cherché, j'y ai été entraîné malgré moi.
Adieu, adieu!
Adieu, adieu!
Épisodes de Trafalgar
MAGON — INFERNET — LUCAS — COSMAO
LE contre-amiral Magon, qui monte l' Algésiras, de 74 canons, porte d'abord son vaisseau en avant pour fermer le chemin aux Anglais qui veulent couper la ligne. Dans ce mouvement il rencontre le Tonnant, de 80 canons, autrefois français, devenu anglais à Aboukir. Il engage son beaupré dans les haubans du vaisseau ennemi. Le carnage est horrible : le canon ne cesse de tonner dans les batteries, pendant que des deux ponts on se fusille.
Magon rassemble autour de lui ses plus vigoureux matelots pour les mener à l'abordage. Mais il leur arrive ce qui est arrivé déjà à d'autres équipages. Sur le point de s'élancer sur le pont ennemi, ils essuient d'un autre vaisseau anglais placé en travers plusieurs décharges à mitraille qui abattent un grand nombre d'entre eux. Il faut alors, avant de songer à continuer l'abordage, riposter au nouvel ennemi qui est survenu et à un troisième qui va se joindre aux deux autres pour canonner l'Algésiras.
Pendant qu'il se défend contre trois vaisseaux, Magon est abordé par l'équipage du Tonnant. Il le reçoit à la tête de ses matelots, et lui-même, une hache d'abordage à la main, il repousse les Anglais. Son capitaine de pavillon, Letourneur, est tué à ses côtés. Magon, que son uniforme désigne aux coups de l'ennemi, reçoit une balle au bras. Il ne tient aucun compte de cette blessure et reste à son poste. Un second projectile vient l'atteindre à la cuisse. Ses forces commencent à l'abandonner. On le supplie de descendre au poste des blessés. Il se rend aux prières qu'on lui adresse. Appuyé sur deux matelots, il descend dans le faux pont. Mais les flancs déchirés du navire donnent un libre passage à la mitraille. Magon reçoit un biscaïen dans la poitrine et tombe foudroyé sous ce dernier coup.
Il ne tient aucun compte de cette blessure et reste à son poste. Un second projectile vient l'atteindre à la cuisse. Ses forces commencent à l'abandonner. On le supplie de descendre au poste des blessés. Il se rend aux prières qu'on lui adresse. Appuyé sur deux matelots, il descend dans le faux pont. Mais les flancs déchirés du navire donnent un libre passage à la mitraille. Magon reçoit un biscaïen dans la poitrine et tombe foudroyé sous ce dernier coup.
Sur 641 hommes qui montent l'Algésiras, 150 sont tués, 180 blessés. On est sans espoir, sans ressources, quand le pavillon est amené.
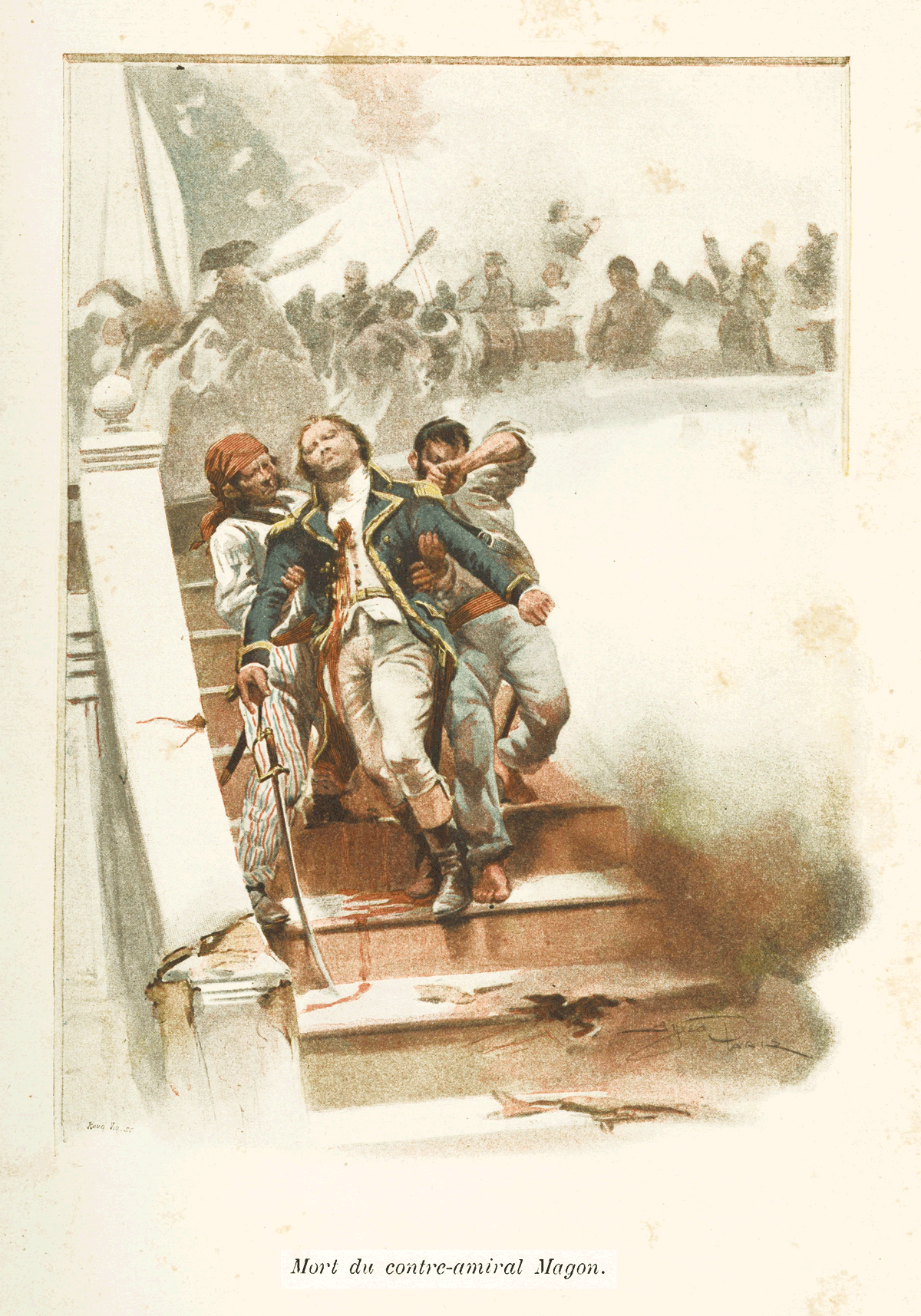
Infernet commande l'Intrépide, de 74 canons. Il a affaire à deux, puis à trois, puis à quatre et à cinq vaisseaux. Il est même, à certain moment, entouré par sept vaisseaux, qui tous, dit-il dans son rapport, « lui faisaient feu dessus ».
Commençant à couler, réduit comme mâture à son seul mat de vaisseau, l'Intrépide crible encore de ses coups un vaisseau de 120 canons. Infernet, sollicité de se rendre, en raison de l'impossibilité d'une plus longue défense, s'écrie indigné, en abattant d'un coup de sabre la pomme qui garnit une rampe d'escalier : « Le premier qui parle d'amener, je lui f... la tête à bas comme ça ».
La canonnade, la fusillade redoublent donc à bord de l'Intrépide; l'eau monte de plus en plus dans la cale. Ce n'est qu'au moment où le vaisseau va s'engloutir, qu'Infernet se décide à amener glorieusement son pavillon. Trois de ses officiers étaient tués, un autre blessé, la moitié de son équipage hors de combat.
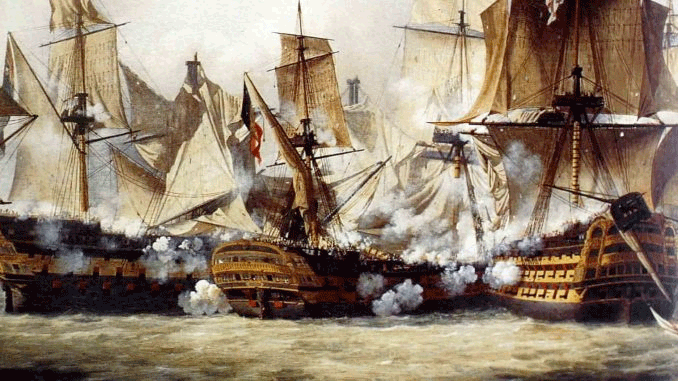
C'est d'une balle partie de la hune d'artimon du Redoutable que fut tué Nelson sur la dunette de son vaisseau.
Profitant de la confusion qui règne sur le Victory après la blessure de Nelson, Lucas, commandant du Redoutable, essaye de prendre le vaisseau ennemi à l'abordage. Déjà un aspirant et quatre matelots sont sur le pont anglais, et deux cents hommes vont les suivre ; mais le Téméraire, autre vaisseau à trois ponts, voyant la détresse de son amiral, se hâte de venir à son secours. Il range à tribord le vaisseau français et lui lâche à bout portant toute sa bordée. Elle fut désastreuse, tua ou mit hors de combat plus de deux cents hommes, blessa le brave Lucas, mais pas assez gravement pour lui faire abandonner son poste.
Ainsi serré entre deux vaisseaux à trois ponts, le Redoutable, avec les quelques pièces qui n'avaient pas été démontées et un équipage décimé, soutient encore la lutte. Mais voilà qu'un troisième vaisseau, le Neptune, vient à portée de pistolet le prendre en enfilade.
La résistance ne pouvait plus guère se prolonger, et le capitaine n'attendait, pour le faire cesser, que l'avis certain que son vaisseau allait couler. Quand cet avis fut apporté, il n'eut pas la douleur d'amener son pavillon, qui tomba avec son mât d'artimon. Tous les autres mâts étaient tombés.
« Après le combat, dit Lucas dans son rapport, les hauts étaient couverts de morts ensevelis sous les débris et les éclats des différentes parties du vaisseau. Presque toutes les pièces étaient démontées; l'une des murailles presque démolie ne formait plus qu'un sabord; le gouvernail était hors de service; plusieurs trous de boulets, placés à la ligne de flottaison, laissaient entrer dans la cale l'eau en abondance. Tout l'état-major était blessé : 10 aspirants sur 11 étaient frappés à mort. Sur 645 hommes d'équipage, 522 étaient hors de combat, parmi lesquels 500 morts et 222 blessés. Quiconque n'a pas vu dans cet état le Redoutable ne pourra jamais se former une idée de son désastre. »
Ce malheureux vaisseau était tellement maltraité que les Anglais ne purent le conduire comme trophée à Gibraltar et qu'il coula dans la nuit qui suivit la bataille, avec les blessés qui étaient restés à bord « et que leur courage avait rendus dignes d'un meilleur sort ».
« On n'a eu que le temps de retirer du vaisseau 119 Français, dont 70 blessés. » En définitive, il y eut 500 morts pendant le combat, 152 blessés noyés dans le naufrage, 74 valides noyés dans le naufrage, 49 valides sauvés et 70 blessés sauvés. Ce fut le combat le plus sanglant et le plus opiniâtre de tous ceux qui ont honoré la valeur des Français.
Napoléon reçut à Saint-Cloud, en 1806, devant toute sa cour, les deux plus glorieux marins de l'escadre, Lucas et Infernet. Il leur prodigua des égards touchants et c'est lui-même qui de ses mains leur mit autour du cou es insignes de commandant de la Légion d'honneur.
Le lendemain de la bataille, l'amiral espagnol Gravina met sous les ordres de Cosmao ceux des bâtiments qui l'ont suivi au mouillage de Rota et qui se trouvent en état d'appareiller. Les vents sont favorables. Aussi, quoique l'équipage du Pluton soit réduit à 500 hommes, quoique ce vaisseau fasse trois pieds d'eau à l'heure, Cosmao sort de la rade et prend le large. C'est avec deux vaisseaux français, deux espagnols, cinq frégates et deux corvettes qu'il se met à la poursuite de l'armée victorieuse. Il atteint les Anglais, les attaque et leur enlève deux bâtiments espagnols : un vaisseau de 80 et le Santa Anna de 110, monté par le brave amiral d'Alava, grièvement blessé dans la journée de la veille.
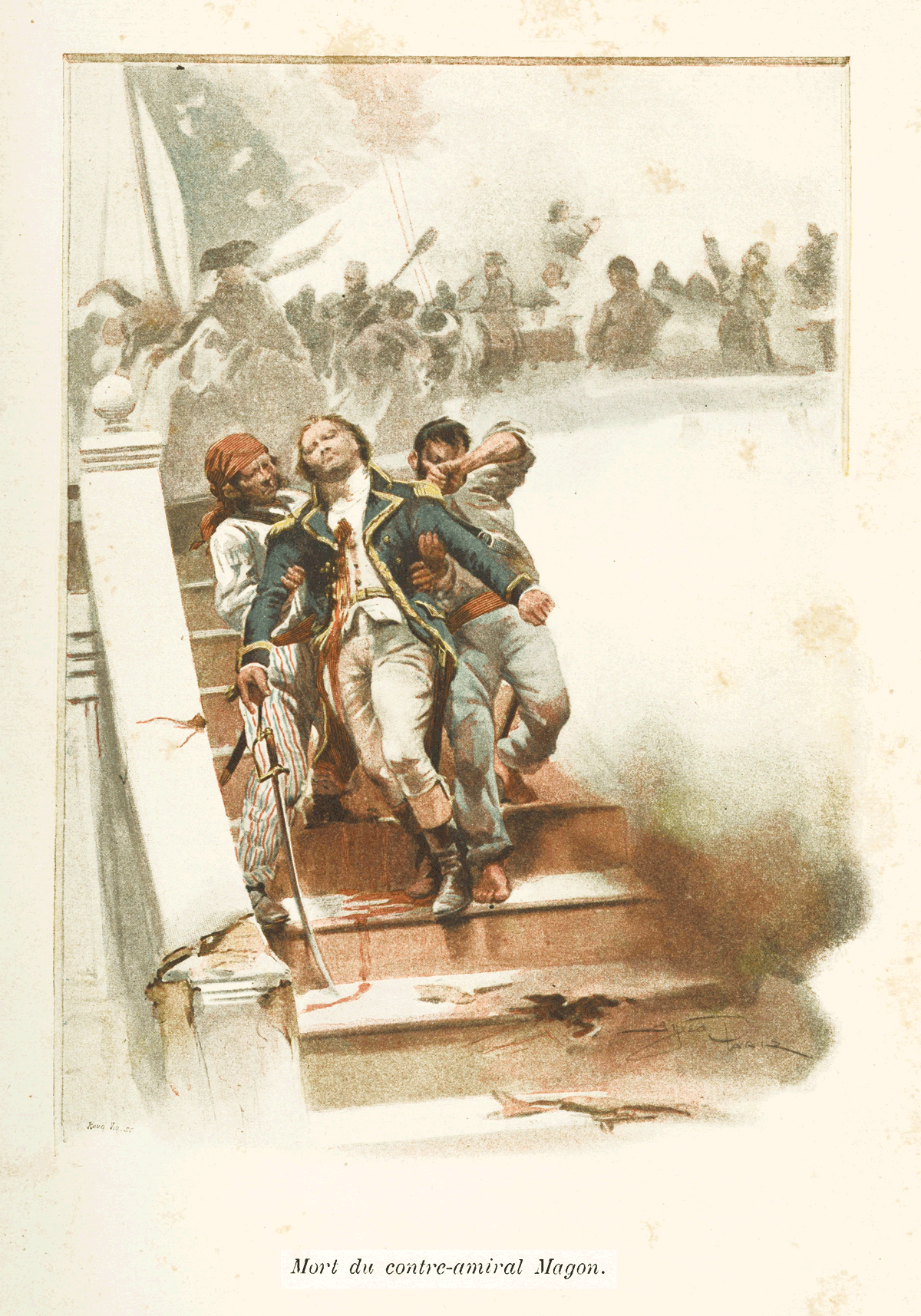
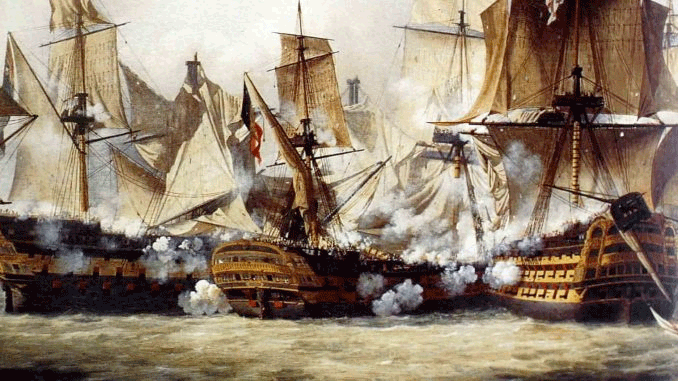
(Divers auteurs.)
Combat du cap Ortégal
(4 NOVEMBRE 1805)
Ce combat est, pour ainsi dire, l'épilogue de Trafalgar. Les quatre vaisseaux de Dumanoir, qui avaient échappé au désastre de la flotte de Villeneuve, essayèrent de regagner la France. Ce fut en vain.
LE 11 brumaire dernier (2 novembre), nous rencontrâmes, à la hauteur du cap Ortégal, près du Ferrol, deux frégates anglaises qui nous donnèrent la chasse tout le jour ; puis, dans la soirée, à la faveur d'une brume mêlée de pluie qu'accompagnait un vent assez fort, on nous fit virer de bord et faire route pour la France. Le lendemain, 3 novembre, à dix heures, la brume disparaît, le vent se calme, nous découvrons l'ennemi. Malheureusement le vaisseau-amiral le Formidable marchait très mal, et l'escadre anglaise nous gagnait. Le soir, une frégate était à portée de canon, mais elle n'ouvrit pas le feu. Elle chercha, mais vainement, à engager le combat, le lendemain, 13 brumaire (4 novembre).
Nous continuions donc notre route, lorsque nous fûmes attaqués, d'abord par trois vaisseaux et deux frégates, puis par un autre vaisseau accompagné d'une frégate; en tout quatre vaisseaux et quatre frégates contre quatre navires déjà éprouvés par les boulets de l'ennemi et par une tempête de plus de huit jours. Le contre-amiral fit des signaux ordonnant de former une ligne unique de bataille: toujours le même système déplorable!
Notre vaisseau, le Duguay-Trouin, à la droite du vaisseau-amiral, le Scipion et le Mont-Blanc à la gauche. Les Anglais, de leur côté, firent une manœuvre bien plus intelligente, qui consiste à séparer les navires ennemis les uns des autres, à les envelopper autant que possible et à les écraser en détail.
À quoi bon ces détails, chère amie? Pardonne-moi, c'est si cruel de se voir battus, écrasés, lorsque peut-être....
Enfin, nous nous sommes défendus avec l'énergie que donne le désespoir ; mais, toujours manœuvrant mal et avec une déplorable indécision ; l'ennemi, avec sa grande supériorité du nombre, le bon état de ses navires qu'il manœuvrait avec aisance, nous écrasait en mettant à profit notre faiblesse et nos erreurs. Sur notre vaisseau, le brave capitaine Touffet, tué dès le commencement du combat, avait été remplacé par le capitaine de frégate Boisanard, qui reçut lui-même une balle dans le genou. Les lieutenants de vaisseau Lavenu, Guillet, Cossé, Tocville, prirent successivement le commandement et furent assez gravement blessés pour être obligés de quitter le pont. Cependant, après avoir reçu les premiers pansements, le lieutenant Guillet, qui avait eu la joue traversée par une balle, reprit son poste de commandant de notre malheureux Duguay-Trouin, tout désemparé, faisant eau, écrasé par le feu de deux vaisseaux et des frégates. Ce n'était plus de la guerre, comme on la doit entendre, c'était une tuerie abominable : les trois quarts de ma compagnie là ..., autour de moi; mon pauvre lieutenant Le Deyeux, râlant à quelques pas, et tant d'autres!
Mon cœur se brise en te racontant ce désastre; il est si récent et nous sommes si malheureux ! J'ai hâte d'en finir avec cet horrible tableau.
À quatre heures, toute la mâture de l'arrière s'abattit, et, avec elle, le pavillon. Ce fut la fin de la lutte. Nous nous sommes rendus les derniers. Bien certainement sur les trois autres vaisseaux on a fait comme sur le nôtre, et l'on s'est défendu jusqu'à la dernière extrémité.
Nous avons fait plus de mal aux hommes de l'ennemi qu'à ses navires. Nos canonniers ne savaient guère que se faire tuer.
Je reprends mon récit :
Restés à bord de notre vaisseau, on nous a dirigés sur Plymouth, où nous sommes arrivés le 9 novembre. Les officiers anglais, je leur dois cette justice, ont été convenables avec nous pendant la traversée; mais ils ne tardèrent pas, dans un esprit de vengeance peu digne d'une grande nation, à nous faire payer très cher le bien-être relatif qu'ils nous avaient accordé! En effet, le 17 novembre dernier, nous avons été jetés pêle-mêle avec les soldats, dans un abominable ponton dont l'état de vétusté est repoussant, contraints à coucher sur le plancher, faute de place pour suspendre des hamacs.
Quel air empesté nous respirons! Cinq cents hommes entassés dans un espace aussi restreint, n'ayant pour se promener et prendre l'air, pendant quelques heures, que la moitié du bâtiment. Comme nourriture, on nous donne ce qui est rigoureusement indispensable pour ne pas mourir de faim ! Un détail : distribués par escouades de six hommes, sans distinction de grades, nous sommes obligés d'aller à la cuisine recevoir notre portion, qu'on extrait d'une grande marmite servant à tous. [Qu'on n'oublie pas que c'est un officier qui écrit cela.]
Pour boisson, de l'eau plus ou moins pure. On peut se procurer de la bière, fort mauvaise en la payant très cher. Le commandant, par des motifs de prudence sans doute, a interdit qu'on en apportât de bonne qualité.
À trois heures du soir, on nous fait sortir de notre infecte prison et monter sur le gaillard d'avant. Pendant notre court séjour à l'air libre, des soldats, munis de lanternes allumées et de marteaux, descendent dans la cale afin de s'assurer qu'il n'a pas été fait de trous dans la coque du ponton, et pour constater que les barreaux placés sur les sabords n'ont pas été rompus. Après cette opération, qui n'est terminée que vers quatre heures, on nous oblige à redescendre en nous comptant; puis toutes les portes fermant les issues sont cadenassées et verrouillées. Il en est de même pour les sabords. Nous restons ainsi jusqu'au lendemain matin sept heures. Nous sommes tellement nombreux que, vers le soir, la chaleur devient intense et nous accable.
Je m'arrête. Que pourrais-je ajouter? Sinon que chaque jour ressemble à celui qui l'a précédé ! Cette existence, malgré notre énergie, ne serait pas tolérable, si, comme officiers, nous n'avions pas l'espoir de voir bientôt cesser à notre égard ce traitement indigne, et d'aller « au cautionnement ", c'est-à-dire d'être internés dans une ville, et d'y séjourner sur parole comme prisonniers de guerre....
GEMAHLING,
officier du "Duguay-Trouin".
Les pontons d'Angleterre
On vient de lire dans le récit qui précède quelques détails concernant la vie des malheureux prisonniers que nos ennemis entassaient sur les pontons de Plymouth. Voici d'autres détails plus circonstanciés.
CE fut une idée bien cruelle, que celle de transformer un vaisseau de guerre en un vaste cachot de prisonniers. À terre, les immenses prisons de guerre, avec leur triple mur d'enceinte, n'offraient que trop souvent aux captifs la facilité de tromper la surveillance d'une garnison nombreuse et l'inquiète activité des geôliers. Mais à bord d'un vaisseau de ligne, bien mouillé dans une rivière, désarmé de tous ses canons, mais grillé à tous ses sabords, et gardé jour et nuit par d'actives sentinelles, la surveillance devenait plus sûre et plus commode; et là, sans beaucoup de frais, on pouvait ensevelir pendant toute la guerre six à huit cents prisonniers trop serrés les uns contre les autres dans un espace aussi étroit pour se livrer à des tentatives d'évasion, et trop bien gardés individuellement pour se permettre de comploter contre la sûreté des sbires chargés de réprimer les moindres mouvements qui auraient eu pour but la désertion de quelques-uns d'entre eux.
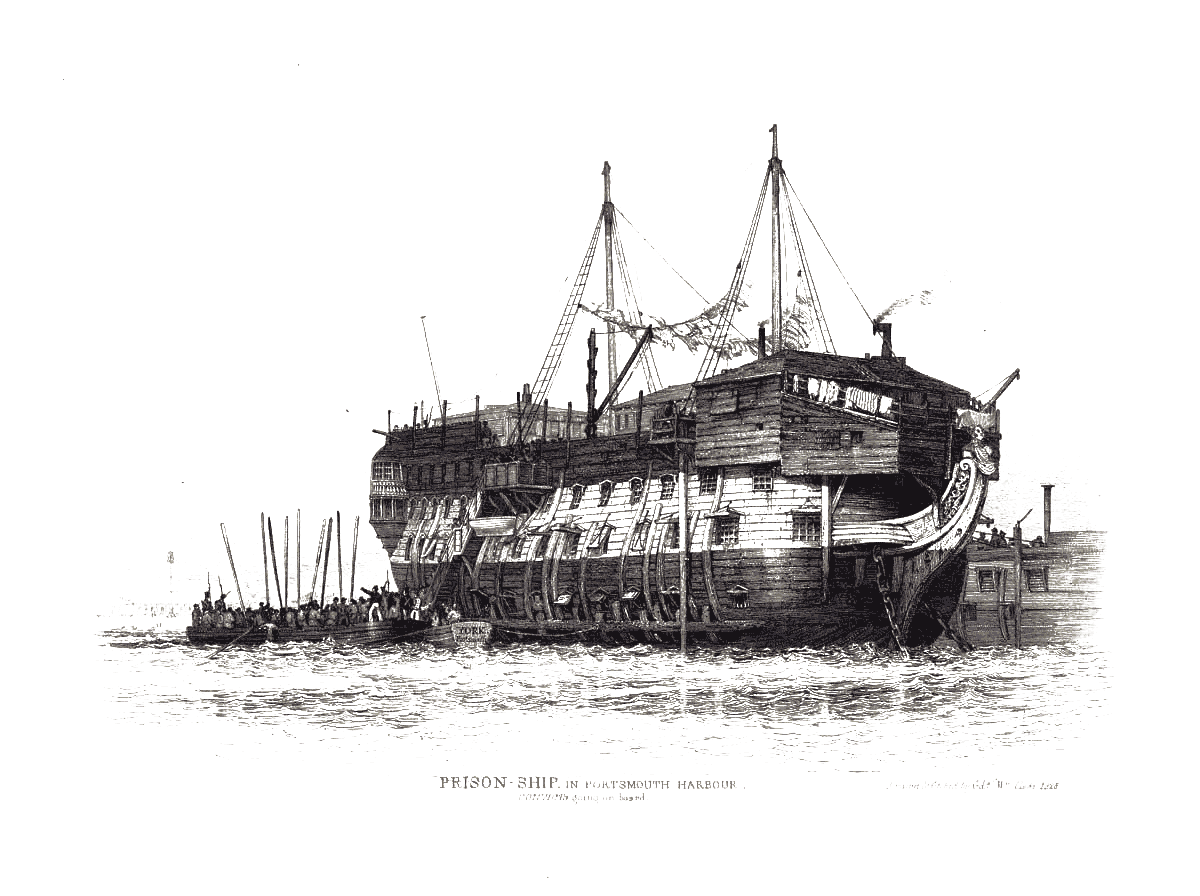 L'aspect seul des pontons anglais révélait à nu toutes les misères, toutes les souffrances dont ces sépulcres flottants étaient devenus le théâtre. Un vaisseau dégréé, sans voiles, sans artillerie, mais pourvu à tous ses sabords d'énormes barreaux de fer à travers lesquels des figures hâves et amaigries cherchaient à respirer l'air qui s'exhalait des marais du rivage, tel était le spectacle sinistre qu'offrait chacun des pontons de Chatham, de Portsmouth, ou de Plymouth !
L'aspect seul des pontons anglais révélait à nu toutes les misères, toutes les souffrances dont ces sépulcres flottants étaient devenus le théâtre. Un vaisseau dégréé, sans voiles, sans artillerie, mais pourvu à tous ses sabords d'énormes barreaux de fer à travers lesquels des figures hâves et amaigries cherchaient à respirer l'air qui s'exhalait des marais du rivage, tel était le spectacle sinistre qu'offrait chacun des pontons de Chatham, de Portsmouth, ou de Plymouth !
Au-dessus des ponts et des gaillards de ces vastes cachots, on avait élevé des toitures informes destinées à servir d'abri pendant le jour aux malheureux qui venaient demander un peu d'air après avoir épuisé toutes leurs forces à lutter durant la nuit contre l'atmosphère infecte des batteries ou de la cale.
À chaque instant, l'officier commandant le ponton faisait compter et recompter ses prisonniers pour prévenir ou constater les désertions qu'il redoutait de la part de ces infortunés toujours prêts à exposer leur vie pour tenter le moyen de fuir leurs inflexibles geôliers. D'heure en heure les barreaux de fer des sabords étaient visités, sondés, heurtés dans tous les sens, comme dans les bagnes on heurte, on sonde l'anneau que les forçats traînent aux pieds, et qu'ils essaient sans cesse de limer ou de rompre pour échapper aux gardes qui les suivent sans cesse.
 Mais, quelque scrupuleuse et quelque prévoyante que fût la surveillance des geôliers anglais, l'adresse des prisonniers était encore plus ingénieuse, et les moyens qu'ils employaient pour s'affranchir de leur prison parvenaient quelquefois à vaincre et à surmonter les moyens qu'on mettait en usage pour les y retenir.
Mais, quelque scrupuleuse et quelque prévoyante que fût la surveillance des geôliers anglais, l'adresse des prisonniers était encore plus ingénieuse, et les moyens qu'ils employaient pour s'affranchir de leur prison parvenaient quelquefois à vaincre et à surmonter les moyens qu'on mettait en usage pour les y retenir.
Les personnes qui n'ont jamais connu le tourment d'une longue et intolérable captivité, se feraient difficilement une idée des efforts surhumains que peuvent tenter les captifs pour sortir, ne fût-ce qu'un instant, du cachot où se consume leur vie; l'homme qui une fois rendu à la liberté emploierait pour s'élever dans le monde la moitié des ressources qu'il a trouvées dans son génie pour se soustraire à la prison, parviendrait à coup sûr aux sommités de la fortune ou de la gloire. Mais, par une des infirmités attachées à la faiblesse de notre espèce, ce n'est guère qu'au sein de la captivité que les efforts extrêmes et les volontés constantes sont possibles.
Faire un trou pour déserter d'un ponton, c'était faire un chef-d'œuvre de ruse, de patience et de génie.
Et c'était là ce que faisaient les moindres prisonniers !
Un treillage en bois s'élevait extérieurement sur le flanc de chaque ponton à dix-huit pouces environ au-dessus de la mer. Sur ce treillage veillaient nuit et jour des sentinelles attentives au moindre bruit, au moindre mouvement, au moindre souffle ....
Lorsque la nuit environnait, de calme et de silence le ponton dans lequel dormaient les prisonniers, et le rivage gardé par une nombreuse garnison et les flots tranquilles qu'effleurait la brise, on ne pouvait jeter un cri, fredonner une chanson, dire une parole qui ne fût entendue par les sentinelles, recueillie comme un indice alarmant par les hommes de quart, et dénoncée bientôt comme le signal d'une révolte générale.
Et c'est cependant sous ce treillage où les factionnaires veillaient immobiles, que se minait et que s'ouvrait le trou par lequel se glissaient les déserteurs pour plonger silencieusement dans les flots et gagner le bord, pourvus seulement du petit sac en cuir qui contenait leurs effets ! ...
Pour parvenir à percer ce trou, que de soins, d'adresse, il fallait employer ! Que de peines surtout il fallait se donner pour le cacher précieusement à la surveillance des geôliers, pendant le travail ! Voyez un vaisseau de ligne, mesurez l'épaisseur de son échantillon, de ses bordages extérieurs et intérieurs, la grosseur de sa membrure ; eh bien, c'était tout cela que l'on perçait, non pas avec des haches et des scies, mais avec de simples couteaux, de petits canifs, la seule arme, les seuls instruments qu'on laissât aux mains suspectes des captifs.
Et, lorsque, à force de travail, de patience et de précautions, on était parvenu à pratiquer le trou, le cuivre de la flottaison du vaisseau se présentait un peu au-dessus de l'eau, et au-dessous des pieds mêmes de la sentinelle placée sur le treillage.
C'était encore un obstacle à vaincre, une feuille de métal à user, plus par le frottement que par une section brusque. Percé trop près du ras de l'eau, le trou aurait fait couler le vaisseau. Percé trop près du treillage des sentinelles, l'éveil aurait été donné à toute la garde du ponton. C'était sur l'endroit favorable, entre ces deux dangereuses extrémités, qu'il fallait tomber. Que de combinaisons, de calculs et de bonheur, pour ne réussir qu'à obtenir la chance de se laisser glisser dans l'eau, ou de se faire fusiller en nageant vers un rivage hérissé de factionnaires et de sbires !
Le trou ainsi pratiqué par quelques prisonniers appartenait de droit à ses auteurs. C'était à eux qu'était réservé le privilège d'y passer les premiers. Une fois ce droit passé en usage, il devenait la propriété commune de tous les captifs. Mais pour mettre plus d'ordre et d'économie de temps dans la désertion de ceux qui voulaient se résigner, on tirait les tours au sort, et puis on jouait quelquefois aux dés les bons numéros de sortie; car le jeu se mêlait partout dans les habitudes des prisonniers. C'est le compagnon obligé de toutes les situations qui démoralisent notre nature.
Pour peu qu'un trou fût découvert, l'alarme était donnée par les sentinelles. Tous les Anglais alors se trouvaient sur pied en une minute. Les embarcations du bord, sans cesse disposées à être amenées, étaient mises à l'eau pour faire le tour du ponton. On allumait les fanaux. On comptait et l'on recomptait vingt fois les prisonniers, réveillés le plus souvent en sursaut; et si par hasard dans leur revue nocturne les embarcations découvraient à la surface des flots quelque malheureux plongeant pour se soustraire à leur poursuite, c'était une chasse à coups de fusil qu'on lui donnait, et quelquefois on ne ramenait à bord qu'un cadavre percé de balles, au lieu du fugitif qu'on avait voulu saisir.
Le moyen de déserter en limant ou en démantelant sur leurs bases les barreaux de fer des sabords avait été d'abord employé avec succès dans les premières années de la captivité à bord des pontons. Mais ces tentatives répétées avaient fini par provoquer une telle surveillance de la part des Anglais, que l'expédient était devenu impossible. C'était un trou dans le vaisseau qu'il fallait creuser pour avoir quelque chance de succès, et quel succès !
La communauté du malheur et la solidarité des souffrances sont les choses les plus propres à fortifier l'esprit de corps chez les hommes que la même adversité rassemble. Les Anglais employaient tous les moyens de corruption qu'ils pouvaient mettre en usage pour trouver dans les prisonniers les plus misérables des traîtres disposés à leur révéler les projets d'évasion de leurs camarades. Mais, malgré l'or et la séduction des Anglais, il arrivait fort rarement qu'ils pussent trouver un captif qui leur vendit un trou. Car il y avait une religion à bord des pontons et pour ainsi dire un fanatisme. Cette religion était l'amour de ses compatriotes, ce fanatisme celui de la liberté pour soi et pour les autres.
Le châtiment réservé aux traîtres était du reste aussi prompt et aussi cruel que leur crime avait été lâche. Le traître qui venait à être découvert était mis en lambeaux par ceux qu'il avait vendus et livrés à leurs ennemis.
Cette législation barbare n'était pas celle de la férocité seule, du grand nombre sur la faiblesse de l'individu, c'était celle de tous les sentiments de l'humanité révoltés par ce qu'il y avait de plus odieux pour les prisonniers : le crime d'avoir empêché des captifs de recouvrer ce qu'il y avait au monde de plus cher pour eux.
On cite dans l'histoire des pontons des évasions miraculeuses. Je n'en rappellerai qu'une : c'est celle qui m'a paru avoir été tentée avec le plus d'audace et consommée avec le plus de bonheur.
Un cutter chargé de poudre s'amarre le long d'un des pontons de Plymouth en attendant le jour pour aller porter des munitions de guerre au vaisseau l'Egmont mouillé en rade et disposé à appareiller.
Pendant la nuit un trou s'ouvre à bord du ponton. L'aspirant Larivière s'y fourre le premier : il est suivi par quatre ou cinq autres prisonniers, qui parviennent sans être vus à se glisser à bord du cutter, où ils trouvent tout l'équipage endormi soit dans la chambre de derrière, soit dans le logement de devant.
Ils se jettent dans cette chambre et le logement, en refermant sur eux les issues extérieures : ils garrottent ou étouffent les Anglais encore endormis, et, vêtus des habillements dont ils les dépouillent, ils remontent avec le point du jour sur le pont du Cutter ; l'aspirant à qui est déféré le commandement de la prise prie en anglais les hommes de quart à bord du vaisseau de larguer les amarres pour qu'il puisse appareiller, et le cutter met sous voiles pour se rendre en rade, sans que l'équipage du ponton ait pu remarquer le changement qui s'est opéré dans le personnel du cutter.
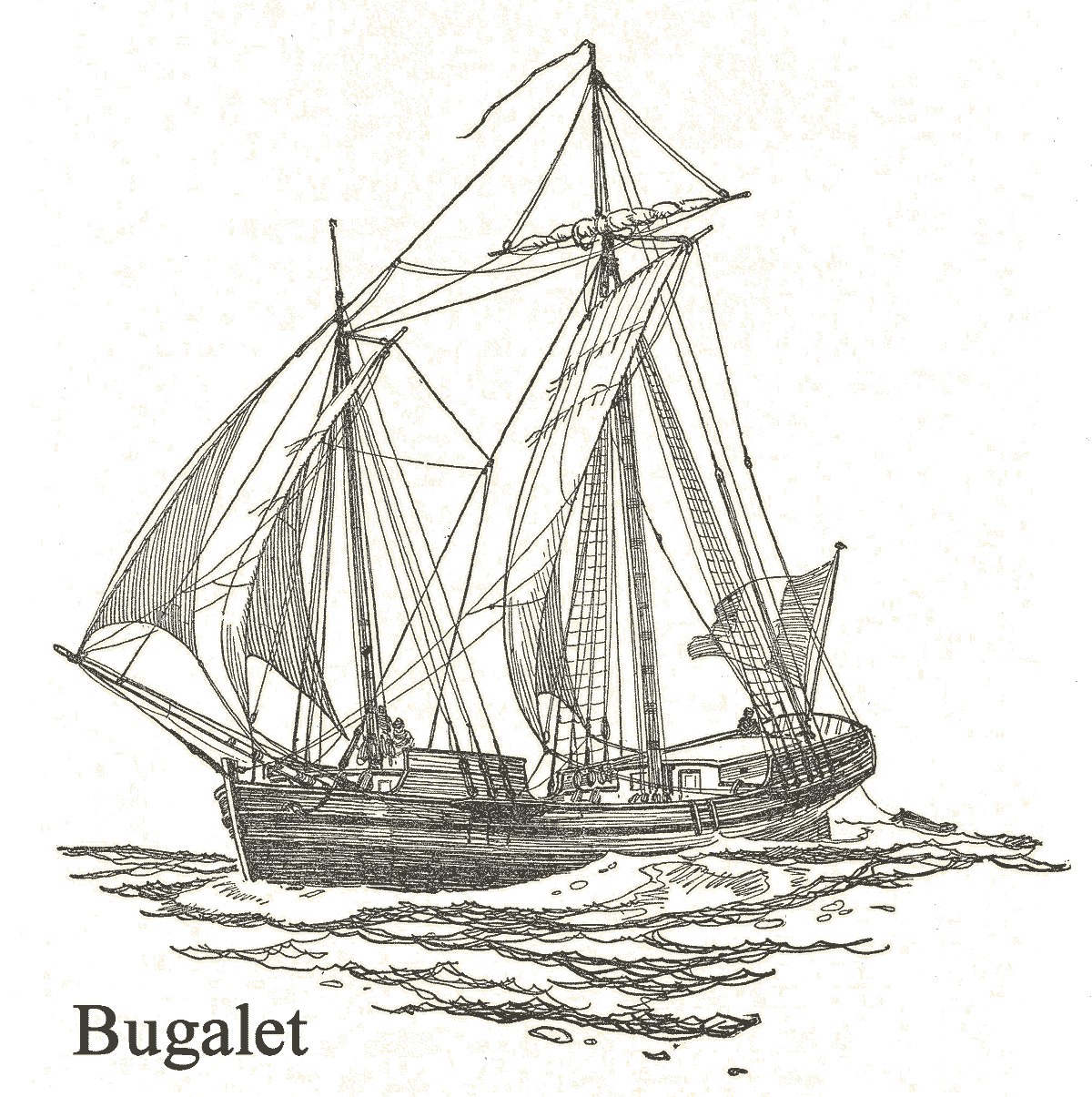 Rendu en rade à la faveur d'une forte brise, le cutter passe près du vaisseau auquel il doit remettre les poudres dont il est chargé. Le vaisseau même s'apprête à recevoir le bugalet le long de son bord. Mais à sa grande surprise, après un grain violent qui cache un instant tous les objets autour de lui, il voit le cutter courir au large sous toutes voiles.
Rendu en rade à la faveur d'une forte brise, le cutter passe près du vaisseau auquel il doit remettre les poudres dont il est chargé. Le vaisseau même s'apprête à recevoir le bugalet le long de son bord. Mais à sa grande surprise, après un grain violent qui cache un instant tous les objets autour de lui, il voit le cutter courir au large sous toutes voiles.
Cette manœuvre éveille les soupçons.
L'Egmont fait des signaux que l'on ne comprend pas bien à terre : des ordres sont bientôt donnés à des bâtiments légers qui peuvent poursuivre le cutter fugitif, et ce n'est que lorsque la nuit est venue que l'on peut se flatter d'atteindre le bâtiment chassé.
Mais il était trop tard. Le lendemain de sa fuite, le cutter de l'aspirant Luivière arriva à Roscoff avec ses prisonniers anglais encore garrottés et sa cale pleine des poudres destinées au vaisseau l'Egmont.
Ce fut non seulement avoir fait, comme disaient les prisonniers, un coup de liberté, mais encore un coup de fortune.
Les Anglais récompensaient ordinairement les beaux actes de dévouement des prisonniers envers leurs compatriotes à eux, en accordant la liberté à ceux qui s'étaient exposés le plus dans un incendie ou dans un naufrage. Un de mes amis, détenu depuis longtemps à bord d'un des pontons de Chatham, voulant mettre à profit la générosité de nos ennemis, parvient à force d'or à obtenir d'un factionnaire anglais qu'il se laissera tomber à l'eau pendant son service, pour lui offrir l'occasion de le sauver. La comédie ainsi arrangée entre les deux acteurs qui doivent la jouer s'exécute. La sentinelle tombe le long du bord, comme par maladresse. Le prisonnier se précipite sur elle : il nage comme un marsouin, et avec un peu de complaisance de la part du soldat, qui se laisse manier le plus commodément possible, l'Anglais, qui ne se noyait pas, est ramené victorieusement à bord par le Français, qui dans toute autre occasion n'aurait pas pris la peine de le sauver.
Huit jours après ce bel acte d'humanité, le prisonnier sauveur était en France, non sans avoir obtenu pour sa noble conduite une mention honorable dans tous les journaux d'Angleterre.
À bord du même ponton, quinze ou vingt hommes sont en train de passer par un trou que l'on a eu le bonheur de cacher à la surveillance des Anglais. Une foule de prisonniers se disposent à suivre ceux de leurs camarades qui ont déjà réussi dans leur projet d'évasion. Mais au moment même de la désertion des premiers prisonniers, il prend fantaisie au commandant du vaisseau de faire faire l'appel de son monde. Les prisonniers, dont le commis crie les noms, montent par le panneau de l'arrière pour répondre à l'appel et défilent devant le commis après avoir été marqués comme présents, puis ils s'en vont dans la batterie par le panneau de l'avant ; mais, au lieu de ne plus reparaître sur le pont, ils parviennent à revenir par le panneau de l'arrière comme ils l'avaient fait la première fois, pour répondre à l'appel à la place de leurs camarades déjà absents. Le commis, grâce à cet heureux stratagème, trouva son compte d'hommes, et ce ne fut que lorsqu'une cinquantaine de prisonniers eurent réussi à gagner le rivage, que l'on découvrit le trou par lequel ils s'étaient enfuis et la ruse que les amis avaient mise en usage pour donner le temps à leurs compagnons de s'évader pendant l'appel.
L'état-major des pontons anglais se composait d'un lieutenant qui commandait le vaisseau, d'un master faisant les fonctions de second, de quelques maîtres attachés au navire et de trois ou quatre aspirants de marine.
Une trentaine de matelots destinés à armer les embarcations, et soixante ou quatre-vingts soldats chargés du service du bord et de la garde des prisonniers sous les ordres d'un sous-officier composaient l'équipage.
Les prisonniers se couchaient dans des hamacs, que l'on dépendait chaque matin au coup de cloche. Quatre onces de pain gluant, un peu de mauvaise viande ou de morue avariée, quelques onces de légumes secs ou de pommes de terre composaient la nourriture de chaque captif.
Tous suppléaient à l'insuffisance de cette maigre ration en travaillant à tresser de la paille, à faire de petits navires en os, des boîtes en bois, des chaussons de lisière, de la dentelle, des boutons, etc. Tous ces objets étaient vendus à terre par les soldats anglais, qui prélevaient pour leur commission de vente la plus forte partie du prix de ces articles de fabrique française.
Dans ces petites sociétés d'hommes réunis par la captivité et régis par la force, on retrouvait toutes les passions, les faiblesses, l'orgueil, les distinctions et les jalousies que l'on rencontre dans le monde. Les pontons avaient leurs riches, leurs pauvres, leur aristocratie, leur bourgeoisie et leur démocratie.
Les riches, les parvenus que le commerce de la paille ou la vente des chaussons de lisière avaient engraissés, achetaient une place, deux places aux plus indigents ; et dans l'étroit espace dont ils étaient devenus propriétaires, ils se carraient avec complaisance et faisaient presque salon à l'abri du mauvais lambeau de serpillière dont ils s'étaient formés une case à part ... Tant d'orgueil caché par une guenille sur cinq à six pieds du tillac d'un ponton!
Les plus indigents se mettaient à la solde des richards et leur rendaient à peu près le service de la domesticité.
Les prisonniers que l'on nommait les savants donnaient des leçons de lecture et d'écriture, de dessin ou de mathématiques aux jeunes gens. Les pontons avaient aussi leurs poètes et leurs auteurs, leurs chansonniers, leurs dramaturges même et leurs acteurs. À bord de quelques-uns d'entre eux, on jouait les comédies et les vaudevilles échappés à la verve des beaux esprits du lieu. Quel lieu! quels auteurs et quels théâtres surtout !
Il y avait, comme vous le voyez, de la civilisation raffinée dans ces cloaques de réclusion. Les querelles, enfantées par l'aigrissement des caractères et l'exaltation naturelle des esprits, se vidaient en duel.
Les duels étaient terribles; ils avaient tout le ponton pour témoin. La fureur est ingénieuse et la soif du sang a tant d'instinct ! Les champions qui voulaient se mesurer n'avaient ni épées ni sabres, mais ils prenaient des compas de mathématiques et des rasoirs. Une branche de compas attachée au bout d'un bâton tenait lieu d'épée; une lame de rasoir emmanchée à l'extrémité d'un bout de fagot figurait un sabre.
L'offensé, comme vous le voyez, pouvant user dans ce dénuement apparent de tout moyen de destruction, avait encore le choix des armes. On se perçait à coups de pointe de compas, on se hachait à coups de rasoir, et la galerie déclarait alors l'honneur satisfait! ... Les prisonniers français, en renonçant à toutes les douceurs et toutes les consolations de la vie à leur entrée à bord des pontons, avaient conservé ce préjugé où l'honneur qui se venge se satisfait dans le sang d'un duel! ...
Ah ! c'est avoir assez parlé de ces effroyables cachots ! Il faudrait pouvoir les oublier pour la gloire de nos nouveaux alliés et pour ne pas risquer peut-être de réveiller dans le cœur des anciens prisonniers de guerre l'une de ces cuisantes douleurs qu'ils doivent encore éprouver en lisant ce mot affreux, ce mot de désolation et d'agonie : PONTONS D'ANGLETERRE.
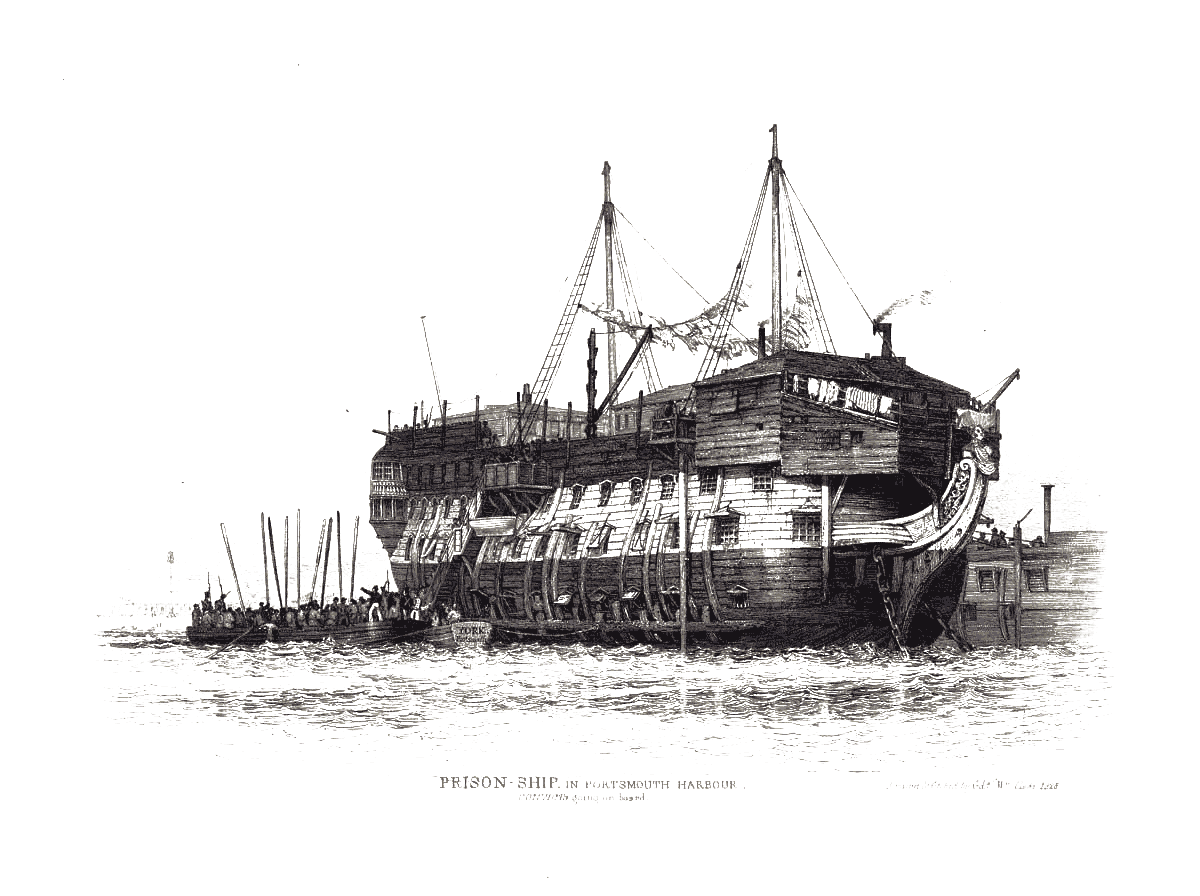
ED. CORBIÈRE.
Les pontons de Cadix
Dans le corps d'armée de Dupont, qui opéra en Espagne en 1808, se trouvait un bataillon de marins de la garde. Ce bataillon fut compris dans la capitulation de Baylen et emmené sur des pontons à Cadix, au mépris du droit des gens, car la capitulation stipulait que le corps de Dupont devait être conduit en France avec armes et bagages.
ON ne sait pas quelles horribles souffrances ont endurées les prisonniers de ces pontons. La plupart du temps on ne leur donnait rien à manger. On laissait les cadavres à côté des survivants, et il arriva que, sur plusieurs pontons, il y eût plus de cadavres que de vivants.
Ceux-ci, enfermés avec les morts et respirant l'infection des corps en putréfaction, ne tardaient pas à succomber.
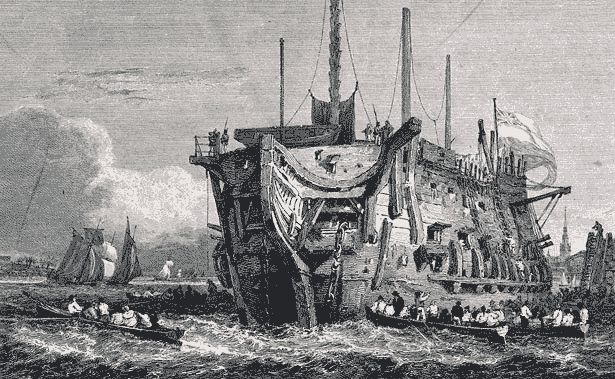
Tout prisonnier qui pouvait, à la nage, parvenir jusqu'au rivage était sauvé, puisque le corps du maréchal Victor occupait les portes voisines, comme Puerto Real. Lors des grandes marées ou pendant les tempêtes, quelques prisonniers réussirent pendant la nuit à couper les câbles des pontons. Malgré la mitraille des Anglais et des Espagnols, ces navires vinrent échouer au rivage et les prisonniers furent sauvés.
Il nous est arrivé à Puerto Real un marin de la garde impériale, un Breton ; il s'était sauvé des pontons de Cadix à la nage. Il nous raconta que, quelques jours avant sa fuite, un milord anglais était venu avec un nègre boxeur défier les Français prisonniers pour boxer avec son nègre. Les prisonniers, qui connaissaient la force du Breton, lui dirent : « Tu devrais soutenir l'honneur de la France ». Le Breton dit au milord : «Si vous voulez me faire donner à manger à discrétion, je me boxerai avec votre nègre». Il faut savoir que sur ces affreux pontons les prisonniers crevaient de faim. Le milord consentit. Au bout de trois jours, le Breton avait un peu repris ses forces qui étaient épuisées par les privations de tout genre que l'on faisait endurer aux Français. Milord fut exact au rendez-vous. Le nègre, qui jouissait du renom de premier boxeur de Londres, s'avança fièrement en face du Breton qui l'attendait. Au moment où le nègre faisait mouline et remouline avec ses poings, le Breton recule de trois pas, s'élance sur le nègre et, d'un coup de tête dans l'estomac, il le fait sauter à la mer par-dessus les bastingages du navire. Milord dit que le combat n'était pas régulier; le Breton répondit : « Votre nègre boxe à l'anglaise et moi je boxe à la française ».
Les Anglais, pour épouvanter les prisonniers qui tenteraient de s'évader, en avaient pendu plusieurs au grand mât. Un prisonnier des pontons, voyant les soldats français si près de lui et ne pouvant les rejoindre parce qu'il ne savait pas nager, s'ingénia l'idée de construire deux petits barils ; il s'en attacha un devant et un derrière et, se recommandant à Dieu, il s'élança à la mer. La marée montante le poussait vers la terre. Au moment où il allait atteindre la rive, une chaloupe de ronde l'aperçut (c'était pendant la nuit qu'il se sauvait) et, au lieu de l'enfoncer d'un coup d'aviron sur la tête comme ils avaient l'habitude de le faire, les Anglais le prirent et le conduisirent à l'amiral anglais. Celui-ci lui fit donner à manger et le renvoya avec son appareil au général Ruffin, qui était à Puerto Real.
Cet amiral a voulu imiter Napoléon, à qui, étant au camp de Boulogne, on amena un Anglais que l'on avait attrapé en mer, monté sur quatre planches mal jointes : il essayait avec cette frêle embarcation de prendre le large et de gagner l'Angleterre. Amené devant' l'Empereur, Napoléon lui demanda quel motif assez puissant l'avait décidé à risquer sa vie, sur mer, avec une pareille embarcation : « C'est peut-être pour aller retrouver ta bonne amie? — Mieux que cela, répondit l'Anglais, c'est pour aller retrouver ma mère qui, j'en suis sûr, mourra de chagrin me sachant prisonnier. » L'Empereur, touché d'un pareil dévouement filial, lui fit remettre de l'argent et reconduire en Angleterre.
L'Empereur, par ses procédés généreux, tâchait que les Anglais l'imitassent et adoucissent le sort de nos prisonniers ; mais il n'en fut pas ainsi ; on avait donné Verdun et la campagne environnante pour prison aux Anglais : loin de nous imiter, ils nous ont donné les infâmes pontons (1).
(1). La barbarie vis-à-vis de ces misérables prisonniers fut telle, que sur plus de 17 000 hommes qui capitulèrent à Baylen, il en revint à peine 2 000 en France. Les autres étaient morts de maladie ou de faim sur les pontons de Cadix et dans l'île de Cabrera.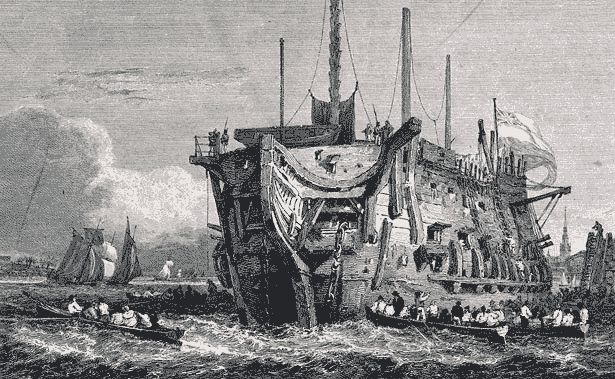
(Récit du Soldat Manière.)
PUBLIÉ PAR M. GERMAIN BAPST.
Combat des Sables-d'Olonne
(1809)
Après le cruel revers de Trafalgar, l'Empereur ne voulut plus tenter de grandes expéditions maritimes. Il se borna à lancer au loin des frégates isolées ou de faibles divisions. Mais les Anglais bloquaient nos côtes sans trêve. Les départs étaient difficiles.
LE 23 février 1809, à neuf heures du matin, j'étais en dehors des passes de Lorient avec les trois frégates que je commandais et je faisais route pour la rade de l'île d'Aix, où l'Empereur avait voulu rassembler de tous les coins du golfe de Gascogne une masse de forces assez importantes pour se frayer aisément un passage jusqu'aux mers du Brésil et des Antilles.
Au moment où je donnais dans le canal de Belle-Isle, deux bâtiments anglais, cachés dans la baie de Quiberon, mirent sous voiles.
L'un d'eux, le Dotherel, brick de dix-huit canons, se plaça dans les eaux de ma division, et se tint à portée de l'observer. En même temps le sémaphore de Belle-Isle, interrogé sur la position de l'ennemi, me signalait quatre vaisseaux et une frégate se dirigeant vers l'entrée de Lorient.
C'était la division du commodore Beresford qui venait reprendre son poste de blocus. Le commodore n'hésita point à laisser nos frégates continuer leur route pour aller s'opposer à la sortie des forces plus importantes qu'il avait mission de garder. Il se contenta de détacher sur nos traces la frégate l'Amelia.
La nuit fut très belle, mais fort obscure.
Les frégates françaises se tinrent à portée de voix l'une de l'autre, en branle-bas de combat, masquant leurs feux et s'attendant à chaque instant à voir apparaître quelques-uns des croiseurs que les mouvements de notre escadre avaient dispersés dans toute l'étendue du golfe.
L'Amelia et le Dotherel avaient sur nous un grand avantage de marche, car nous étions chargés outre mesure des approvisionnements nécessaires à une longue campagne.
Malgré l'obscurité, ces deux bâtiments ne nous perdirent pas de vue.
Au point du jour, nous avions franchi le canal de l'île d'Yeu ; nous distinguions déjà la Tour de la Baleine, lorsque les vents changèrent et soufflèrent du sud-est, c'est-à-dire du point même où nous voulions nous rendre.
Dans cette direction, amenées vers nous par la brise, se montraient quatre voiles suspectes.
Je restai quelque temps en suspens sur le parti que je devais prendre. Je ne savais encore si j'avais devant moi une partie de l'escadre de Brest ou des bâtiments ennemis ; mais bientôt le doute ne fut plus possible.
Je fis signal à ma division de virer de bord, et je pris la bordée du nord-est. Cette manœuvre conduisit nos frégates à portée de canon des deux croiseurs qui nous avaient observés toute la nuit.
Pour éviter de tomber sous notre volée, ces bâtiments durent laisser arriver vent arrière ; mais bientôt l'Amelia s'aperçut que la Concorde, qui marchait moins bien que ses conserves, se trouvait séparée du reste de la division par une assez grande distance.
Elle revint brusquement au vent et gouverna de manière à lui couper la route.
Sans doute, lorsqu'il exécuta cette manœuvre hardie, le capitaine de l'Amelia pensait que, pressés comme nous l'étions par une division de vaisseaux, nous continuerions notre marche sans intervenir.
La Concorde était, comme la Revanche, commandée par un des plus braves capitaines de notre marine. Loin de fuir le combat auquel on la provoquait, elle avait, semblable à un athlète qui dépose ses vêtements sur l'arène, cargué ses basses voiles et ses perroquets pour être mieux en mesure de soutenir la lutte.
Quelques minutes encore, et c'était une frégate perdue.
Une ou deux volées, en hachant son gréement, allaient la livrer aux vaisseaux, qui déjà grossissaient à vue d'œil.
Pour ne pas compromettre toute la division à la fois, je hélai à la Revanche de continuer sa route, et me portai seul avec la Créole à la rencontre de la frégate anglaise.
Pardonnera-t-on ce petit mouvement d'orgueil à un homme qu'on n'a jamais accusé d'une suffisance excessive? Le moment où nous virâmes de bord pour venir en aide à la Concorde fut un beau moment dans ma vie.
À notre approche, la frégate anglaise laissa de nouveau arriver, et, hissant ses bonnettes, se mit bientôt hors de portée de canon. Cependant les vaisseaux de l'amiral Stopford approchaient rapidement.
Je me décidai à gouverner sur le mouillage des Sables-d'Olonne, dangereux, semé de hauts-fonds, sans abri contre les vents du large, et où je pensais que l'ennemi hésiterait dans cette saison à nous poursuivre.
Vers dix heures du matin, nos frégates donnèrent dans la passe étroite que suivent les caboteurs.
Les vaisseaux anglais continuaient de longer la côte.
Nous avions à peine jeté l'ancre à quatre cents mètres environ de terre, et rectifié à la hâte notre ligne d'embossage, que nous vîmes l'ennemi s'engager hardiment entre les sables de la côte et les plateaux de roche que nous avions franchis.
Les frégates l'Amelia et la Naiad s'arrêtèrent en dehors de la portée du canon, mais les vaisseaux s'avancèrent beaupré sur poupe, formés en ligne de bataille.
Le vaisseau Defiance, qui marchait en tête, mit sans hésiter le cap sur la Créole, au grand mât de laquelle il voyait flotter le guidon de commandement.
Je crus un instant que ce vaisseau avait l'intention de nous enlever à l'abordage.
Le feu des trois frégates, ou une brusque diminution du fond, le fit renoncer à ce projet. Il vint au vent en carguant ses huniers, et mouilla par le bossoir de tribord de la Créole, à portée de pistolet.
Le Donegal s'arrêta par le travers de la Concorde, le Cesar en face de la Revanche.
Le Defiance avait pris un parti vigoureux.
Son feu, bien dirigé, devait, à lui seul réduire ou couler bas nos trois frégates, mais la plupart de ses coups portèrent trop haut : ils ne firent pendant longtemps que hacher nos manœuvres et cribler notre mâture. Chaque fois qu'une bouffée de brise venait faire une trouée dans le nuage épais qui nous enveloppait, les canonniers du De fiance devaient bien s'étonner, j'imagine, de nous retrouver encore à la surface.
Un charme semblait nous protéger.
Quelques projectiles cependant arrivaient bien de temps à autre à leur destination. De l'avant des porte-haubans de misaine au bossoir, dans un espace de quelques mètres carrés, on comptait dix-neuf boulets de trente-deux qui avaient traversé la frégate des deux bords.
Les soldats de marine anglais, rangés sur la dunette du Defiance, occupaient une position dominante, d'où ils faisaient pleuvoir sur notre pont une grêle de balles.
Les valets même, ces tampons de corde qu'on place dans le canon pour maintenir la charge, devenaient, dans un combat aussi rapproché, des projectiles presque aussi dangereux que les boulets ou la mitraille.
Quelques-uns de ces valets, en tombant sur le pont, mirent le feu à bord de la Créole.
Tout commencement d'incendie est chose grave dans un combat naval. J'animais les hommes occupés à puiser de l'eau le long du bord, lorsque je me sentis frappé d'un coup violent à la nuque.
Je chancelai, et me serais affaissé sur moi-même, si je n'avais trouvé l'appui du bastingage.
À la pâleur de mon visage, l'officier de manœuvre me crut mortellement atteint.
Ce n'était qu'un des valets du Defiance qui m'avait étourdi. Je souffrais beaucoup, mais l'animation du combat me fit bientôt oublier la douleur.
Nous ripostions de notre mieux au feu du Defiance.
Notre but à nous n'était pas ceux qu'on peut manquer. Malheureusement un vaisseau de ligne a les côtes plus dures qu'une frégate.
Après une heure et demie de combat, le Defiance ne comptait encore qu'une trentaine d'hommes tués ou blessés ; mais la mer commençait à baisser ; l'amiral Stopford fit signal à son escadre de prendre le large, et en donna lui-même l'exemple en mettant le cap au sud-ouest.
Le Defiance dut se disposer à appareiller.
En ce moment, il se trouvait seul contre trois.
Pour abattre au large, il dut filer son embossure, c'est-à-dire le câble qui lui faisait présenter le travers aux frégates …
Au lieu de sa batterie, il nous montra sa large poupe presque dégarnie de feux.
En quelques minutes, nos canons y eurent pratiqué une brèche où, selon l'expression familière à nos adversaires, un carrosse à quatre chevaux aurait pu passer.
Les deux sabords de retraite n'en faisaient plus qu'un.
Le feu du Defiance, tout occupé de son appareillage, avait alors cessé.
Nous cherchâmes des yeux son pavillon ; on n'en voyait plus flotter à la corne. Sa brigantine avait été traversée par plus de vingt boulets, et probablement un de ces projectiles avait coupé la drisse qui supportait les couleurs anglaises ; il n'y eut qu'un cri à bord de la Créole : « Le vaisseau est rendu ! le vaisseau vient d'amener ! » Nos acclamations trouvèrent de l'écho à bord de la Concorde et de la Revanche, et on dut les entendre au loin dans la campagne.
Un singulier hasard avait réuni sur les trois frégates de cette division des officiers que leur rare intelligence, non moins que leur intrépidité, devait porter un demi-siècle plus tard à la tête d'un corps dont quelques-uns d'entre eux sont encore l'honneur.
Le souvenir du 24 février 1809 s'est ainsi perpétué dans nos rangs, moins encore par l'éclat de cette action même que par les noms si chers à la marine de ceux qui y prirent part.
Ce fut un de ces braves officiers que je chargeai de se rendre à bord du Defiance pour y enlever le capitaine et le déposer à terre: folle mission qui pourtant fut acceptée avec enthousiasme ; mais pendant que le canot de la Créole s'armait à la hâte, le Defiance avait hissé son petit hunier.
Un boulet d'une de nos frégates en coupa la drisse ; le hunier retomba sur le chouque. Ce furent de nouveaux cris de victoire.
Le Cæsar, suivi du Donegal, se trouvait alors à près de deux milles dans le sud, et par conséquent hors de portée de prêter au Defiance un secours immédiat.
Si ce dernier vaisseau, au lieu d'abattre du côté du large, eût, comme il pouvait le craindre après cette avarice, abattu du côté de la terre, il était bien à nous. La fortune lui vint malheureusement en aide; le vent gonfla ses focs du côté favorable. Dès qu'il eut le cap dans la direction voulue, il s'éloigna lentement du théâtre de ce long combat; il s'enfuit.
(Jurien de la Gravière, Souvenirs d'un Amiral.)
(Hachette, éditeur.)
Combat du Grand-Port
(25 AOUT 1810)
LES Anglais, pendant l'absence de la division Duperré, s'étaient emparés, le 9 juillet 1810, de l'île Bourbon ; le 14 août, ils surprenaient et occupaient, à l'entrée du Grand-Port, le fort bâti sur l'îlot de la Passe. Du Bengale, de Madras, du cap de Bonne-Espérance, des troupes, embarquées sur de nombreux transports, accouraient pour se concentrer à l'île Rodrigue. On sait que Rodrigue est situé à cent lieues environ au vent de l'île de France. La base d'opérations était bien choisie. L'orage s'amassait ainsi lentement ; quelques jours encore, il allait crever sur la dernière île qui restât en notre possession dans la mer des Indes.
Soliman avait voulu supprimer Malte; Charles-Quint, Alger; le gouvernement de Calcutta jugeait, à son tour, nécessaire de faire disparaître « le nid de scorpions » si funeste à ses flottes marchandes.
Trompée par le pavillon français, toujours arboré sur l'îlot de la Passe; arboré également à bord de la frégate mouillée sous cet îlot, la division Duperré donne, le 20 août, à pleines voiles dans le Grand-Port. L'ennemi, à l'instant, se démasque : la frégate, le fort déploient le pavillon britannique. Au signal du commandant Duperré, la Minerve a pris la tête de la colonne : Bouvet, familier avec les récifs de la baie, guidera la division française au mouillage. La Minerve essuie les volées du fort, envoie en passant sa bordée à la frégate anglaise, et va jeter l'ancre au fond de la rade. Toute la division l'a suivie.
Que pouvaient avoir à redouter nos vaisseaux dans cette position? N'y avaient-ils pas cent fois trouvé un refuge assuré contre les forces supérieures de l'ennemi? Oui, l'asile autrefois était sûr : mais le fort qui commande l'entrée du Grand-Port n'était pas alors au pouvoir des Anglais ; l'île elle-même n'était pas menacée d'un débarquement. Le Grand-Port aujourd'hui n'est plus un abri ; c'est une nasse. Dans de telles conditions, ne pas désespérer de la défense, songer à embosser les frégates, au lieu de les incendier, sera déjà une résolution héroïque.
Les Anglais, heureusement, attaquèrent avec une audace irréfléchie : ils se laissèrent emporter par l'espoir d'un facile succès. Aussitôt que l'escadre de blocus put être avertie, elle accourut.

Trois nouvelles frégates vinrent, le 22 août, rejoindre la Néréide , qui continuait de garder l'entrée du Grand-Port Néréide , Sirius , Iphigénie , Magicienne se précipitèrent vers la division Duperré, comme si la voie qui devait les mener au combat ne cachait pas d'embûches. Les bancs de coraux se signalent d'eux-mêmes sous une eau calme : ils se signalent par de larges plaques blanchâtres tachant la nappe bleue ou verte ; seulement, pour apercevoir à temps le danger, il faut avoir le soleil derrière soi. Les Anglais firent route avec le soleil dans les yeux. Des marins aussi consommés ! qui l'eût jamais cru? La Néréide tire moins d'eau que les autres frégates; elle franchit les hauts fonds sans s'échouer. En mouillant, elle s'embosse à portée de pistolet de la division française. Le capitaine Willoughby la commande. Si la marine britannique eût eu, dans cette journée, à faire choix d'un champion, elle n'eût pu en faire sortir de ses rangs un plus brave. Bravoure et imprudence quelquefois se confondent : c'est la fortune qui en décide. Le Sirius et la Magicienne suivaient la Néréide. Elles s'arrêtent brusquement, la proue tournée vers la Bellone et vers la Minerve. Le même lit de coraux vient de heurter leurs quilles; le même récif les retient serrées dans son implacable tenaille. Tous les efforts pour les dégager et les remettre à flot seront inutiles. Ce spectacle ne sera pas perdu pour le futur amiral Roussin : il s'en souviendra quand il devra, en 1833, forcer l'entrée du Tage …
 La fortune abandonne donc enfin cette Angleterre que jusqu'ici elle a tant gâtée ! Pas de milieu pour les capitaines du Sirius et de la Magicienne : il leur faut, en ce jour, vaincre ou périr sur place. Mieux inspirée ou avertie par le sort de ses conserves, l' Iphigénie jette l'ancre à mi-chemin. La division française ouvre le feu. La Néréide, la première, riposte. L'action ne sera qu'un duel de canonniers; la manœuvre n'y jouera aucun rôle. Qu'importent les avaries de mâture à ces pontons forcément immobiles? Tout boulet qui ne frappe pas en plein bois est un boulet perdu. Les câbles de la Minerve et du Ceylan ont été coupés dès les premières volées : ces deux navires sont jetés en travers et vont s'échouer sous le vent, — la Minerve à demi masquée par la Bellone , le Ceylan couvert en partie par la Minerve . La ligne d'embossage ne forme plus qu'un bloc hérissé d'artillerie : la batterie de la Bellone s'est, en quelque sorte, allongée de 18 pièces, — 9 appartenant à la Minerve, 9 autres garnissant les flancs du Ceylan. — Cette forteresse de bois, à double étage et à triple redan, accable la Néréide de ses projectiles. Quarante bouches à feu font voler en éclats les bordages de la malheureuse frégate. L'artillerie de la Néréide est bientôt réduite au silence.
La fortune abandonne donc enfin cette Angleterre que jusqu'ici elle a tant gâtée ! Pas de milieu pour les capitaines du Sirius et de la Magicienne : il leur faut, en ce jour, vaincre ou périr sur place. Mieux inspirée ou avertie par le sort de ses conserves, l' Iphigénie jette l'ancre à mi-chemin. La division française ouvre le feu. La Néréide, la première, riposte. L'action ne sera qu'un duel de canonniers; la manœuvre n'y jouera aucun rôle. Qu'importent les avaries de mâture à ces pontons forcément immobiles? Tout boulet qui ne frappe pas en plein bois est un boulet perdu. Les câbles de la Minerve et du Ceylan ont été coupés dès les premières volées : ces deux navires sont jetés en travers et vont s'échouer sous le vent, — la Minerve à demi masquée par la Bellone , le Ceylan couvert en partie par la Minerve . La ligne d'embossage ne forme plus qu'un bloc hérissé d'artillerie : la batterie de la Bellone s'est, en quelque sorte, allongée de 18 pièces, — 9 appartenant à la Minerve, 9 autres garnissant les flancs du Ceylan. — Cette forteresse de bois, à double étage et à triple redan, accable la Néréide de ses projectiles. Quarante bouches à feu font voler en éclats les bordages de la malheureuse frégate. L'artillerie de la Néréide est bientôt réduite au silence.
Le Sirius, négligé, est, en réalité, peu à craindre : ses pièces de chasse sont les seules qui puissent porter. La Magicienne occupe une position moins désavantageuse. Plusieurs de ses canons prennent en écharpe la Minerve. A dix heures et demie du soir, la victoire n'est plus douteuse. La Néréide tire un dernier coup à mitraille. Ce seul coup — tant le hasard a de part dans les combats de mer, va peut-être changer la face de la journée. Atteint à la joue gauche par un biscaïen, le commandant Duperré est renversé de son banc de quart. Le vainqueur du Grand-Port en gardera la profonde cicatrice toute sa vie. J'ai entendu raconter, — car j'eus la bonne fortune d'approcher, quand j'étais encore un enfant, les acteurs de ce drame héroïque, — j'ai entendu raconter, dis je, que, dans le désordre produit par un incident si funeste, peu s'en fallut qu'on ne jetât le corps mutilé du commandant de la Bellone à la mer. Semblable précipitation se rencontre souvent dans le feu de la bataille. Je pourrais citer telle dunette qui, le 17 octobre 1854, devant Sébastopol, fut dégagée de cette brusque façon. L'enseigne de vaisseau Vigoureux étendit un pavillon de signaux sur le corps du glorieux blessé qui ne donnait plus signe de vie et prit soin de le faire transporter, inconnu, caché à tous les yeux, au poste des blessés. Dans la batterie, les canonniers ne soupçonnaient rien de ce qui se passait sur le pont : le feu ne se ralentit pas un instant.
Bouvet cependant a été prévenu : il confie la Minerve à son second, le lieutenant de vaisseau Roussin, et vient prendre, avec le commandement de la Bellone, la direction générale du combat. A peine a-t-il mis le pied à bord de la Bellone qu'il juge la Néréide incapable de reprendre la lutte. C'est sur la Magicienne qu'il fait concentrer tout le feu dont il dispose. Des soldats longtemps victorieux ne se décident pas aisément à s'avouer leur défaite. A Reichshoffen, à Frœschviller, la retraite ne nous était peut-être pas, au début, interdite : nous préférâmes disputer un terrain où l'inondation croissait d'heure en heure. Du matin au soir, nous luttâmes acharnés, nous combattîmes contre des forces triples et quadruples des nôtres, impuissants à désespérer de la victoire. Les Anglais, au Grand-Port, n'avaient d'ailleurs pas le choix. La brise, à défaut d'échouage, les eût empêchés de rétrograder. Ils résistèrent toute la nuit; ils résistèrent encore le lendemain. Le 24 août, au matin, le lieutenant de vaisseau Roussin, sur l'ordre du commandant Bouvet, partit de la Minerve pour aller amariner la Néréide. Plus de quarante ans après, l'affreux spectacle que le pont et la batterie de la frégate anglaise offrirent à ses regards hantait encore, comme un sinistre rêve, sa pensée : cent soixante morts ou blessés gisaient — pêle-mêle dans une mare de sang. Ce fut au fond de l'entrepont que le nouveau commandant de la Minerve reçut l'épée du capitaine Willoughby, dangereusement blessé et couché dans un cadre. Il la reçut avec le respect que nous n'avons jamais su refuser au courage malheureux. Quels hommes que ceux de cette époque, et combien je me félicite de les avoir connus! J'ai appris, dès l'enfance, à les vénérer : leur souvenir aujourd'hui console et réjouit ma vieillesse.
La Magicienne garda son pavillon arboré pendant toute la journée du 24 août. Elle le garda jusqu'à la nuit. De temps en temps, quelque coup isolé venait affirmer qu'elle ne se rendait pas encore. Nous répondions par des salves entières. Vers neuf heures du soir, l'opiniâtre frégate avait terminé l'évacuation de ses blessés. Un jet de flamme apprit aux vainqueurs que, pour ne pas laisser leur frégate échouée tomber entre nos mains, les Anglais prenaient le parti de l'incendier. A dix heures une explosion formidable en dispersa les débris. Le 25 au matin, une seconde éruption annonça la destruction du Sirius. L'Iphigénie, par de prodigieux efforts, était parvenue à se touer jusqu'à l'île de la Passe, se mettant ainsi hors de la portée de nos coups. Nous restions maîtres d'un champ de bataille sur lequel il n'y avait plus à ramasser que des épaves.
Le 27 août apparut à l'entrée du port la division Hamelin, composée de trois frégates et d'un brick : la Vénus, la Manche, l'Astrée et l'Entreprenant. Sommé de se rendre, le commandant de l'Iphigénie , le capitaine Lambert, reconnut l'impossibilité d'opposer à tant de forces réunies le feu de sa seule frégate : il nous remit, avec l'Iphigénie , le fort de la Passe. Le pavillon anglais n'y avait flotté que pendant quatorze jours. N'étions-nous pas en droit de nous écrier, comme Nelson après Aboukir : « Ce n'est pas une victoire, c'est une conquête »? Jamais triomphe ne fut plus complet. Nous l'avions, il est vrai, payé cher. Les deux frégates et le Ceylan comptaient cent cinquante marins et plusieurs officiers hors de combat.
Les Anglais ne nous ont pas souvent donné de ces joies-là. Ce n'était pourtant pas la dernière que nous réservaient les mers de l'Inde.
(L'Amiral Roussin, par le Vice-Amiral Jurien de la Gravière.)
(Eug. Plon et Cie, éditeurs.)
Combat du brick le "Renard"
DANS les premiers jours de juin 1812, j'escortais un convoi de trente-trois voiles destiné pour Marseille. J'étais parvenu à la hauteur des îles de Lérins, ayant été sans cesse harcelé, depuis ma sortie de Gênes, par une division composée du vaisseau l'America, de soixante-quatorze, de la frégate le Curaçao, de quarante-quatre, et du brick de vingt le Swallow.
J'avais pour me seconder la goélette le Goéland, de six bouches à feu, commandée par un lieutenant de vaisseau, M. de Saint-Belin, émigré rentré en France depuis quelques années. Nous avions appareillé des îles de Lérins au commencement de la nuit avec notre convoi : la division anglaise, dont le Swallow formait l'avant-garde, nous poursuivait. Je conçus le projet de couper ce brick du reste de sa division et de l'enlever dans l'obscurité. J'envoyai chercher Saint-Belin et je lui donnai mes instructions. Le calme qui survint empêcha l'exécution de mon projet. Quand le jour se fit, la division ennemie était bien ralliée. Je ne m'occupai plus que de faire filer mon convoi vers Saint-Tropez : à midi, je l'avais mis en sûreté. En ce moment la brise fraîchit du large.
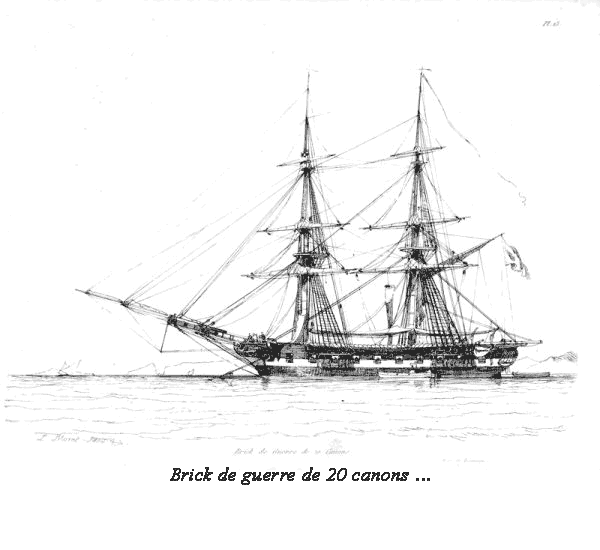 Le brick ennemi s'était avancé à une certaine distance de ses deux conserves; je voulus encore une fois tenter de l'enlever avant qu'il pût être secouru, et je me portai à sa rencontre, virant de bord vent devant, je lui passai à poupe, à portée de pistolet : je me trouvai ainsi au vent à lui sur l'autre bord. Si j'avais été seul, je n'aurais pas hésité à l'aborder, mais je ne voulais pas, mon devoir étant d'assurer avant tout le succès, négliger l'assistance du Goéland, qui faisait forces de voiles-pour venir à mon aide. Par malheur, la barre de gouvernail du Goéland venait d'être coupée par un boulet. Pendant qu'on mettait en place la barre de rechange, j'échangeai avec le Swallow un feu très vif. Je n'avais que deux officiers : l'un d'eux, l'enseigne de vaisseau Charton, fut blessé à mort ; moi-même, je reçus à l'épaule droite un biscaïen qui m'y fit une blessure très douloureuse. La commotion fut telle dans toute la poitrine, que le sang me vint à flots à la bouche. Je continuai cependant de commander la manœuvre. J'allais ordonner l'abordage, sans attendre le Goéland, lorsque le Swallow, qui était sous le vent à moi, laissa arriver tout plat vent arrière, en me présentant la poupe. Avant que je pusse le suivre, il eut le temps de virer de bord lof pour lof, et de mettre le cap sur sa frégate. Ma mâture et mon gréement étaient hachés : j'avais quarante-deux hommes sur cent huit hors de combat ; il ne me restait d'autre parti à prendre que d'entrer à Saint-Tropez pour y rallier mon convoi et pour réparer mes avaries. Le Swallow, de son côté, fut rejoint par l'America et par le Curaçao. Il fit ensuite route pour Malte.
Le brick ennemi s'était avancé à une certaine distance de ses deux conserves; je voulus encore une fois tenter de l'enlever avant qu'il pût être secouru, et je me portai à sa rencontre, virant de bord vent devant, je lui passai à poupe, à portée de pistolet : je me trouvai ainsi au vent à lui sur l'autre bord. Si j'avais été seul, je n'aurais pas hésité à l'aborder, mais je ne voulais pas, mon devoir étant d'assurer avant tout le succès, négliger l'assistance du Goéland, qui faisait forces de voiles-pour venir à mon aide. Par malheur, la barre de gouvernail du Goéland venait d'être coupée par un boulet. Pendant qu'on mettait en place la barre de rechange, j'échangeai avec le Swallow un feu très vif. Je n'avais que deux officiers : l'un d'eux, l'enseigne de vaisseau Charton, fut blessé à mort ; moi-même, je reçus à l'épaule droite un biscaïen qui m'y fit une blessure très douloureuse. La commotion fut telle dans toute la poitrine, que le sang me vint à flots à la bouche. Je continuai cependant de commander la manœuvre. J'allais ordonner l'abordage, sans attendre le Goéland, lorsque le Swallow, qui était sous le vent à moi, laissa arriver tout plat vent arrière, en me présentant la poupe. Avant que je pusse le suivre, il eut le temps de virer de bord lof pour lof, et de mettre le cap sur sa frégate. Ma mâture et mon gréement étaient hachés : j'avais quarante-deux hommes sur cent huit hors de combat ; il ne me restait d'autre parti à prendre que d'entrer à Saint-Tropez pour y rallier mon convoi et pour réparer mes avaries. Le Swallow, de son côté, fut rejoint par l'America et par le Curaçao. Il fit ensuite route pour Malte.
Il était à peu près trois heures de l'après-midi lorsque j'entrai à Saint-Tropez. Nos blessés furent transportés sur-le-champ à terre ; je restai à bord, quoique souffrant cruellement de ma blessure. Vers le soir, la crise nerveuse devint extrêmement intense, mes muscles se contractaient, mes dents se serraient, un engourdissement général gagnait tous mes membres. A ces symptômes, je reconnus l'approche du tétanos, dont j'avais été déjà menacé lorsque je perdis le bras sur la Sémillante. Je me fis préparer un bain de lessive ; cette décoction alcaline eut pour effet de calmer aussitôt l'agitation nerveuse.
Trois jours après j'étais debout.
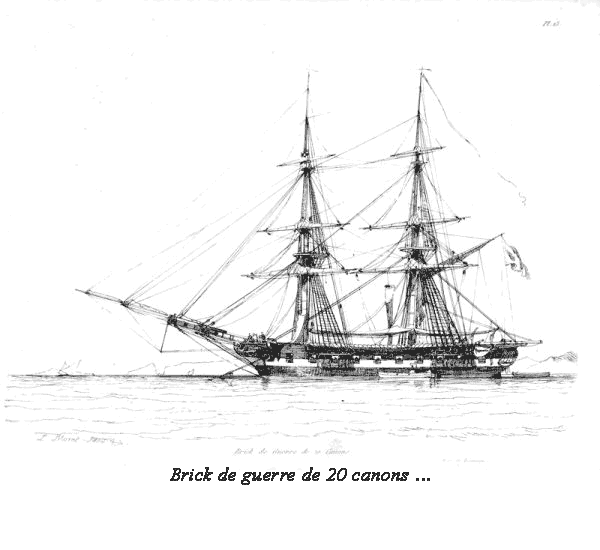
Amiral BAUDIN.
Visite de Napoléon
et de Marie-Louise à Cherbourg
et de Marie-Louise à Cherbourg
(1811)
TOUT était grand et brillant en France, à l'époque où naquit le roi de Rome. L'Empereur voulut ensuite faire connaître la France à sa nouvelle épouse et lui faire voir les rives de l'Océan. Il devait se rendre à Cherbourg, et de là, visiter les ports de la Manche et celui d'Anvers où des travaux immenses de construction de vaisseaux et d'armement se faisaient comme par enchantement.
Napoléon arriva à Cherbourg vers la fin du mois de mai de cette année 1811; il était entouré d'une cour brillante dans laquelle se trouvaient le roi de Naples, le prince vice-roi d'Italie, le grand-duc de Wurtzbourg, frère de l'empereur d'Autriche et parrain de Marie-Louise; un assez grand nombre de maréchaux et de chambellans ; les dames d'honneur et d'atour de la jeune souveraine, toutes belles et brillantes à l'envi. Le théâtre de l'impératrice suivait avec ses meilleurs artistes : Elleviou, Gavaudan, Mlle Renaud, etc.
Les travaux du port de Cherbourg se poussaient alors avec activité, toutes les classes de la société dans cette petite ville jouissaient d'un bonheur inconnu et nouveau; tout ce bien-être se rapportait à l'Empereur, aussi fut-il reçu avec acclamation de la population, pour laquelle il se montra bon, simple, comme il savait l'être quand il était content. Parmi ce peuple enthousiasmé, il parut se plaire; il se promenait presque sans suite; souvent Marie-Louise de son côté se donnait, dans des promenades avec ses dames, cette liberté sans étiquette qui lui avait été inconnue jusqu'à ce moment. On était tellement habitué à la vie occupée et si active du héros de ce temps, qu'un séjour de cinq à six jours à Cherbourg parut extraordinaire. Presque tous les jours, l'Empereur venait visiter en rade soit les ports, soit les bâtiments de l'escadre.
Sa première visite aux vaisseaux eut lieu le lendemain de son arrivée, le temps était calme, mais il tombait une pluie continuelle et battante; l'impératrice et toute sa cour l'accompagnaient ; il commença par le Courageux, vaisseau commandant sur lequel je me trouvais.
Officier et aspirants, l'épée nue à la main, nous étions tous rangés sur le gaillard d'arrière. L'Empereur, en habit vert de chasseur à cheval, parut sur le pont le chapeau à la main. D'un pas rapide il passa devant nous en disant : Bonjour, mes enfants, je viens vous voir de bien mauvais temps. Il entra de suite dans la chambre du commandant, suivi de l'Impératrice et de sa suite. Peu d'instants après, malgré la pluie qui était presque torrentielle, il passa l'inspection de l'équipage rangé en ordre sur le pont supérieur. Il avait l'air satisfait de voir tous ces vieux matelots, en partie usés par les fatigues de la mer. Il décora de sa main le premier maître d'équipage, fit monter dans les mâts les jeunes novices et fit donner à chacun d'eux une gratification.
Marie-Louise, qui habituellement était mise avec beaucoup de simplicité, avait ce jour-là une toilette digne de son rang : sa robe était de velours cramoisi, brodée en or; quoique mouillée par la pluie, elle était joyeuse et riait aux éclats, ses dames d'honneur renchérissaient sur cette gaieté.
L'Empereur et l'Impératrice descendirent dans la batterie basse. Il me semble encore que je vois Napoléon s'approcher de sa femme, la prendre dans ses bras, la conduisant près d'un sabord, et lui disant joyeusement : Veux-tu que je te jette à la mer? — Fais, si tu veux, répondit-elle. Il lui dit ensuite : Je veux entendre de près cette belle détonation d'artillerie qui tout à l'heure t'a fait tressaillir, tu n'auras pas peur, n'est-ce pas? — Oh! non, répondit-elle. Les dames qui étaient là, poussèrent malgré elles un cri de frayeur, quand nos quatre-vingts bouches à feu firent feu à la fois.
Près de Napoléon se trouvait le duc Decrès, ministre de la marine, homme d'un grand mérite, bon administrateur, trop zélé courtisan, spirituel, à la parole facile et élégante, mais comme marin très bourru, d'un caractère fort inégal, jetant souvent à ses subordonnés des saillies grossières; aussi, tout en lui rendant justice, on ne l'aimait guère dans la marine.
La bonne tenue de l'escadre, le contentement manifesté de l'Empereur rendaient le ministre heureux, il fut à bord du Courageux d'une gracieuseté dont on ne le supposait pas capable.
... Pourquoi m'abstiendrais-je de parler de ces grandes émotions de ma jeunesse, de ces impressions profondes et durables, que l'Empereur, cet homme extraordinaire, a laissées à ceux de mon âge. Cette vie d'un passé regrettable est encore pour moi pleine de charmes et fait encore battre mon cœur de soldat.
Les jours qui suivirent furent beaux et sereins. Tous les matins la croisière ennemie apparaissait; elle n'ignorait pas la présence de l'Empereur à Cherbourg, les salves répétées d'artillerie qui se faisaient entendre journellement lui indiquaient clairement qu'il était toujours là. Elle venait de virer de bord, et se maintenait des heures entières, enseignes déployées, presque à portée des canons de la digue. Elle était commandée par un contre-amiral et se composait de deux vaisseaux de 74 et de deux frégates de 46 canons.
La veille du jour fixé pour son départ, l'Empereur fut visiter le fort de Querqueville ; il monta ensuite sur la colline qui domine cette belle batterie : l'escadre anglaise était en vue, il la regarda longtemps avec la longue-vue du sémaphore au pied duquel il se trouvait.
Auriez-vous quelques chances de succès en la combattant? — Oui, sire, répondit simplement le contre-amiral Troude qui était à ses côtés. — Eh bien! si le temps vous le permet, mettez-vous sous voiles demain matin et combattez sous mes yeux, je ne quitterai Cherbourg qu'après la rentrée de nos vaisseaux.
Le soir l'amiral revint à bord et bientôt l'on sut que l'escadre devait mettre sous voiles le lendemain matin, et que si l'anglais venait à vue comme tous les jours passés, un engagement ne serait pas refusé.
Les forces des deux escadres étaient à peu près du même nombre de canons; l'habileté de notre amiral était éprouvée, nos équipages étaient marins; notre force morale jointe à l'enthousiasme du moment devait surpasser celle de l'ennemi : Napoléon devait nous regarder combattre.
Nous avions sur rade deux vaisseaux de 74, le Courageux et le Polonais, une frégate de 44, l'Iphigénie , une corvette de 20, la Diane, deux bricks de 16, le Railleur et l'Alcyon.
L'Empereur envoya chercher l'Impératrice et fit préparer son déjeuner sur la digue, d'où toute la cour devait jouir d'un spectacle qui s'annonçait devoir être émouvant.
Au matin, nous prîmes le large, et, contre toute attente, la flotte ennemie ne parut pas; c'était une fatalité, c'était une journée exceptionnelle, inexplicable. Nous étions déconcertés. L'amiral sur la dunette était morne et silencieux, sa lunette d'approche à la main ; grand mâcheur de tabac, il retournait sa chique dans sa bouche, et il me semble que je vois encore le jus du tabac comprimé sortir et couler sur son menton. À trois heures il fallut bien qu'il se résignât à retourner prendre le mouillage. L'Empereur lui envoya dire quelques mots flatteurs et de regret, il retourna à terre et peu d'heures après Sa Majesté était partie.

(Mémoires pittoresques d'un officier de marine, par le capitaine Leconte.)
Combat de l' "Aréthuse" et de l' "Amalia"
(FÉVRIER 1813)
Le capitaine Pierre Bouvet reçut à la fin de 1812 le commandement de l'Aréthuse pour aller aux Indes Orientales. Il quitta Saint-Nazaire le 23 novembre. Après avoir fait des prises en nombre important, il rencontra, dans les premiers jours de février, devant Sierra Leone, une frégate anglaise, l'Amalia.
Nous courûmes ainsi au large avec un joli frais de S.-S.-O. ; je ne tardai pas à voir que je gagnais la frégate anglaise, et je comptais être à même de l'attaquer dans la nuit, lorsqu'un brouillard épais me la fit perdre de vue.
Le lendemain 7, nous étions à environ six lieues à l'ouest des îles de Los. Il faisait presque calme, et je n'eus connaissance de la frégate ennemie que vers onze heures. Je portai dessus ; elle prit chasse sous toutes voiles ; mais, soit que l'Aréthuse marchât mieux qu'elle, soit qu'elle fit quelque manœuvre pour se laisser gagner, au coucher du soleil j'en étais plus près que la veille ; la brise mollissait toujours ; à sept heures l'ennemi se décida à attaquer, et laissa porter sur notre bossoir ; je l'attendis, et, à sept heures trois quarts, nous étions l'une de l'autre à portée de pistolet, sous les huniers, avec un petit frais d'ouest, un beau clair de lune, et nous n'avions pas encore brûlé une amorce.
Je commençai le feu par une décharge de toute ma batterie : l'ennemi y répondit bientôt, en nous prolongeant de long en long à longueur de refouloir.
Alors s'engagea un furieux combat, dans lequel nos bâtiments semblaient liés par une colonne de feu.
Nous avons été abordés pendant plusieurs minutes, et, pendant une heure et demie, nous n'avons pas été à plus de portée de pistolet, travers à travers. II y eut des écouvillons arrachés et des coups de sabre donnés par les sabords.
Cependant notre feu me paraissait dominer celui de l'ennemi ; au bout d'une heure et demie, notre supériorité me paraissait assez marquée ; je voulus à mon tour tenter l'abordage : je serrai le vent ; mais, les bras et les boulines étant coupés partout de l'avant et de l'arrière, il ne me fut pas possible de venir au plus près. L'ennemi, de son côté, augmenta de voiles. Son feu, presque éteint, se ranima, quand il eut augmenté sa distance, et fit beaucoup de mal à notre gréement. À onze heures le feu cessa de part et d'autre.
Nous n'étions plus à bonne portée ; I 'ennemi se couvrit de voiles, nous abandonnant le champ de bataille.
Je n'eus rien de plus empressé que de faire repasser les manœuvres les plus nécessaires pour faire de la voile et poursuivre notre avantage.
L'Aréthuse avait énormément souffert : vingt hommes tués raides avaient été jetés à la mer pendant le combat, — quatre-vingt-huit hommes grièvement blessés étaient au poste du chirurgien ; excepté le maître charpentier, tous mes officiers mariniers avaient été tués ou blessés : les hommes qui n'avaient reçu que de légères blessures n'avaient point quitté leur poste ou y étaient retournés après s'être fait panser ; au milieu de cette scène de carnage, le quatrième équipage de haut bord n'aspirait qu'à réattaquer.
Au point du jour, l'ennemi nous restait au sud-ouest, à environ une lieue de distance, prenant chasse au sud, sous toutes voiles, avec une faible brise.
Je continuai à le poursuivre toute la journée; à la nuit, je le perdis de vue.
Amiral P. BOUVET.
Le journal le Times faisait suivre le récit de ce combat de l'appréciation suivante :
La perte en tués ou blessés à bord de l'Amalia est évaluée à cent quarante et un, y compris le capitaine et tous les officiers. Le combat a duré trois heures et demie, les deux frégates se touchant presque.
Depuis longtemps nous n'avions pas vu cette persévérance et ces efforts.
Le vaisseau le "Romulus"
(1814)
LE contre-amiral Cosmao, ce survivant de Trafalgar que nos matelots appelaient Va de bon cœur, partit de Toulon le 12 février 1814. Le 15, au point du jour, la division se trouvait à sept ou huit lieues au sud de l'anse d'Agay. Deux frégates ennemies seulement étaient en vue : la Médée et la Dryade leur donnèrent la chasse. Une heure après apparaissaient tout à coup seize autres voiles. L'escadre du vice-amiral sir Edward Pellew, qui n'avait pas encore gagné devant Alger son titre de lord Exmouth, venait du sud-ouest, les voiles gonflées, s'interposer entre la division française de Toulon.
Continuerait-on la route sur Gênes?
Tout dépendrait du vent. Il faisait calme plat. Vouloir gagner Gênes avec des vents contraires serait s'exposer à une chasse prolongée dans laquelle les mauvais marcheurs tomberaient très certainement au pouvoir de l'armée anglaise. Rétrograder vers Toulon amènerait presque aussi sûrement une rencontre : on aurait du moins l'avantage de ne pas s'être dispersé et d'obliger l'ennemi à s'avancer en force. Quant à chercher refuge sous les batteries du golfe Jouan, ou sous les batteries des îles d'Hyères, personne n'y songeait. Pareilles batteries, mal servies, incomplètes, ne pouvaient avoir la prétention d'intimider une flotte de quinze vaisseaux, dont neuf étaient des vaisseaux à trois ponts.
Vers neuf heures du matin, la brise s'éleva de l'est-sud-est. L'amiral Cosmao prit à l'instant son parti. Il fit le signal de se former en ordre de marche sur deux colonnes : les vaisseaux au large, les frégates à terre, puis il mit le cap sur Toulon. Les vaisseaux ennemis, de leur côté, s'étaient rangés en ligne, le plus promptement possible, par ordre de vitesse. Ils couraient sur la côte, avec l'intention évidente de couper la route à la tête de notre division.
Un peu avant midi, Anglais et Français se trouvèrent à portée de canon. L'amiral Cosmao, sur le Sceptre, conduisait son escadre : il passa le premier, sans être inquiété. Le second vaisseau de la colonne de gauche, le Trident, reçut à bonne distance, mais sans grand dommage, le feu du Boyne, vaisseau à trois ponts de quatre-vingt-dix-huit canons, commandé par le capitaine George Burlton. Le Boyne, était le chef de file de la colonne anglaise : il coupa notre ligne à l'arrière du Trident, et se dirigea tout droit sur la Dryade. « Je m'attendais à recevoir la volée du Boyne, écrit l'amiral Baudin; je fis mettre mon équipage à plat-pont. Seuls les chefs de pièce restèrent debout, avec ordre de se coucher aussi dès qu'ils auraient tiré. Au moment où le Boyne ouvrit son feu sur nous, je m'avançai au pied du grand mât et je dis à l'équipage, au milieu d'un profond silence : « Mes amis, je vous fais mettre à plat-pont pour un vaisseau de cent canons. Vous ne vous y mettriez pas pour une frégate, n'est-ce pas? — Non! non! Commandant », s'écria-t-on de toutes parts. Beaucoup voulaient se relever : les officiers eurent quelque peine à les contenir. Le Boyne approchait rapidement : il fit une embardée et nous envoya sa volée tout entière, à portée de fusil. La volée passa, en sifflant, dans le gréement : pas un homme ne fut tué ou blessé.
L'Adrienne ne s'en tira pas si heureusement ; le Boyne, en se repliant, la salua d'une décharge entière : huit hommes restèrent sur le carreau. »
La division française serrait de si près la terre que les Anglais ne l'attaquaient pas avec la vigueur qu'ils auraient montrée sans doute s'ils n'eussent été retenus par la crainte de s'échouer. Le Romulus, cependant, assez mauvais marcheur, demeurait peu à peu en arrière. Il existait déjà un grand intervalle entre ce vaisseau et le Trident. Le Boyne ne pouvait plus rien contre le Trident, rien contre les frégates; il entreprit d'arrêter le Romulus.
Trois ou quatre autres vaisseaux anglais joignirent leur feu à celui du Boyne. Le capitaine Rolland fut blessé d'une mitraille à la tête, on l'emporta sans connaissance dans le faux-pont. Les officiers, par bonheur, tinrent ferme : l'un d'eux, le lieutenant de vaisseau Genebrias, prit le gouvernail. On donnait, en ce moment, dans la rade; le Romulus rasa le cap Brun de si près que son bout-dehors de bonnette faillit, assure-t-on, s'y accrocher. C'est du moins la tradition que se sont transmise de bouche en, bouche les vieux marins dont le doux soleil de Provence réchauffe, sur le chemin de ronde du fort Lamalgue, les membres aujourd'hui engourdis.
Si brave et si entreprenant que fût un capitaine anglais — je le répète pour la centième fois, — il ne se souciait jamais d'affronter le feu des batteries de côte. Le commandant du Boyne tint le vent, dès qu'il s'aperçut qu'avec la brise régnante il doublerait tout juste le cap Sepet. Le fort du cap Brun et le fort Sainte-Marguerite auraient dû cependant lui apprendre, par leur majestueux silence, que les batteries françaises, loin de mordre, n'aboyaient même pas. Le combat avait lieu un dimanche : les canonniers étaient allés se promener.
L'amiral Emériau expédia, pour servir les pièces délaissées, des officiers, des matelots, des gargousses.
Le secours arriva plus tard.
Lord Exmouth — je transcris ici l'appréciation de l'amiral Baudin, sans dissimuler que je la trouve peut-être un peu sévère — n'a pas, dans cette circonstance, fait preuve d'une grande résolution. Il connaissait la situation de notre escadre et l'état de faiblesse de ses équipages : il pouvait entrer dans la rade et s'en rendre maître en y écrasant nos vaisseaux. Un coup d'une telle audace n'allait pas à son caractère, plus actif et plus ferme qu'entreprenant. Quand il vit que le Boyne, serrant de très près le Romulus, pouvait, par suite de ses avaries, être obligé d'entrer, avec son adversaire, jusque dans la rade de Toulon, il passa sur le gaillard d'avant de son vaisseau, le Caledonia, et fit, avec son chapeau, signal au capitaine du Boyne de serrer le vent et de s'éloigner.
Ce fut ce qui mit fin au combat. »
(L'Amiral Baudin, par le Vice-Amiral Jurien de la Gravière.)
(Plon, éditeur.)
Les marins à la Grande Armée
(1814)
DÈS les premiers jours de 1814, il nous arriva un décret impérial, portant qu'il serait créé à Cherbourg, dans quatre des équipages de haut bord qui armaient l'escadre, quatre compagnies de marins, artilleurs de cent vingt hommes, chacune, — choisis parmi les hommes au-dessus de la taille moyenne, qui auraient autant que possible du mérite à la mer (c'est-à-dire un supplément de solde), et ils devaient surtout être pris parmi ceux appartenant aux départements de l'ancienne France. Ces quatre compagnies devaient immédiatement être dirigées sur la Grande Armée et leur personnel, quoique passant au compte du département de la guerre, conservait sa solde de mer, ses suppléments, etc.
Ces compagnies étaient vraiment des compagnies d'élite.
Les officiers de marine qui étaient dans les équipages, surtout les plus jeunes, demandaient à l'envi à être placés dans ces belles compagnies ; car tous étaient fatigués de l'oisiveté de la marine, dans le moment d'une crise aussi terrible pour la patrie. J'eus le bonheur d'être désigné comme lieutenant en 1er à la 3e compagnie, appartenant au 9e équipage; c'était un brave lieutenant de vaisseau, appelé Tétiot, qui la commandait.
Je vais donc cesser d'être marin et parcourir momentanément une autre carrière. Je vais entrer comme petit acteur dans le grand drame politique de cette année 1814, si mémorable. Mes souvenirs de cette époque sont restés bien gravés dans ma mémoire, comme si un seul sommeil m'en séparât. Soldat dans les dernières grandes crises de l'Empire, j'ai assisté aux dernières luttes. J'étais jeune, enthousiaste et, je crois, assez brave.
Nous fûmes dirigés sur Vincennes, l'ordre avait été donné de nous faire partir en poste : voyager de cette manière, c'était le faire dans des charrettes de paysans, qui étaient mises en réquisition par l'officier qui précédait d'une journée le détachement, et cela à chaque étape réglementaire ; on en franchissait habituellement trois ou quatre dans un jour, selon leur longueur et l'état des routes. Chaque charrette à deux chevaux portait dix hommes avec leurs bagages.
Cette manière de voyager, toujours au trot, sur des routes mal ferrées et sillonnées d'ornières profondes, était plus fatigante que tout ce qu'on peut imaginer. Après les cinq jours que nous mîmes à faire ce trajet de quatre-vingt-dix lieues, nous étions sur les dents, d'autant plus que nous eûmes un temps affreux.
Le Ministre de la guerre ne voulut pas que notre détachement entrât dans Paris, et cela, vu l'esprit bien connu du matelot. L'ordre avait été donné à Saint-Germain-en-Laye de mettre des fiacres à notre disposition ; nos marins ne se possédaient pas de joie de se trouver ainsi pour la première fois de leur vie dans des voitures ; mais leur contentement cessa bientôt quand ils virent ces équipages, dans lesquels ils étaient renfermés, courir grand train sur les boulevards extérieurs de la capitale et la contourner; la mesure était bonne, car je ne doute pas que la plupart de ces hommes ne fussent restés d'un côté et d'autre dépenser le peu d'argent qui leur avait été soldé avant le départ.
Les casernes de Vincennes n'étaient pas disposées pour nous recevoir; nous fûmes mis en billet de logement à Montreuil, où nous restâmes trois jours. Les compagnies furent mises à la disposition du général de division d'artillerie Neigre, qui commandait le parc de réserve qui s'organisait à Paris. Le général de brigade Prost fut chargé de l'instruction spéciale des marins, auxquels on ne laissa pas un instant de repos. Dans la journée, on les exerçait à la manœuvre des pièces de campagne, on leur faisait charger des obus, on leur apprenait à placer convenablement dans les caissons des boulets ensabotés avec leur gargousse; enfin, à se familiariser avec tous les travaux qui se rattachaient au métier d'artilleur. Le général Prost était émerveillé de leur adresse et de leur intelligence, et en peu de jours ils furent capables d'être mis en campagne.
L'armement de nos hommes se composait simplement du petit sabre appelé briquet, suspendu à un baudrier noir ; presque tous avaient à bord des vaisseaux reçu des leçons d'escrime : non seulement ils savaient manier le sabre, mais ils savaient aussi tirer de l'épée ; un grand nombre d'entre eux étaient munis de fleurets démouchetés qu'ils portaient attachés le long de leur sabre.
Cette troupe d'un aspect nouveau, avec ces petits chapeaux noirs vernis, prêta un peu à rire aux autres canonniers casernés aussi à Vincennes ; les matelots se montèrent la tête, devinrent querelleurs, le désordre s'établit dans le château. Il y eut des mêlées, et des coups de sabre furent échangés. Le général Neigre accourut, fit évacuer le château aux troupes d'artillerie à cheval qui s'y trouvaient, et les compagnies de marins furent consignées. Les matelots n'entendirent pas rester ainsi claquemurés ; extrêmement lestes et agiles, ils descendaient par les fenêtres de cette mauvaise citadelle, qui donnent sur les fossés du château, et par les tours qui sont aux angles. Je crois qu'ils auraient même trouvé le moyen de sortir du donjon, s'ils y avaient été enfermés.
Les punitions de police appliquées aux troupes n'avaient pas le moindre effet sur nos marins. Le général Neigre revint, se plaignit de notre indiscipline et les officiers furent sévèrement admonestés; les capitaines lui déclarèrent que les règles militaires étaient insuffisantes, que le matelot avait ses mœurs à part et qu'il ne comprenait que les règles de discipline suivies à bord des vaisseaux. Le général finit par dire : «Eh bien, conduisez vos hommes comme vous l'entendrez; je fermerai les yeux, car je ne dois pas voir.
À compter de ce moment, la discipline se rétablit complètement et nous n'eûmes depuis que des éloges à recevoir. Il y a quelque chose de pénible à parler ainsi de ces braves matelots ; mais ils avaient des mœurs à part. Le caractère de l'homme de mer s'est bien modifié depuis cette époque.

(Mémoires pittoresques d'un officier de marine, par le capitaine Leconte.)
Les marins à Paris et à Fontainebleau
(1814)
DANS ces premières heures du 30 mars, il faisait une belle nuit d'hiver, très froide et calme. Une brume épaisse couvrait la capitale et ses environs ; à peine si les objets pouvaient s'apercevoir à quelques pas.
Le colonel Lambert, qui était notre oracle, nous dit : que si pareil temps continuait pendant le jour, toute bataille serait impossible, et que c'était la meilleure espérance à conserver. À cinq heures, au moment où le jour commençait à poindre, nous étions à la Villette; des coups de fusil isolés, mais fréquents, tirés dans le bois de Romainville, nous apprirent que les hauteurs de ce bois étaient occupées par l'ennemi.
Bientôt la fusillade devint continuelle et roulante; les vapeurs s'élevaient et la brume se dissipait peu à peu; les coups de canon commencèrent aussi à résonner et la bataille était engagée depuis le point où nous nous trouvions jusqu'au-delà de Vincennes.
Je reçus l'ordre de me porter immédiatement avec deux pièces de canon en avant de Belleville. Les boulets des batteries ennemies, qui pleuvaient autour de nous, nous faisaient éprouver des pertes, surtout en chevaux. Je ne fis pas riposter, mais nous dirigions nos coups à mitraille sur les escadrons ennemis, qui venaient jusque sous la bouche de nos canons pousser des charges sur notre cavalerie, qui, débouchant de la Villette, luttait avec courage et ramenait l'ennemi dans la vallée ; dans ces moments-là, je faisais cesser le feu.
La mitraille nous fit défaut, les caissons n'en contenaient que le huitième de leur charge; la journée s'écoulait et l'action ne se ralentissait pas. Nous dépensions énormément de munitions; elles nous arrivaient de Vincennes dans de grands coffres à bagages ; elles étaient de bonne qualité, et il est absolument faux qu'il en ait été délivré de mauvaises, ainsi que bien des gens l'ont raconté dans le temps.
Vers deux heures de l'après-midi, rien n'était changé devant nous : l'ennemi s'était maintenu et n'avait pas avancé ; mais il n'en était pas de même sur les autres points. Je vis accourir le colonel Lambert, qui vint à moi; je ne l'avais pas revu depuis le matin ; il m'appela à l'écart, me dit que la bataille était perdue; il me dit de rester dans ma position autant que possible, de ne la quitter que lorsque je ne serais plus soutenu par la cavalerie que j'avais à ma droite; de me diriger alors sur la gauche vers un point qu'il m'indiqua que j'y trouverais un ravin (les Carrières Américaines), d'y précipiter mes canons et de venir le rejoindre avec mes hommes près de la barrière voisine.
Mes matelots étaient animés, leurs figures tout en sueur étaient noircies par la fumée du canon, plusieurs d'entre eux étaient couverts de sang, leur ardeur était extrême. L'un d'eux eut l'imprudence de mettre dans son canon, ainsi que cela se pratique sur nos vaisseaux où nous faisons usage de pièces de fonte de fer, une double charge à boulet et à mitraille : la pièce ne creva pas, mais elle affaissa l'essieu de son affût et se trouva ainsi hors de service. Je tins encore bon pendant quelque temps; il était à peu près quatre heures quand, presque isolé, je pris le parti d'exécuter l'ordre qui m'avait été donné. En arrivant près d'un terrain qui a un versant rapide sur le village de Pantin, je me trouvai arrêté par une masse d'infanterie russe qui gravissait le coteau au pas de charge ; je fis mettre de suite en batterie et fis faire une décharge à mitraille. Le coup ne put pas être pointé assez bas; l'ennemi n'en souffrit pas et il accéléra sa marche en poussant des hurlements et des hourras. Je fis précipitamment dételer les chevaux, sur lesquels je fis monter les matelots, et nous prîmes la fuite au milieu d'une grêle prodigieuse de balles.
Peu d'instants après, j'arrivais près de la barrière, où je fus arrêté par le duc de Padoue, qui m'indiqua le point où se ralliaient les artilleurs. Rendu là, j'y trouvai mon canon démonté, le seul de la batterie qui ne fût pas tombé au pouvoir de l'ennemi.
Aussitôt que le colonel Lambert, qui nous avait rejoints, nous vit ralliés, il nous fit entrer dans Paris avec notre canon et quelques caissons. Nous nous dirigeâmes vers le Champ de Mars, où se trouvait un parc de réserve et d'artillerie.
Nous eûmes donc à traverser Paris. Cette ville était plus calme et plus paisible que nous ne devions le supposer. Quelques patrouilles d'hommes armés de piques se trouvèrent sur notre chemin. Les magasins étaient presque tous ouverts, et les marchands accouraient sur le seuil des portes pour nous voir passer. Cette impassibilité et cette indifférence apparente pour les affaires nationales indignaient même nos matelots ; c'était à ne pas y croire.
La nuit était close lorsque nous arrivâmes au Champ de Mars. Le nombre des canons et des voitures d'artillerie qui s'y trouvaient était considérable. On s'occupa de suite des moyens à prendre pour soustraire ce matériel aux alliés : tous les chevaux de fiacre que l'on put trouver furent mis en réquisition.
Une nouvelle batterie de huit pièces de douze fut donnée à la compagnie des marins et attelée par les restes des chevaux de nos deux escadrons du train.
Notre personnel se trouvait assez réduit : la perte que nous avions éprouvée était de trente hommes tués ou blessés grièvement dans les affaires de Meaux, de Clayes et dans la bataille de Paris. Notre effectif formait encore une belle compagnie de quatre-vingt-dix hommes remplis de courage.
Le colonel Lambert était chargé de l'évacuation du Champ de Mars. Il partagea le parc en deux convois. À deux heures du matin, nous nous mîmes en route pour Orléans. Il ne faisait pas encore jour lorsque nous fûmes arrêtés : c'était l'Empereur que nous rencontrions ; il fit appeler notre chef et lui donna l'ordre de changer notre direction et de nous diriger sur Fontainebleau en passant par Essonnes.
Nous arrivâmes à Fontainebleau à sept heures du soir : c'était une longue marche, après la journée fatigante de la veille. La ville était extrêmement encombrée. La garde impériale venait aussi d'y arriver; elle était en bon état. Les quatre régiments de la vieille, tenus constamment au grand complet, étaient remarquables. Des détachements venant des dépôts accouraient de tous côtés. Le comte Sorbier, qui commandait la réserve d'artillerie, la fit parquer en dehors de la ville, et nous établîmes notre bivouac à l'entrée de la forêt la plus voisine du château, près d'un petit obélisque.
Le lendemain 1er avril, les diverses divisions de la Grande Armée ralliaient. La gendarmerie de Paris, forte d'environ deux mille hommes, commandée par le maréchal Moncey, arriva aussi ; elle était exaltée contre les Parisiens et communiquait son indignation à toutes les troupes, qui étaient persuadées que si la garde nationale avait donné, la capitale ne serait point tombée au pouvoir de l'ennemi. Les gazettes de Paris qui nous arrivèrent annonçaient que les alliés étaient reçus comme des libérateurs, et la tête des soldats se monta de plus en plus.
L'Empereur passa en revue la garde impériale et quelques divisions d'infanterie. Le 2, il passa celle de la gendarmerie, qui avait son vieux maréchal en tête. J'y assistai comme curieux, pouvant, vu la ressemblance des broderies du collet de mon habit avec celles de l'état-major, me placer parmi eux. Cette revue fut passée dans la cour du palais. Napoléon se plaça sur les marches du perron, et les escadrons en bataille défilèrent au trot devant lui. Quand le premier vint à passer, l'Empereur le fit arrêter, et il me semble encore entendre ces paroles qu'il prononça d'une voix vibrante : Eh bien! vieilles carcasses, chargerez-vous comme il faut? Et l'escadron passant au trot, ces vétérans, qui appartenaient à la gendarmerie de Paris, se mirent à crier : A Paris, à Paris! Les autres escadrons en firent autant en passant devant l'Empereur.
Le 3 avril, dès cinq heures du matin, l'armée se mit en mouvement et prit avec ardeur la route de Paris. Nous traversâmes Fontainebleau et fûmes avec l'artillerie jusqu'à la lisière de la forêt. Alors an bruit sinistre se répandit : le duc de Raguse était passé à l'ennemi ! Les premières nouvelles de cette grave défection nous furent apportées par une centaine de cavaliers qui appartenaient à ce corps irrégulier de Polonais qui avait combattu avec nous à Claye et à Paris.
La consternation et le désappointement égalaient l'indignation que nous éprouvâmes. L'ordre immédiat nous fut donné de rentrer à Fontainebleau, et nous prîmes nos bivouacs. Ce qui se passa depuis est fort connu. L'Empereur entra en pourparlers avec les souverains alliés et leur expédia quelques hommes qu'il croyait ses fidèles.
Sans la défection du duc de Raguse, bien évidemment une tentative était faite sur Paris, et les alliés pouvaient être amenés à traiter avec moins d'exigence avec leur habile adversaire; mais quel eût été le sort de Paris? l'armée était si montée contre la population de cette ville!
Le lendemain de ce jour, le général Gérard, depuis maréchal, arriva avec une belle division de dix mille hommes de troupes fraîches retirées d'Espagne : l'Empereur en passa immédiatement la revue. Sa figure était, comme de coutume, calme et sereine. Il n'avait près de lui que peu de maréchaux; le général d'artillerie Drouot était un des généraux qu'il conservait le plus près de sa personne. Il donna encore des croix en assez grand nombre, au milieu des cris répétés de vive l'Empereur! Je ne l'ai pas revu depuis ce jour, et son portrait est profondément gravé dans mon cœur.
Nous recevions les journaux de Paris : leurs diatribes contre notre idole nous rendaient furieux. On parlait des Bourbons, et nous nous demandions leurs noms et ce qu'ils étaient. La censure qui sous l'Empire régnait sur les journaux ne leur permettait pas de dire un seul mot sur cette famille; du reste elle était mise en oubli par la généralité de la nation. La dictature impériale était au fond si libérale, la législation était si en harmonie avec le principe d'égalité, l'esprit guerrier était tellement général, que le mécanisme d'un gouvernement constitutionnel était absolument inconnu aux jeunes gens de mon époque, qui ne voyaient que l'Empereur et ne rêvaient que la gloire.
Des écrits imprimés furent répandus parmi les soldats et les portaient à la désertion : toutes les recrues qui faisaient partie des détachements de dépôts quittèrent leur corps à l'envi ; dans notre batterie, plus de la moitié des soldats du train, qui étaient des paysans retirés depuis peu de leurs charrues, désertèrent.
Au nombre des émotions que nous éprouvâmes, je citerai celle que nous causa l'annonce de l'abdication de Napoléon en faveur du roi de Rome; si elle ne nous satisfaisait pas, au moins l'idée nous en fut supportable, car nous ne supposions pas qu'il pût arriver pis.
Dans la nuit du 6 au 7, un grand mouvement se fit dans les bivouacs; il était causé par le bruit qui se faisait en ville : on parlait d'une abdication en faveur des Bourbons. Les Polonais de la garde impériale, commandés par le général Dombrowski, venaient de monter à cheval et voulaient marcher sur Paris; on eut de la peine à les contenir. Le triste événement sujet de cette rumeur était vrai; il fut dans la journée annoncé à l'armée, ainsi que le départ de l'Empereur pour l'île d'Elbe. On faisait dans la garde un choix de volontaires pour l'accompagner, elle se présenta tout à l'envi.
(Mémoires pittoresques d'un Officier de marine, par le capitaine Leconte.)
Le retour de l' île d'Elbe
(1815)
NAPOLEON vivait à Porto Ferrajo sur la foi des traités. Mais, dans un Congrès tenu à Vienne, il avait été question de le transporter hors d'Europe. L'Empereur, qui avait des émissaires partout, ne tarda pas à le savoir.
Comment?... je n'en sais rien; mais du jour où les puissances ne devaient plus observer vis-à-vis de lui la teneur du traité de Fontainebleau, l'Empereur n'avait plus aucun ménagement à garder, et sa décision fut bientôt prise.
Il fit venir à Porto Ferrajo les trois cents Corses, Piémontais ou Toscans cantonnés dans l'intérieur de l'île, ainsi que les lanciers polonais, dont les chevaux furent laissés dans les pâturages de Pianosa : ce déplacement n'était pas motivé et le transport eût été difficile; il réunit les huit cents hommes de la vieille garde mis à sa disposition par Drouot. Aucun de ces hommes ne connaissait l'entreprise projetée, et le secret fut même si bien gardé, que ce n'est que le 23 février que l'Empereur prévint les navires qui étaient en rade de se tenir prêts à appareiller, pour un embarquement ultérieur. Mais pour aller où? nul ne le savait. Et, chose prodigieuse! onze cents hommes vont mettre à la voile sur de frêles esquifs à peine armés, le brick l'Inconstant, de 26 canons, la goélette la Caroline, la felouque l'Étoile, l'aviso la Mouche, et trois autres bateaux frétés à Rio; en tout sept bâtiments, — pour essayer de reconquérir un empire de trente millions d'habitants.
Et cette poignée d'hommes réussira là où, dans toute autre circonstance, il eût fallu une grande et puissante armée.
J'étais monté avec l'empereur Napoléon, son état-major, sa suite et six cents hommes de troupe sur l'Inconstant, portant le pavillon blanc parsemé d'abeilles d'or. Le reste fut réparti sur la Caroline et les cinq autres bâtiments composant la flottille. On appareilla dans la nuit du 24 au 25 février; le lendemain, vers neuf heures du matin, on passait au milieu de la flotte anglaise, qui héla un de nos bâtiments, ne se doutant guère, en ce moment-là, que l'empereur Napoléon était sur l'un d'eux.
On continua de naviguer.
Le 27 février, nous nous trouvions bord à bord avec le brick de guerre français le Zéphyr, commandé par le lieutenant de vaisseau Andrieux, avec lequel nos officiers de marine s'entretinrent. (1)
Andrieux prit son porte-voix, salua le capitaine Tailladé, qui commandait l'Inconstant, et la conversation s'engagea :
« Où allez-vous ? demanda le premier.
— A Gênes, répond Taillade; et vous?
— A Livourne.
— Et comment se porte l'Empereur? demanda encore l'officier de la marine royale.
— Parfaitement.
— Tant mieux! » dit Andrieux, et par trois fois il cria, en se séparant de nous : « Bon voyage ! ...»
Puis il poursuivit sa route.
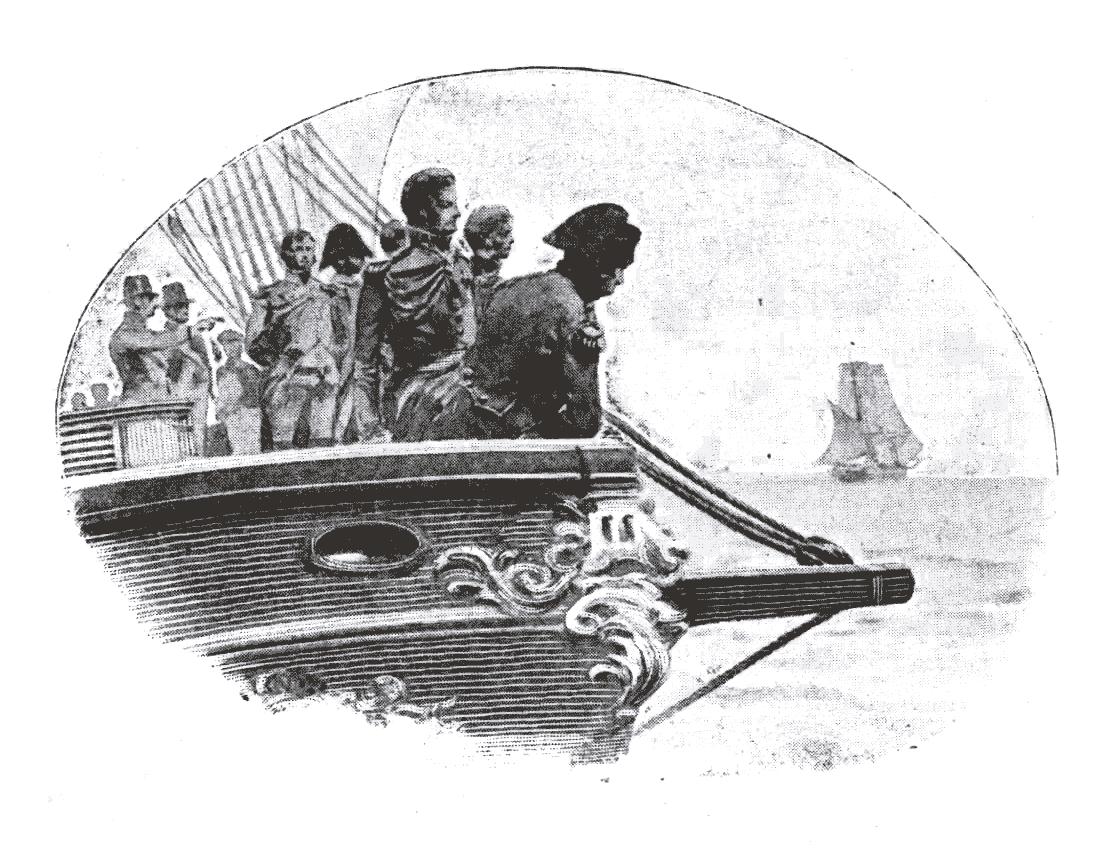 C'était le moment de faire un premier effort. Le capitaine Taillade proposa à l'Empereur d'aborder le Zéphyr, de l'enlever et de s'emparer de son équipage.
C'était le moment de faire un premier effort. Le capitaine Taillade proposa à l'Empereur d'aborder le Zéphyr, de l'enlever et de s'emparer de son équipage.
« Cette idée est absurde! s'écria l'Empereur se retournant vers ses officiers. À quoi bon compliquer mon projet de cet incident? Dans notre position il faut marcher vite et dédaigner les choses inutiles. »
Le 1er mars nous arrivions dans la baie de Cannes. Le débarquement s'y exécuta avec de grandes précautions et un ensemble admirable sur la plage du golfe Juan, à cinq heures du soir.
(1). Rapprocher ce récit de celui de M. Henry Houssaye dans 1815 : « On fit force de voiles et afin d'alléger la marche on coula bas un canot à la traîne. Vers quatre heures l'Inconstant avait doublé le cap Corse quand la vigie signala un bâtiment de guerre arrivant vent arrière. L'Empereur commanda le branle-bas. « Laissons-le approcher, dit-il, et s'il attaque, à l'abordage! » Les sabords furent enlevés, les pièces chargées. Après quelques instants, Taillade reconnut le Zéphyr. L'Empereur, qui était bien loin de vouloir un combat, ordonna aux grenadiers d'enlever leurs grands bonnets à poil et de se coucher sur le pont. Les deux bricks passèrent bord à bord. Sur l'ordre de l'Empereur, Taillade prit le porte-voix et héla le commandant du Zéphyr. »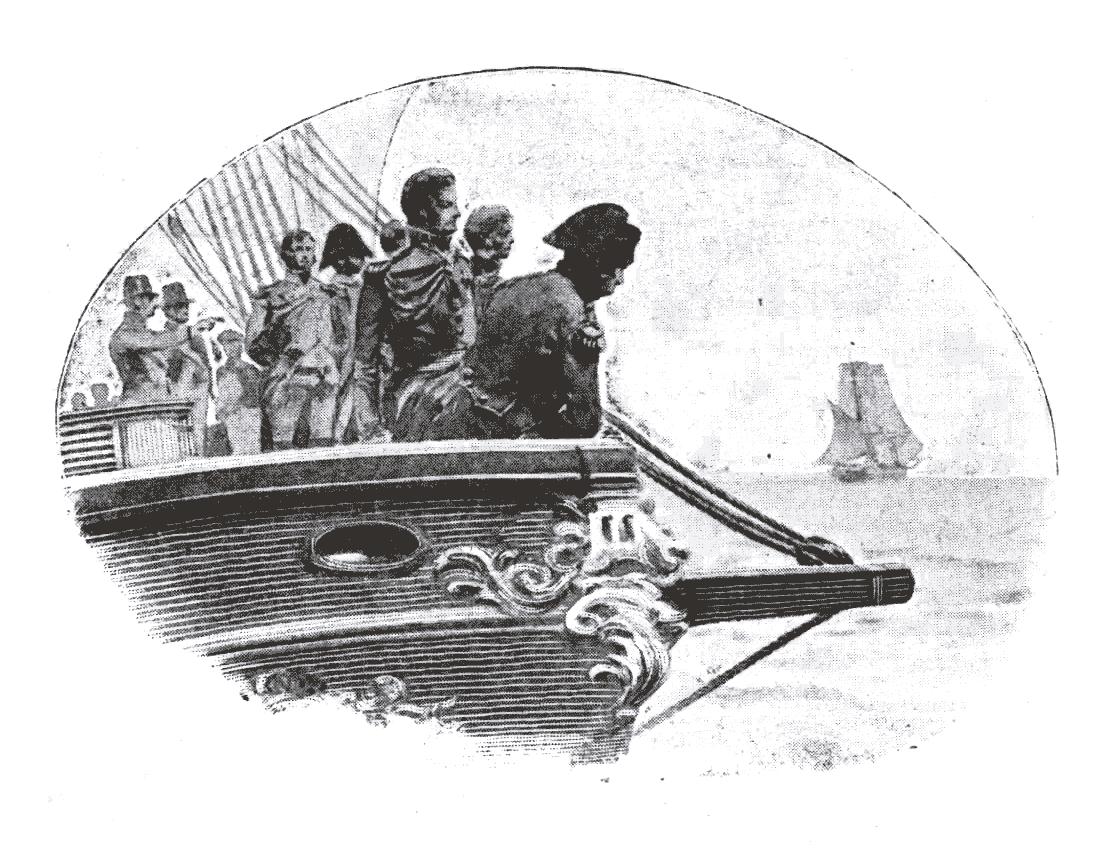

C.-0. MALLET,
Trésorier-payeur des armées.