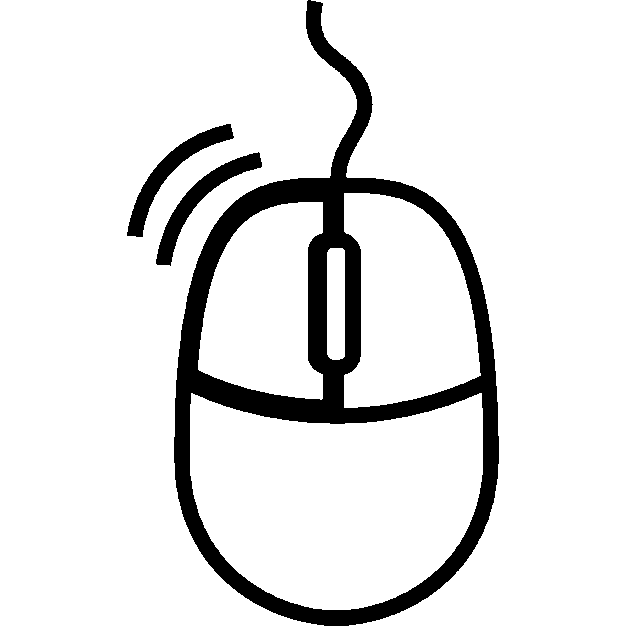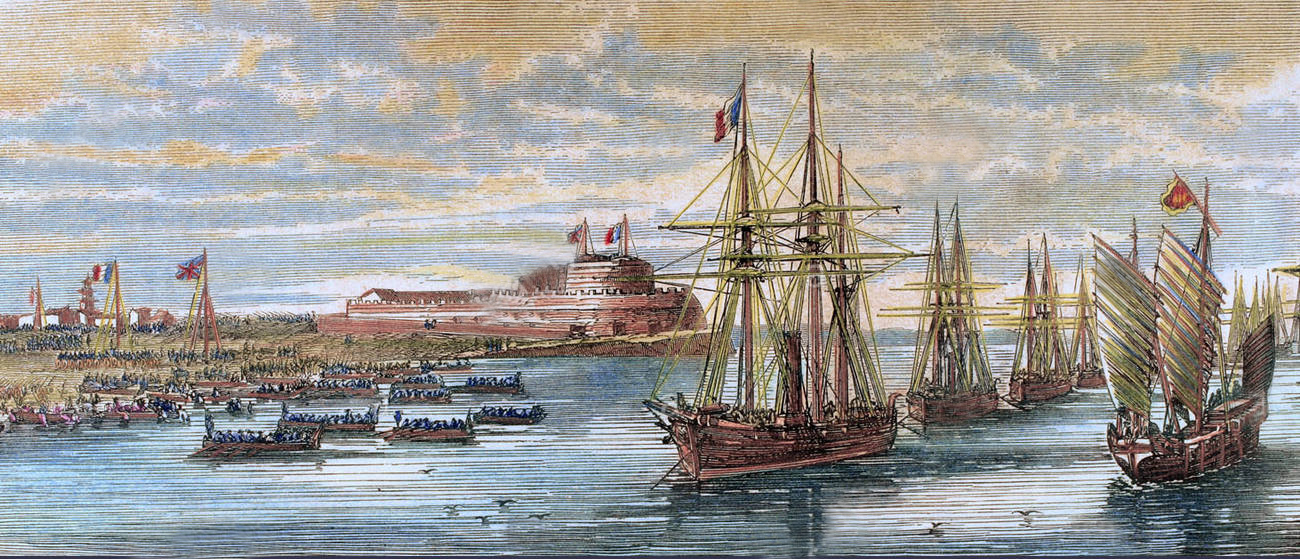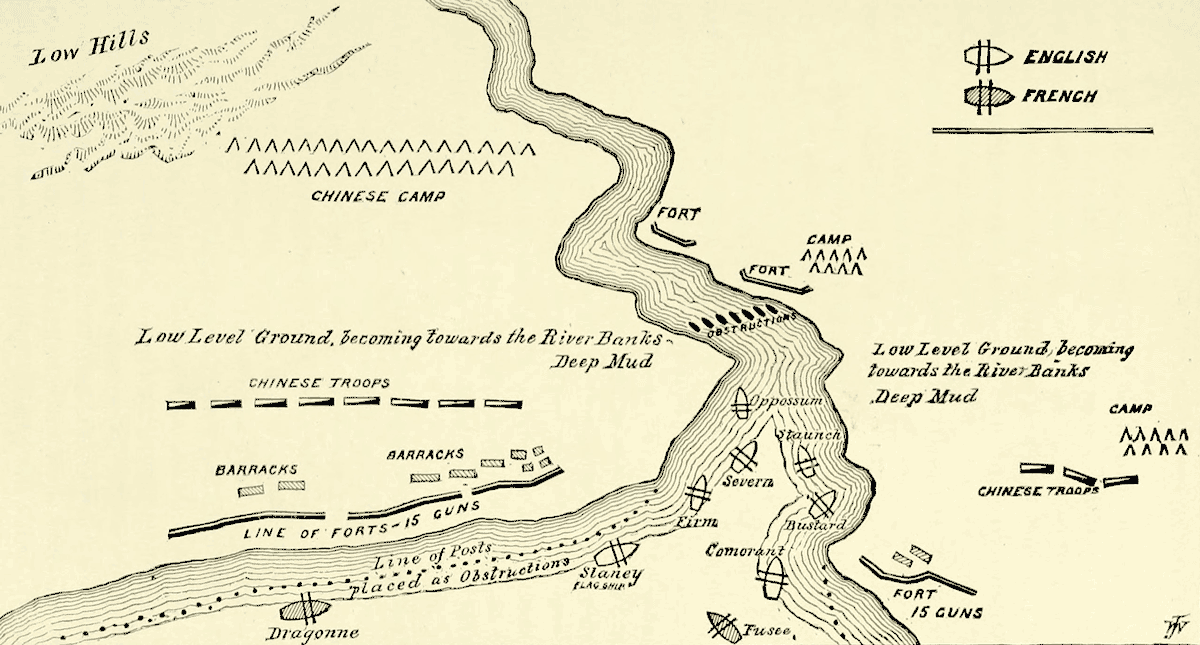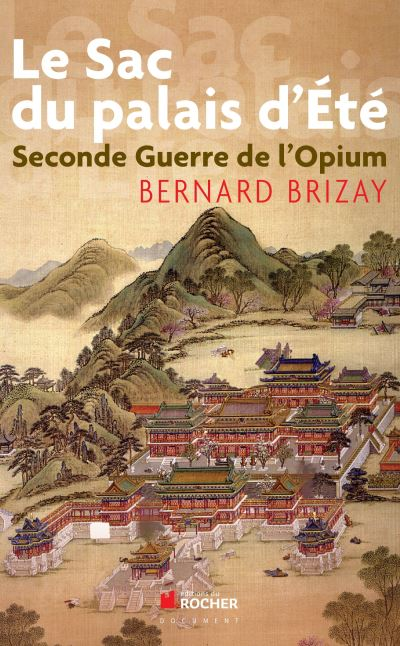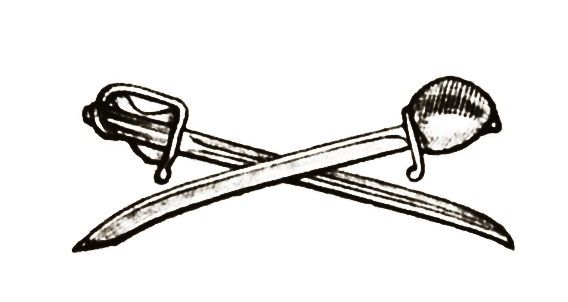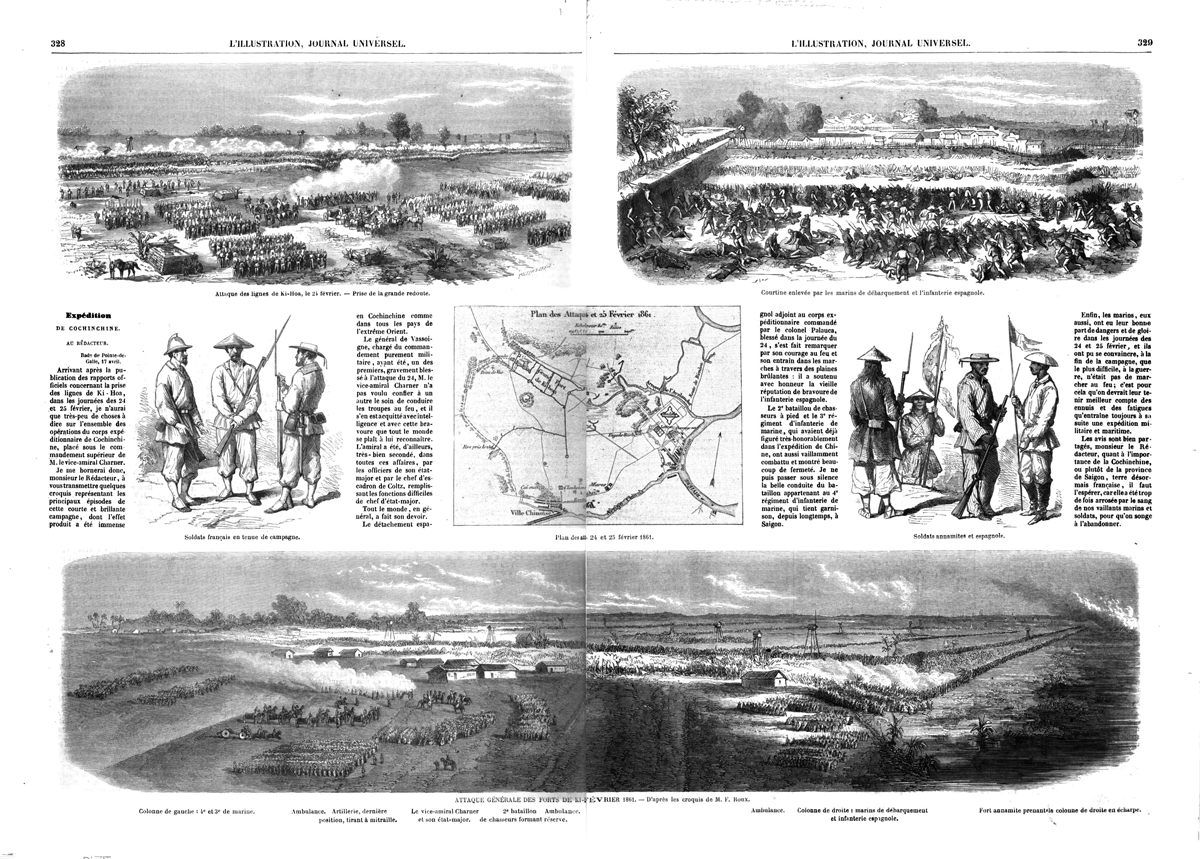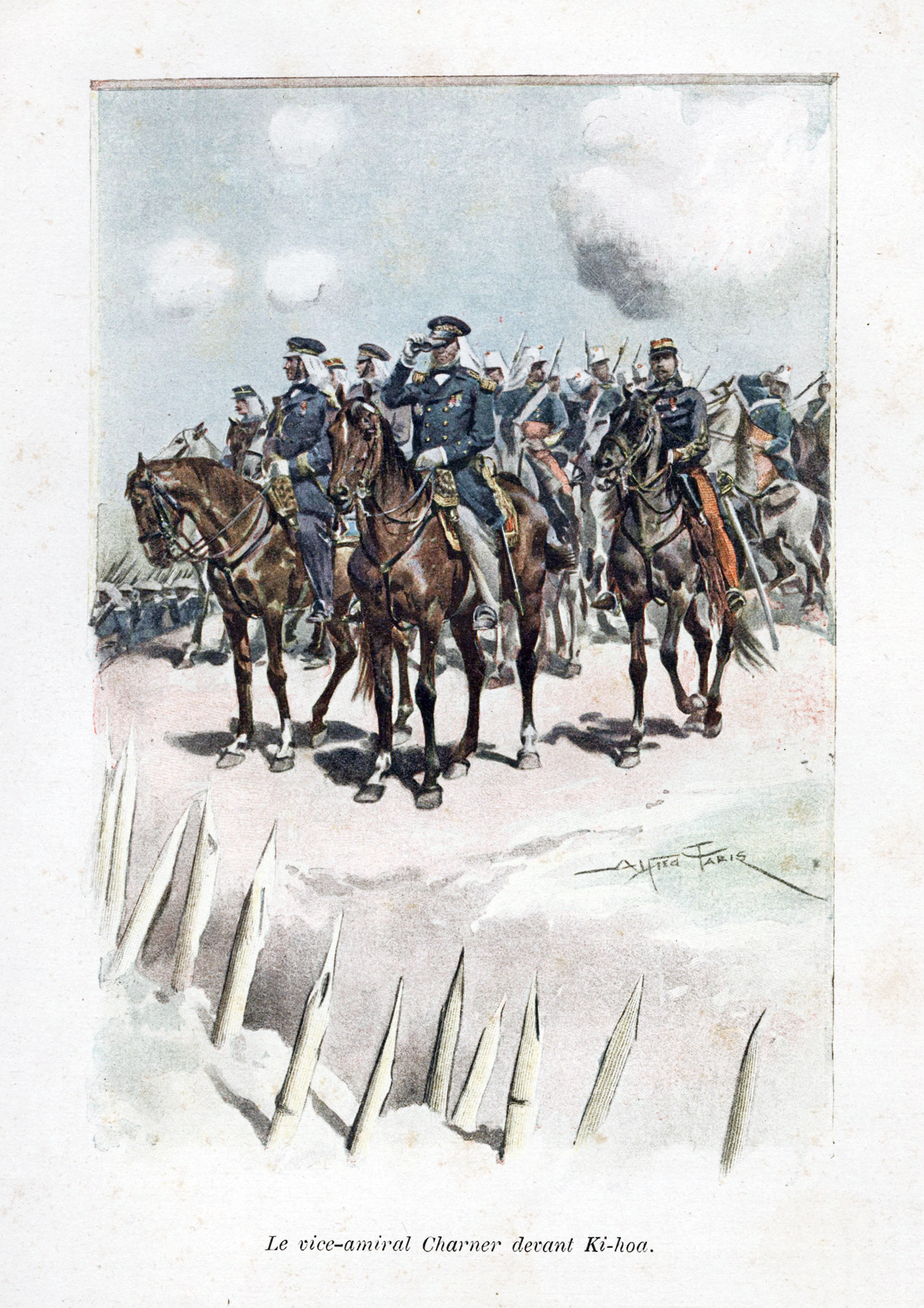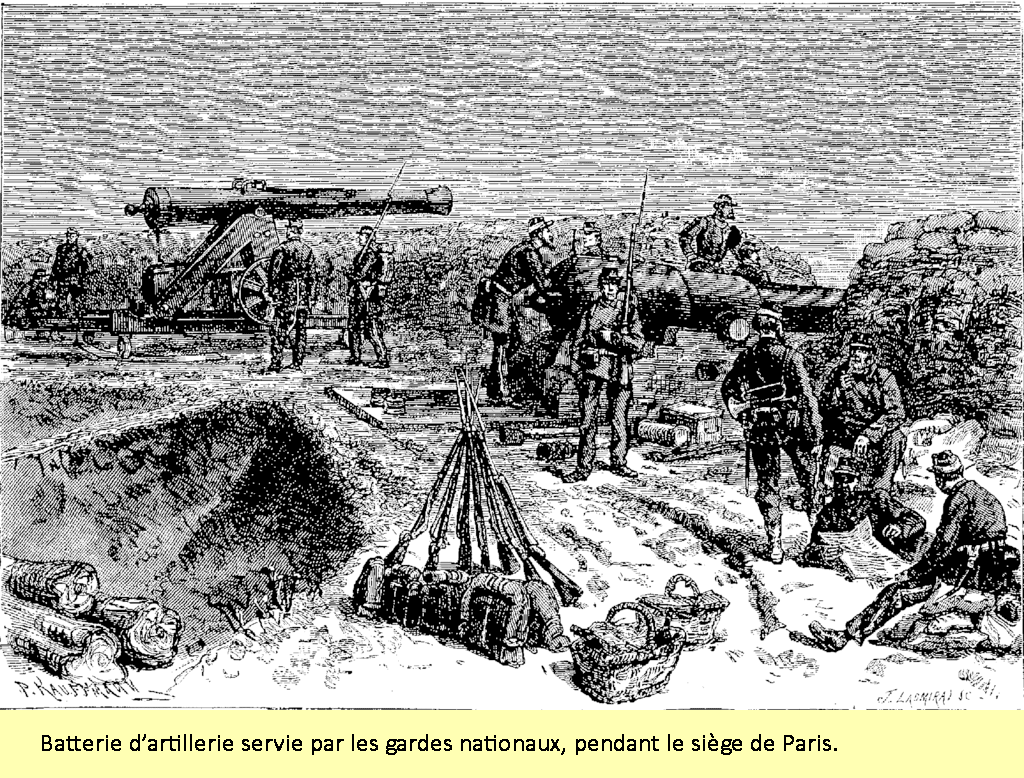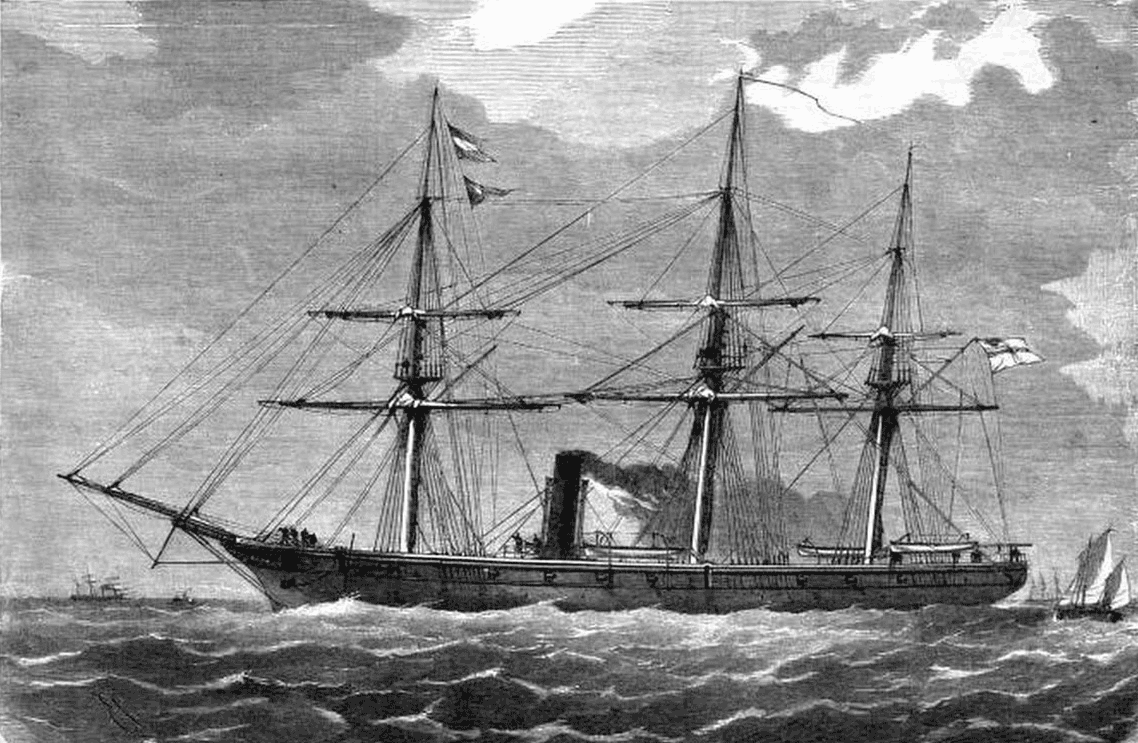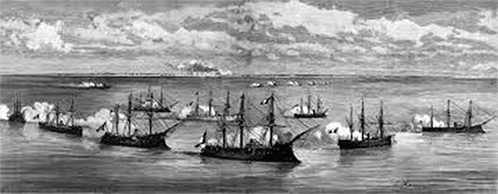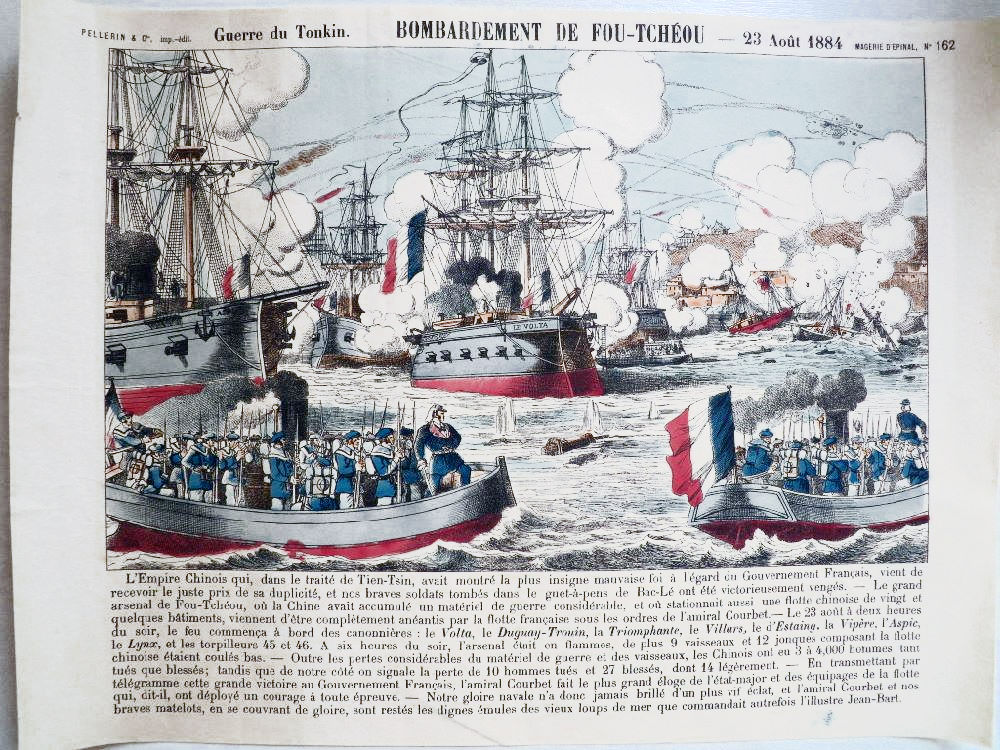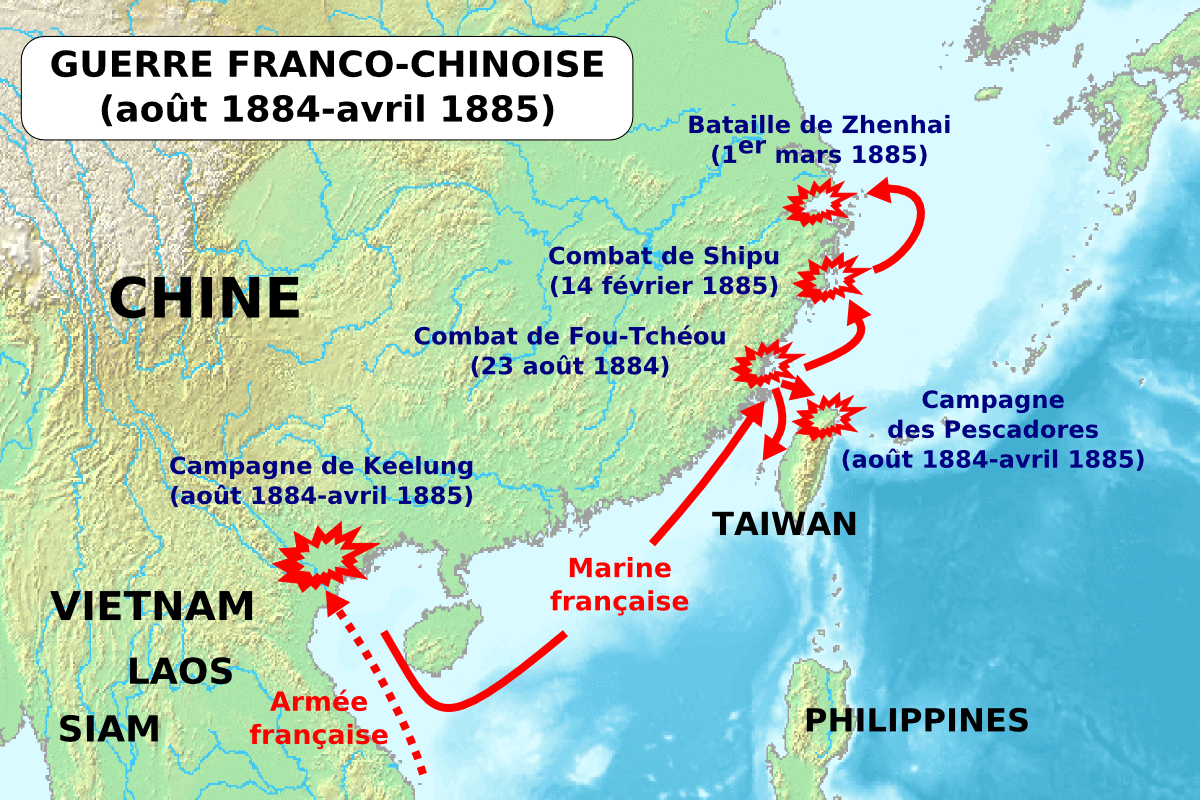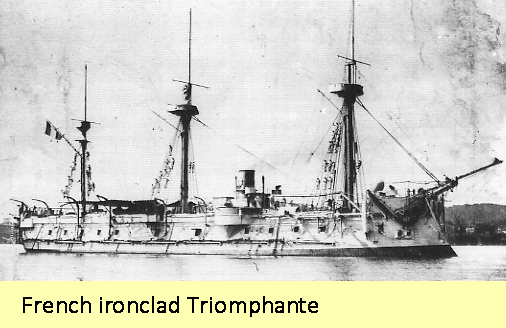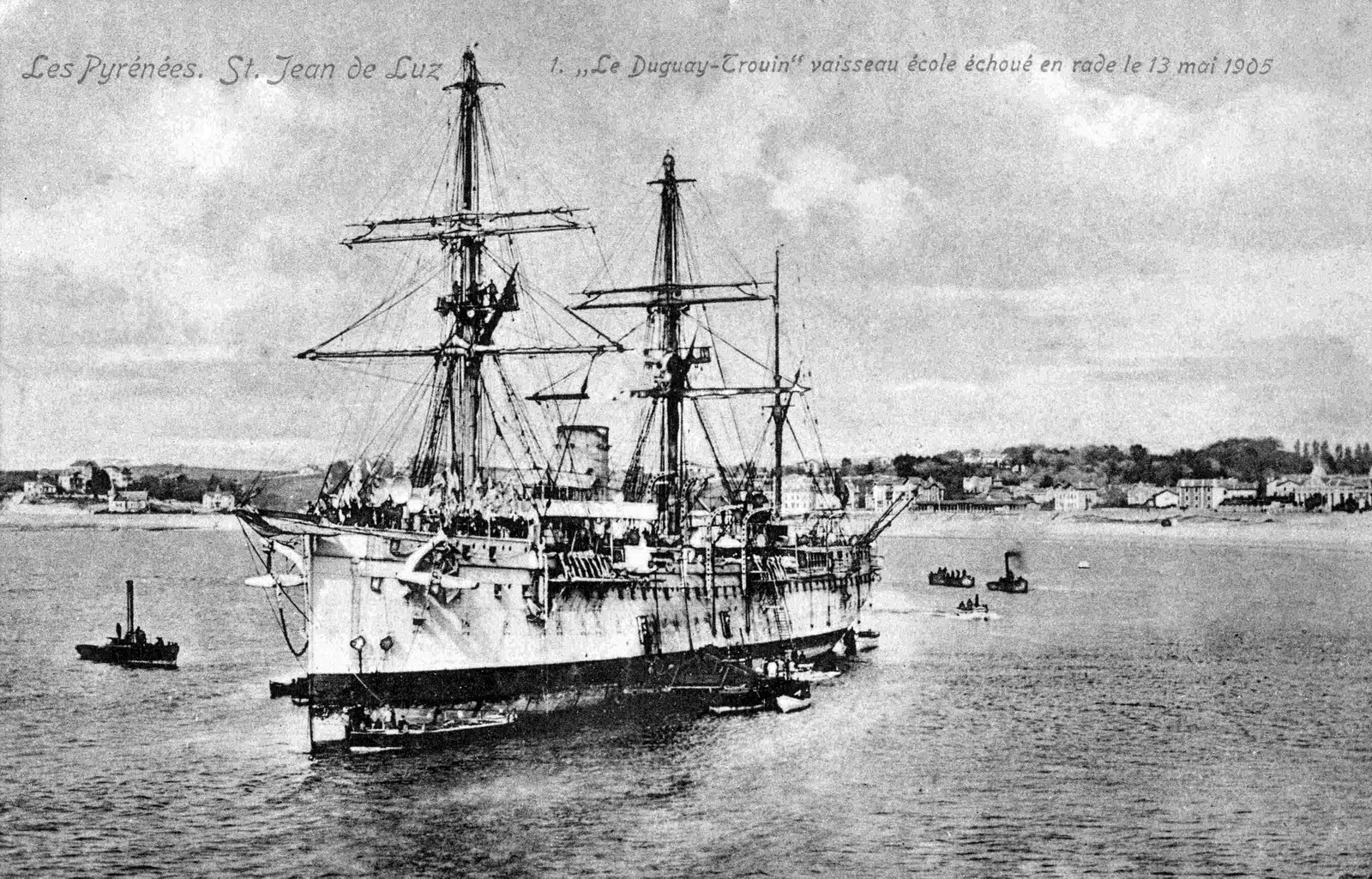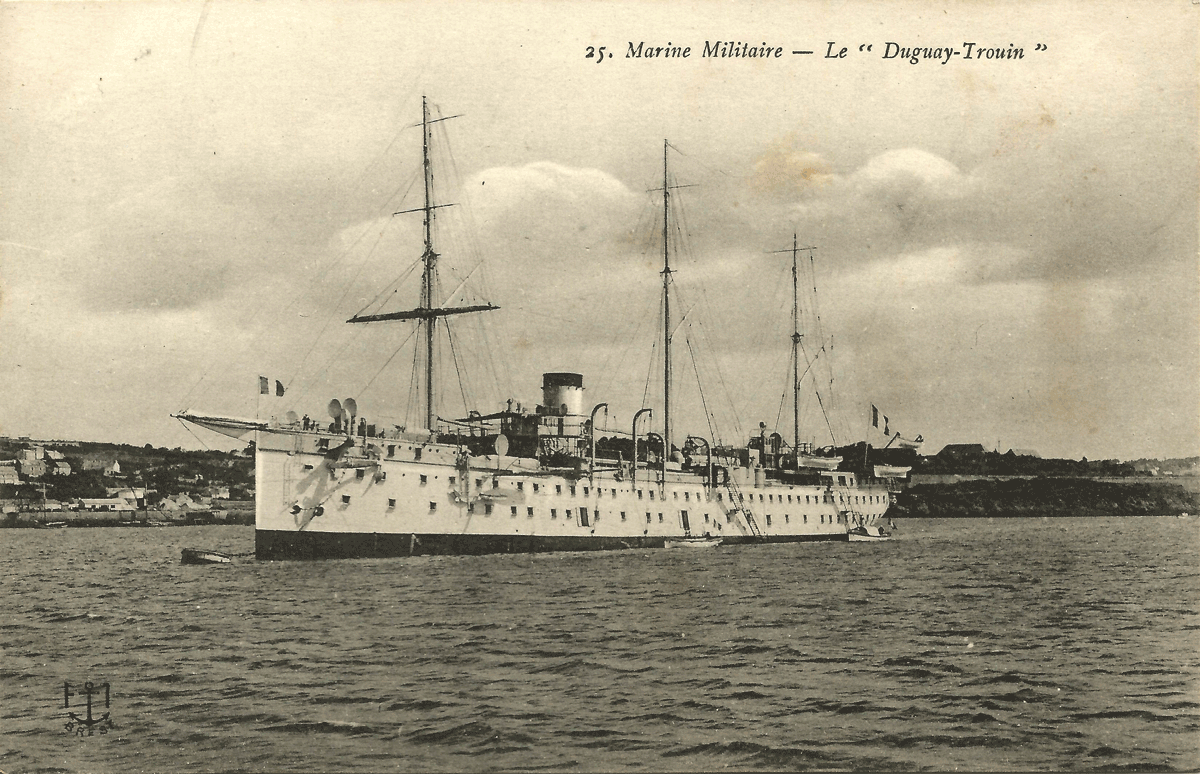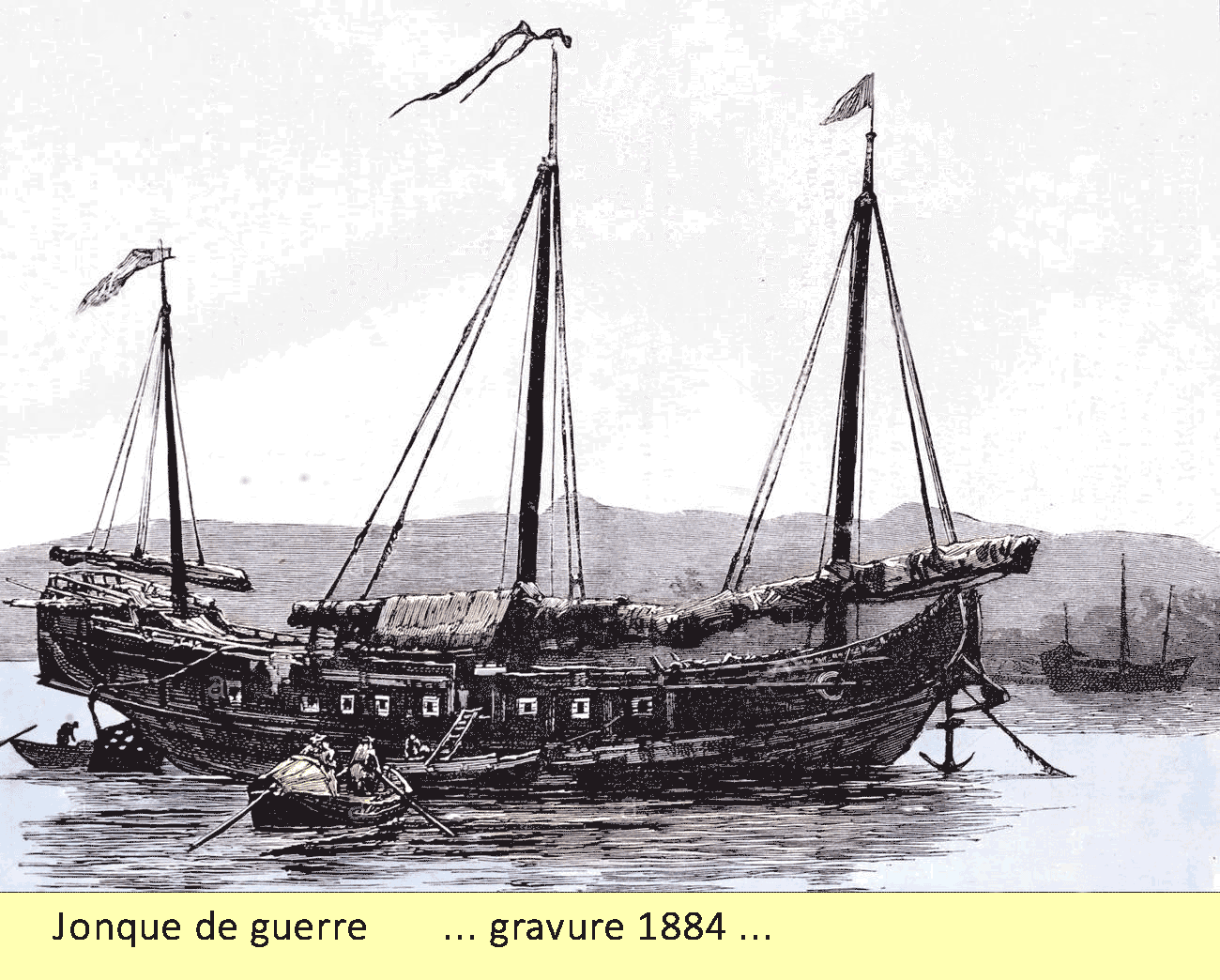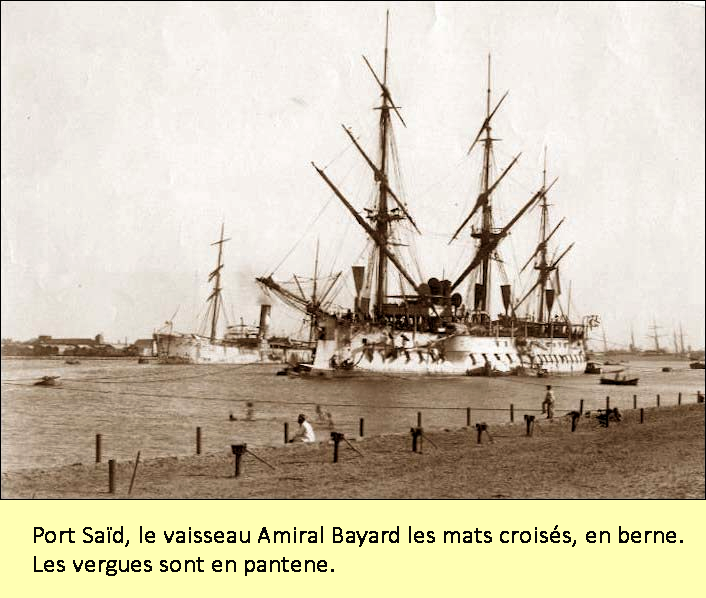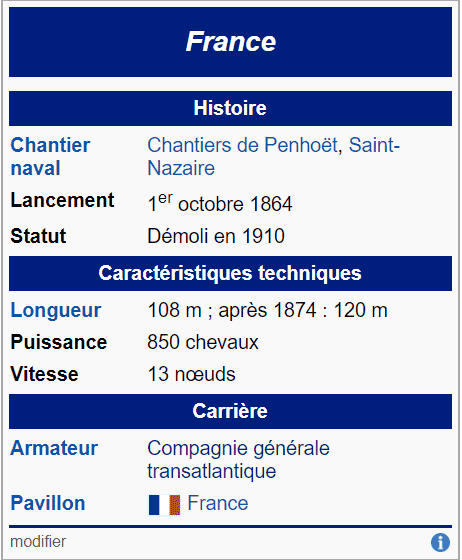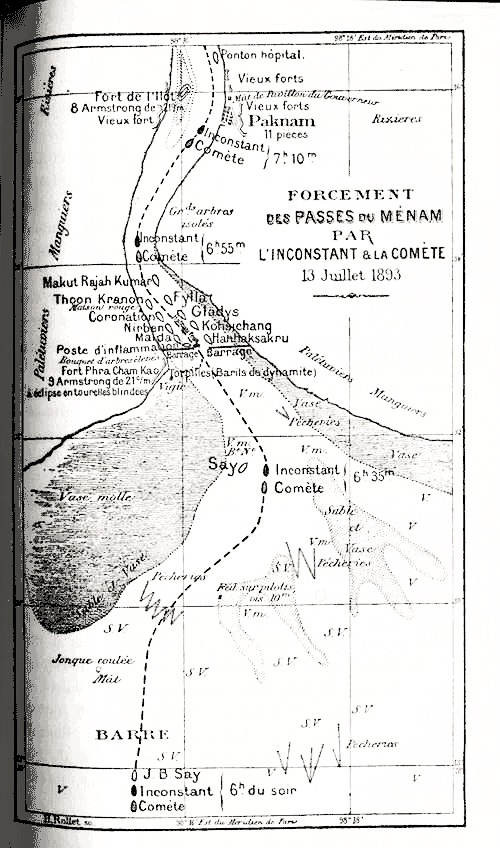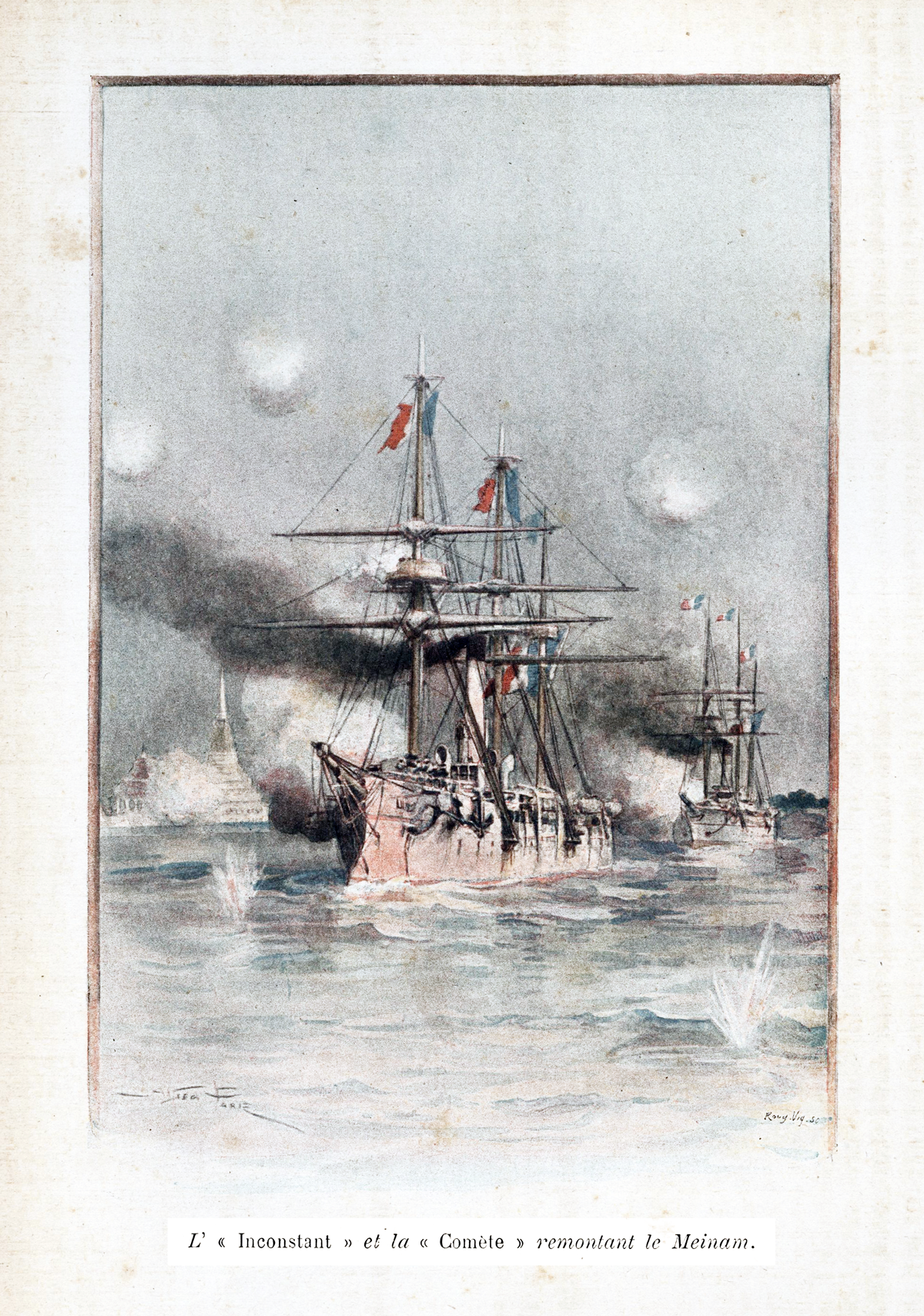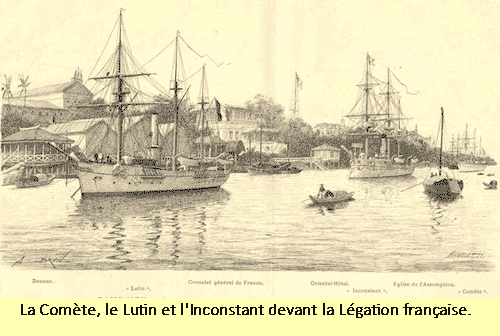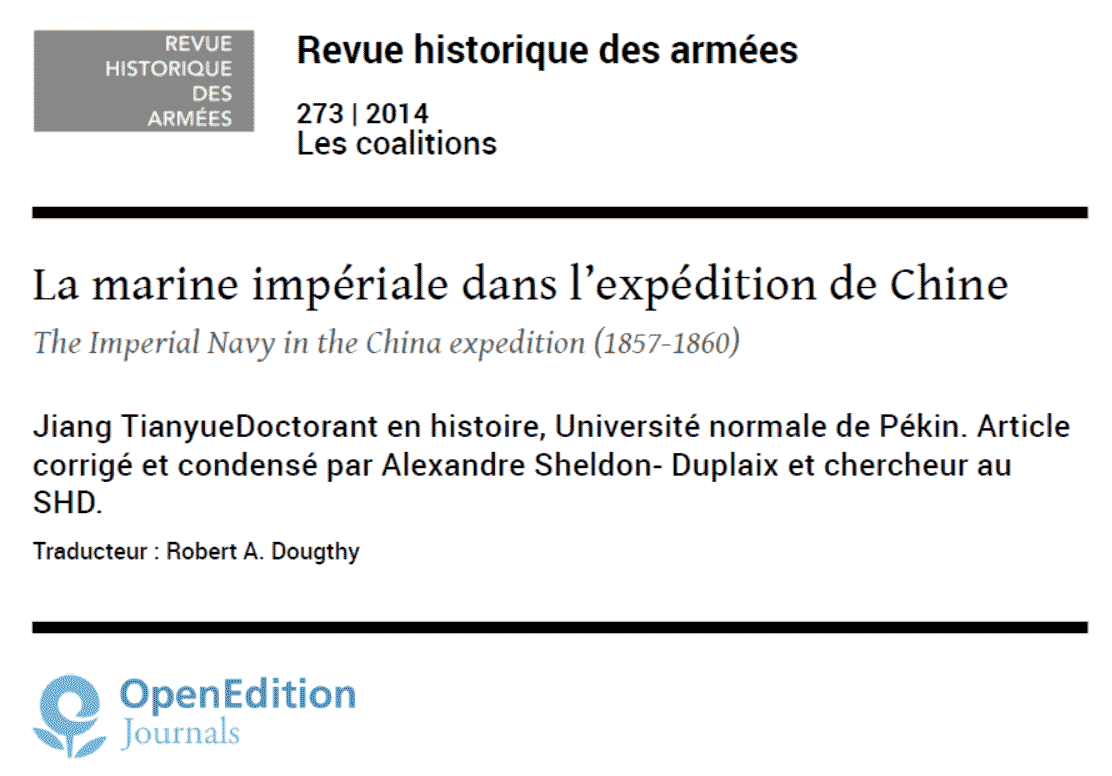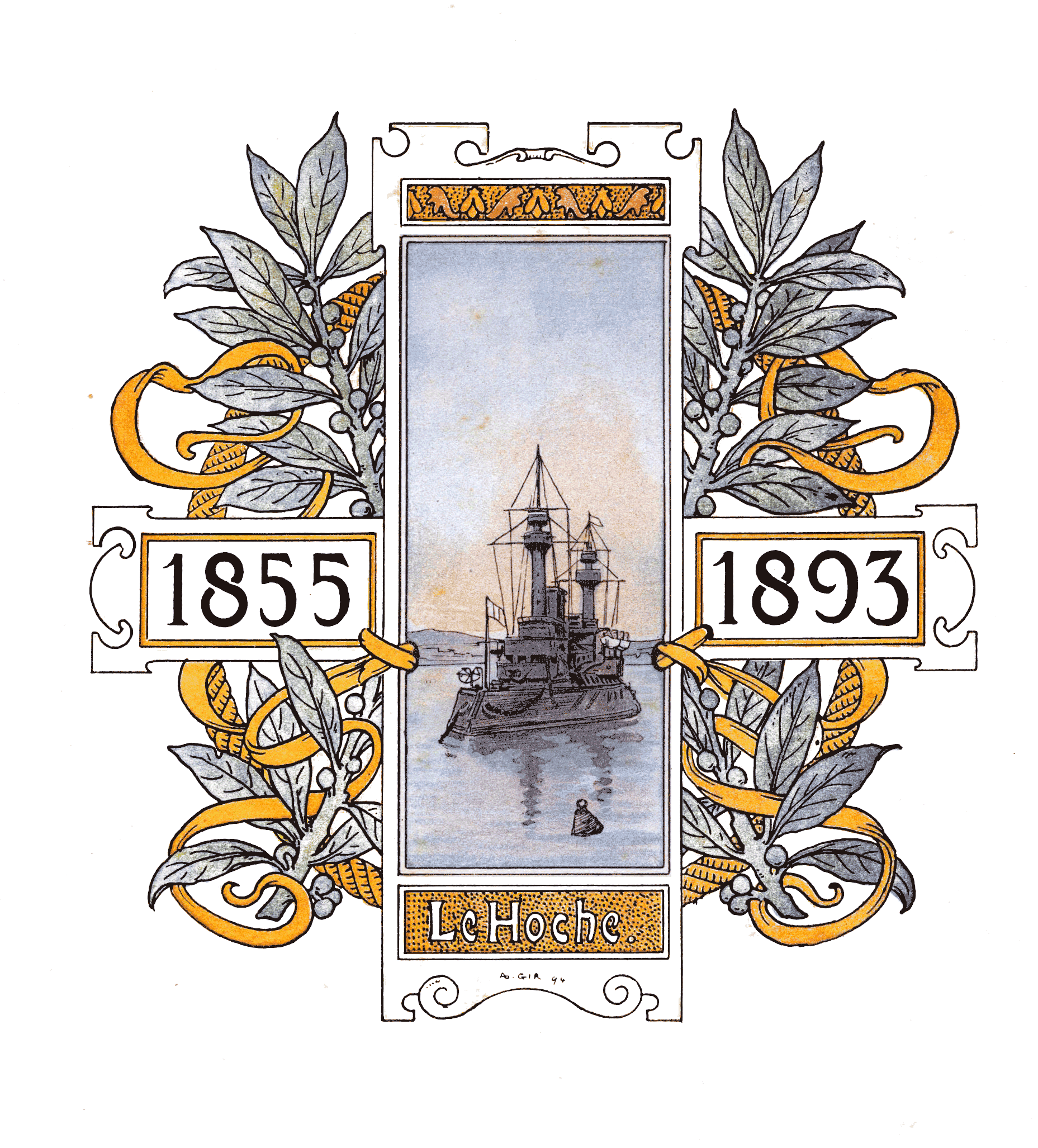
Gloires et Souvenirs Maritimes

1855-1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_(navire_de_ligne)
Les forts du Peï-Ho sont enlevés
(AOÛT 1860)
Les difficultés dont les Chinois entouraient leurs relations commerciales avec l'Europe nécessitèrent une intervention de l'Angleterre et de la France. Un traité signé en 1858 ouvrait la Chine au commerce européen. Les ambassadeurs de France et d'Angleterre, ayant voulu faire ratifier ce traité à Pékin, se virent refuser l'entrée du Peï-Ho et échouèrent dans une première tentative pour réduire au silence les forts de Takou.
Une expédition anglo-française fut alors jugée nécessaire.
Elle eut lieu en 1860.
L'ENSEMBLE des défenses du Peï-Ho comprenait deux forts sur la rive gauche et trois sur la rive droite. Les forts d'aval se reliaient aux forts d'amont par des chaussées étroites entourées d'eau et enfilées par des batteries rasantes.
L'amiral Charner et l'amiral Hope, après s'être entendus avec le général Montauban et le général Grant, arrêtèrent les dispositions suivantes :
… l'armée devant combattre à la pointe du jour le 21 août, les flottilles alliées se portaient le 20 au soir devant la barre du Peï-Ho. Les contre-amiraux Page et Jones, avec les plus petits navires, battraient d'écharpe le fort nord de l'entrée. Les grandes canonnières, conduites par les amiraux Charner et Hope en personne, s'engageraient avec les forts sud.
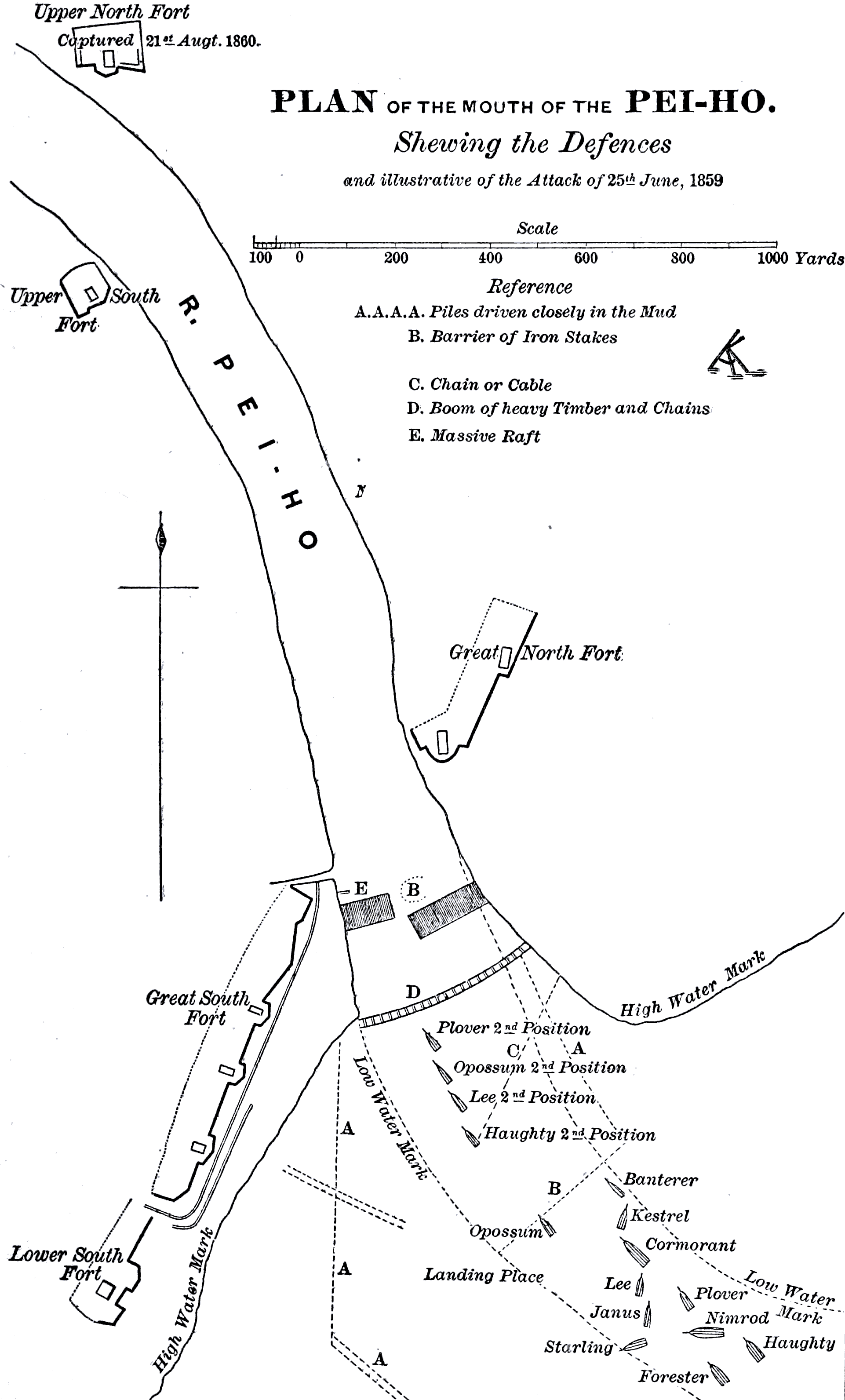 Le 20 août, dans l'après-midi, les flottilles alliées se mirent en mouvement sans être inquiétées par l'ennemi. Le 21 août, à cinq heures, la brigade Collineau déboucha de Tang-Ko, et, se rapprochant de la rive du fleuve, elle vint se placer à la droite du corps anglais. L'air était calme, mais lourd et chargé d'orage. L'artillerie chinoise ouvrit immédiatement son feu, et, brusquant ainsi le commencement de l'action, elle l'engagea avant que les canonnières eussent pu prendre le poste qui leur avait été assigné. Les escadrilles, commandées par les contre-amiraux Page et Jones, s'avancèrent vers les bancs de la rive gauche du Peï-Ho; elles inclinèrent leur route sur la droite, et, traçant leur sillon dans la vase, elles s'établirent près du poste choisi par le vice-amiral Charner, à dix-huit cents mètres du cavalier septentrional. Dans cette position, l'écharpe des canonnières françaises était complète sur le fort et sur la chaussée.
Le 20 août, dans l'après-midi, les flottilles alliées se mirent en mouvement sans être inquiétées par l'ennemi. Le 21 août, à cinq heures, la brigade Collineau déboucha de Tang-Ko, et, se rapprochant de la rive du fleuve, elle vint se placer à la droite du corps anglais. L'air était calme, mais lourd et chargé d'orage. L'artillerie chinoise ouvrit immédiatement son feu, et, brusquant ainsi le commencement de l'action, elle l'engagea avant que les canonnières eussent pu prendre le poste qui leur avait été assigné. Les escadrilles, commandées par les contre-amiraux Page et Jones, s'avancèrent vers les bancs de la rive gauche du Peï-Ho; elles inclinèrent leur route sur la droite, et, traçant leur sillon dans la vase, elles s'établirent près du poste choisi par le vice-amiral Charner, à dix-huit cents mètres du cavalier septentrional. Dans cette position, l'écharpe des canonnières françaises était complète sur le fort et sur la chaussée.
À six heures, l'action est générale sur terre et sur mer. Les canonnières dirigent d'abord leur tir sur les cavaliers du fort nord de l'embouchure : les premiers coups sont trop bas. Le tir se rectifie ; il devient d'une précision parfaite quand les canonnières sont complètement échouées, et tous les boulets ogivaux et les obus anglais tombent dans l'enceinte. Les pièces chinoises répondent avec vivacité ; leurs coups sont bons en direction, mais manquent de portée.
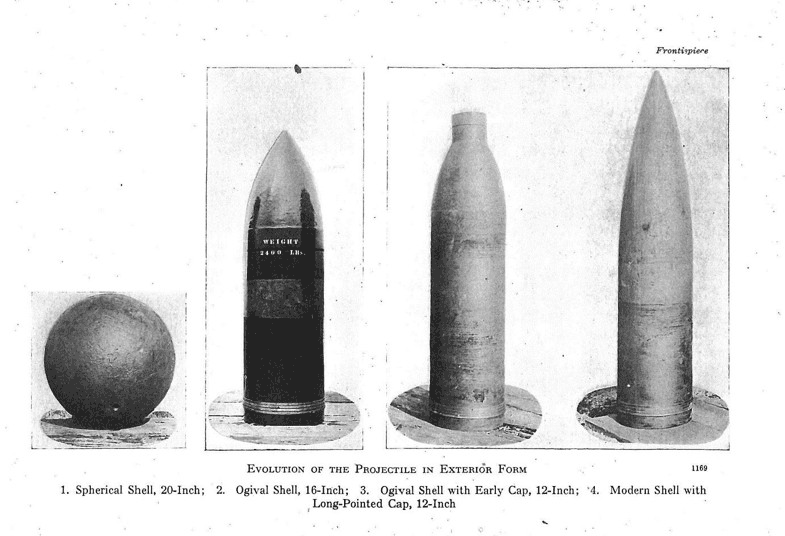 À sept heures, la poudrière du fort intérieur fait explosion.
À sept heures, la poudrière du fort intérieur fait explosion.
Quelques instants après, un bruit plus terrible que le premier couvre les détonations de l'artillerie ; la poudrière du fort extérieur vient d'être atteinte par un des projectiles de la flottille ; elle saute, et, par son explosion, elle bouleverse le fort; des flocons de fumée blanche, des débris montent vers le ciel. Les équipages saluent spontanément ce spectacle du cri de « Vive l'Empereur! »
Le contre-amiral Page, à partir de ce moment, fait diriger le feu des canonnières en fer sur une batterie rasante, qui commande la chaussée de communication entre les deux forts du nord. Le fort méridional d'aval dirige un feu lent sur la tête des grandes canonnières : là encore, les coups sont bons en direction, mais ils manquent de portée, et les boulets viennent tomber vingt ou trente mètres de la Dragonne.
Dans ce moment, les grandes canonnières pourraient couvrir les forts de bombes ; mais le vice-amiral Charner s'est engagé à n'agir sur les forts du sud qu'au moment où l'armée s'avancera sur leurs flancs. Les événements qui se précipitent ne le dégagent point de sa parole; il donna l'ordre à la Dragonne d'augmenter la distance. Les grandes canonnières conservent leur attitude menaçante.
Cependant, sur le revers du fort intérieur, l'artillerie de terre a continué sa marche en avant. Les pièces de campagne prennent position à cinq cents mètres de l'ouvrage. Les tirailleurs se reploient en arrière pour ne pas masquer les canons. Le feu des alliés redouble de violence : tous les coups sont concentrés sur l'entrée, pour ouvrir la brèche. Peu de temps après l'explosion de la grande poudrière, le feu de l'ennemi semble se ralentir ; il est alors sept heures et demie. Le signal est donné, et les colonnes se précipitent.
L'artillerie alliée a cessé de tonner; les Chinois se découvrent à leur tour, et le combat se transforme en un combat de mousqueterie.
Cette nouvelle phase est courte et violente.
Les Français continuent de s'avancer avec une grande bravoure ; ils traversent un abatis de bois, un blanc d'eau, deux fossés profonds de trois mètres et larges de huit, et deux ceintures redoutables, formées de bambous serrés et pointus. Ils appliquent alors contre le parapet les échelles qui viennent de leur servir de ponts ; malgré la résistance acharnée de l'ennemi, qui fait pleuvoir sur eux des boulets, des pierres et des projectiles de main, quelques hommes intrépides parviennent à escalader l'obstacle : le drapeau français est planté sur l'escarpe par le tambour Fachard.
Le reste de la colonne couronne la crête, et, sautant dans l'enceinte, s'élance la baïonnette en avant. La résistance continue, et les Tartares acceptent cette lutte corps à corps, pour laquelle il semble qu'ils éprouvent une horreur invincible.
Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure que les survivants commencèrent à céder. Mais ces mêmes obstacles qui avaient retardé la marche des colonnes causèrent la perte des Chinois en fuite. Un petit nombre d'entre eux seulement échappèrent au feu meurtrier de mousqueterie qui partait du cavalier et aux décharges de la mitraille anglaise. En dehors du fort, le terrain se trouva bientôt encombré de morts et de blessés.
Les Anglais pénétrèrent dans le fort quelques instants après les Français.
(Pallu de la Barrière, Relation de l'expédition de Chine.)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
Prise des lignes de Ki-hoa
(24 FÉVRIER 1861)
Lorsque la paix de Pékin eut terminé l'expédition de Chine et rendu disponibles les forces de la France employées en Extrême-Orient, le vice-amiral Chanter fut désigné pour commander une expédition dirigée contre la Cochinchine. Les gouvernements français et espagnol avaient à se plaindre du manque de foi de l'empereur de l'Annam. Le corps expéditionnaire, transporté à Saïgon, fut donc mis à terre et débuta par un succès : il rompit les lignes annamites qui enserraient cette ville.
La totalité des soldats et marins qui le composaient se montait 4000 hommes.
À QUATRE heures du matin, les clairons sonnent aux drapeaux. La nuit est encore sombre ; le jour, comme dans tous les pays tropicaux, ne se fera qu'aux environs de six heures. C'est au milieu de l'obscurité que les troupes prennent leurs postes. Avant de partir, elles ont bu le café et reçu leur ration d'eau-de-vie. Les sacs ont été faits la veille. Ils contiennent huit jours de biscuit et deux rations de viande cuite à l'avance.
À cinq heures, tous les corps sont à leurs postes sur la route des Pagodes. L'amiral et le général de Vassoigne sont ‚en tête près du débouché de Caï-maï; un petit détachement de chasseurs d'Afrique leur sert d'escorte. Viennent ensuite l'infanterie espagnole, puis deux compagnies de chasseurs à pied. L'artillerie qui a bivouaqué à Caï-maï est en colonne par pièces et dans l'ordre suivant les six obusiers de montagne, les fusées, les trois canons de 4 rayés, les quatre canons de 12 rayés.
L'infanterie est disposée sur la route à la suite et dans cet ordre : les chasseurs à pied, le génie et ses échelles; les marins abordeurs, leurs échelles, leurs engins ; le corps des marins débarqués; l'infanterie de marine. Puis viennent le train et le service d'ambulance.
Le convoi, porté par 600 coolies chinois et par 100 bêtes de somme, est placé sur la route de Jajareo, qui coupe perpendiculairement la route des Pagodes. Ainsi disposé, il ne gênera pas la marche de la colonne.
À cinq heures et demie, l'armée se met en marche. Le jour s'est fait; la température est encore bonne ; mais la poussière, que l'humidité de la nuit avait d'abord abattue, s'est élevée.
Les corps placés en tête débouchent dans la plaine et se dirigent sur le fort dit de la Redoute, qui forme l'extrémité ouest des lignes cochinchinoises.
Une compagnie de chasseurs à pied se développe en tirailleurs devant l'artillerie qui paraît à son tour et forme ses sections sans difficulté sur la route, qui a été nivelée la veille.
Les pagodes Barbet, des Clochetons, de Caï-maï, ont déjà ouvert leur feu depuis une heure.
Le roulement grave et puissant des grosses pièces d'artillerie domine tous les bruits et remplit la scène.
L'ennemi, de son côté, a garni ses lignes et s'est porté tumultueusement aux armes.
Du haut de la redoute, on a pu distinguer son mouvement. Le bruit des gongs, le sifflement très reconnaissable de son artillerie, qui est en fer et de moindre calibre, couvrent les intervalles du tir des pièces rayées de 30. Des officiers venus de Saïgon et réunis à Caï-maï s'avancent rapidement sur la route, et échangent avec ceux qui passent un mot d'adieu et une poignée de main.
Mais la colonne a débouché presque tout entière : l'artillerie montée se répand maintenant dans la plaine; elle élargit son front.
À mille mètres environ de l'ennemi, elle se déploie en avant en batterie, oblique à gauche, s'arrête court et ouvre son feu. Une vibration cuivrée, qui s'allonge en sifflant et en bourdonnant, bondit dans la plaine. Les pièces de 12 dirigent leur feu sur le fort de la Redoute ; les pièces de 4 et de montagne, les fusées, s'adressent aux deux redans voisins. Le feu se règle en quelques instants et devient très précis.
La ligne annamite, quoique placée, par la faiblesse de son calibre, dans des conditions bien inférieures, se couvre de fumée et redouble de résistance. Le feu est vif, mais l'action n'est, à vrai dire, engagée que pour l'ennemi.
Ce combat d'artillerie a permis à l'infanterie de reprendre haleine : l'armée s'avance par bataillons en colonnes. L'ordre est donné de diminuer les distances de moitié. Les pièces de montagne partent au grand trot malgré les tumulus et les tombeaux, et se placent à cinq cents mètres de l'ennemi.
Les pièces de 4, les fusées, les pièces de 12 continuent la manœuvre par un mouvement successif. L'infanterie arrive sur la nouvelle ligne.
Une reconnaissance pratiquée la veille avait indiqué l'existence d'un marais qui bordait la plaine à gauche, près du fort de la Redoute.
L'infanterie, pour l'éviter, oblique un peu trop sur la droite. Malgré le léger retard provoqué par cette circonstance et le chevauchement qui en est la suite, l'armée se trouve en position peu de temps après que le second engagement d'artillerie a commencé. Deux colonnes d'assaut sont formées; celle de droite est formée du génie, des chasseurs à pied, de l'infanterie espagnole, de l'infanterie de marine; elle est commandée et dirigée par le chef de bataillon du génie Allizé de Matignicourt. La colonne de gauche se compose de marins débarqués; elle est commandée par le capitaine de frégate Desvaux et dirigée par le capitaine du génie Gallimard.
À la distance de cinq cents mètres, les projectiles de l'ennemi arrivent en grand nombre dans les rangs français et espagnols. Le tir des Annamites est bon en hauteur et en direction. Les pièces du fort, les fusils de main et de rempart tirent à outrance.
Partout où le groupe formé par l'amiral, son état-major et son escorte s'arrête, le feu se concentre et devient acharné.
L'artillerie vient d'en faire l'épreuve; en quelques minutes, plusieurs servants et des chevaux sont atteints.
Le peu de distance qui sépare de l'ennemi a diminué la supériorité des armes de précision; et quoique notre feu soit très bien mené, quoiqu'il soit accéléré et supérieur, l'action dure depuis longtemps, et la résistance des Annamites ne paraît ni abattue ni découragée.
Nos pertes augmentent ; le général de Vassoigne, le colonel espagnol Palanca Gutierrez, l'aspirant Lesèble, l'adjudant Joly, sont grièvement blessés.
L'amiral prend le commandement direct des troupes ; il donne le signal. Les colonnes s'ébranlent.
Les pièces de montagne les protègent sur leurs ailes. Une compagnie de chasseurs à pied est lancée en tirailleurs, en avant de la colonne de droite ; une compagnie de marins-fusiliers, en avant de la colonne de gauche.
En tête des Espagnols, des chasseurs et de l'infanterie de marine marchent les sapeurs du génie.
Ils s'avancent au pas de promenade, sous une fusillade très nourrie, réservant leur haleine pour le dernier moment, obliquant légèrement à droite pour ne pas s'embourber dans le marais.
À trente mètres de l'obstacle, un cri de : « Vive l'Empereur! » domine la fusillade ; les premiers s'élancent; ils reçoivent l'arquebusade en pleine poitrine, écartent les bambous entrelacés, marchent à petits pas sur la crête des trous de loup, enjambent les chevaux de frise, sautent dans le fossé, et, se frayant un passage travers les branchages épineux, les mains et le visage en sang, les vêtements en lambeaux, paraissent, victorieux, sur le dernier obstacle.
La colonne de gauche rompait la ligne annamite avec la même vigueur.
En tète de cette colonne marchait le peloton des marins abordeurs. Eux-mêmes avaient porté leurs échelles, leurs grappins emmanchés, leurs gaffes, leurs grenades : les coolies avaient été remplacés à la seconde halte ; le service de porteur d'échelles devenait alors un service d'honneur.
Il n'y eut d'engagement corps à corps en aucun point, et les Français qui les premiers mirent le pied sur la banquette intérieure, purent voir les Annamites céder le terrain, emportant leurs gingoles et leurs fusils de main. Ils s'éloignaient d'un pas qui paraissait presque tranquille, comme des travailleurs qui suspendent leur travail, et, chose singulière, quoique pressés de bien près par toute une armée qui escaladait leurs remparts, un très petit nombre d'entre eux s'enfuirent en courant.
En quelques minutes ils joignirent un gros de leurs troupes dont on voyait flotter les banderoles du côté de Ki-hoa.
Dans le combat du 24 février, les Annamites acceptèrent la lutte à coups de canon sans qu'elle pariât les entamer beaucoup ni affaiblir leur courage : les nombreux cadavres étendus le long des parapets témoignaient de l'effet des pièces rayées. Mais quand les colonnes marchèrent à l'assaut, droit sur eux, ils cédèrent le terrain et s'enfuirent, tout en restant en vue.
Ainsi les avaient représentés la plupart des rapports sur les affaires de Saïgon et de Touranne.
Le sous-lieutenant Thénard, du génie, et l'enseigne Berger arrivèrent, les premiers de toute l'armée, au sommet du parapet, aux deux points où la ligne ennemie fut rompue : l'un à l'attaque de droite, l'autre à l'attaque de gauche.
Cette affaire nous coûta 6 tués et 50 blessés, dont un général, un colonel, un aspirant et un adjudant. Un coolie du génie fut tué, un autre fut blessé. Les coolies du génie marchèrent jusqu'au dernier obstacle, suivant l'habitude contractée en Chine, qui faisait remplir un poste d'honneur par des mercenaires. L'artillerie eut plusieurs chevaux ou mulets tués ou blessés. Elle avait manœuvré dans des terrains difficiles, semés de fondrières et de puits, coupés de fossés, barrés de pans de murs ; tous accidents artificiels, excellents pour des tirailleurs, mauvais pour des pièces montées dont le recul n'était pas facile.
(Pallu de la Barrière, l'Expédition de Cochinchine.)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
https://www.wikiwand.com/fr/Campagne_de_Cochinchine

Second combat autour de Saïgon
(25 FÉVRIER 1861)
LA nuit fut silencieuse : pas un coup de feu ne fut échangé. À cinq heures, l'artillerie monte à cheval ; chacun est sous les armes. L'armée pivotant sur la maison qui a servi de quartier général, quelques corps se trouvent tout placés, d'autres font une marche préparatoire assez longue.
À dix heures, l'armée est en position, en colonnes, à deux kilomètres environ de la face septentrionale de Ki-hoa. Deux colonnes d'infanterie comprennent entre elles l'artillerie. La colonne de gauche se compose du génie, qui marche en tête avec ses échelles, de l'infanterie de marine et des chasseurs ; quatre canons de 12, trois canons rayés de 4, deux obusiers de montagne de l'artillerie de marine, disposés en une seule ligne de bataille, marchent droit à l'ennemi et appuient la colonne de gauche, qui suit le mouvement.
La colonne de droite se compose de l'infanterie espagnole et des marins débarqués : les marins abordeurs marchent en tête, chargés, comme la veille, de frayer le passage.
Trois obusiers de montagne marchent avec la droite. Ils prendront, s'ils le peuvent, la face du camp en enfilade, et allégeront la tâche de la colonne d'assaut.
Dans les colonnes de droite et de gauche, les corps et les compagnies qui, le jour précédent, marchaient au premier rang forment aujourd'hui la réserve.
Le sol, que recouvre un épais entrelacement d'herbes roussies par le soleil, ne rend aucun bruit; les clairons ont cessé d'envoyer leurs sons barbares. Point de tambours et, chez l'ennemi, plus de gongs ni de tam-tams.
Le grondement sonore et d'un ton égal des grosses pièces de Ki-hoa, puis le déchirement aigu de l'air que traversent les boulets, voilà les seuls bruits qui se font entendre. Et rien n'est plus différent, en ce moment, des idées que fait naître le mot d'assaut, que la marche sûre, presque tranquille, de cette armée qui déjà laisse des morts et des blessés derrière elle et semble dédaigner le danger.
Ni habits brodés ni couleurs éclatantes : du noir et du blanc, de la laine et de la toile. Rien ne brille chez elle que ses baïonnettes. Son expression, c'est l'énergie concentrée, la confiance et la force. Et pourtant ici manque absolument l'espérance si chère aux Français de la louange publique, la pensée de vivre au-delà de la mort, d'être connu et célébré.
Ils vont tomber, ceux qui sont marqués, tomber obscurément à l'extrémité de l'Asie.
Les coups de l'ennemi, tirés d'abord à des intervalles assez longs, deviennent de plus en plus multipliés. Son feu est vif et bien réglé, en direction surtout. Les Annamites ont l'avantage : le soleil est dans les yeux de l'armée française.
L'artillerie, qui s'est établie à 1000 mètres, a déjà supporté des pertes.
Des hommes et des chevaux sont tués ou blessés ; une roue de caisson vole en éclats. Le lieutenant-colonel Crouzat, portant ses pièces par des élans rapides et brillants à 500 mètres, puis à 200 mètres, parvient à diminuer l'infériorité notable causée par le soleil, dont les rayons sont presque horizontaux.
Dans cette halte à 200 mètres, qui fut la dernière, les pièces tirent à mitraille sur le haut des épaulements.
La fusillade est des plus violentes.
À cette distance se dresse, avec un relief considérable, l'obstacle de terre et de bambous percé de meurtrières qui blanchissent de fumée à toute seconde. La plaine ne présente aucun abri, et l'on ne peut attendre à découvert l'effet de l'artillerie.
Déjà les pertes sont sensibles.
Il faut profiter de la confiance des troupes que le souvenir de la veille exalte et qui ne demandent qu'à s'élancer. Les sacs sont mis à terre; les coolies porteurs d'échelles sont remplacés : l'amiral ordonne aux colonnes de s'avancer. On parlera principalement ici de l'attaque de droite et de ses épisodes.
La deuxième compagnie est lancée en tirailleurs; quatre-vingts hommes d'élite chargés de frayer le passage se précipitent. Un tumulus, le seul qu'il y eût dans la plaine, s'élevait à environ cent cinquante mètres de la ligne ennemie.
C'est à la hauteur de ce tertre que la colonne de droite s'élança, vaillamment conduite par le capitaine de vaisseau de Lapelin. Elle rencontra les premiers trous de loup cinquante mètres plus loin, à cent mètres par conséquent de l'obstacle principal.
Les défenses accessoires de l'ouvrage étaient disposées avec un art consommé. C'étaient six lignes de trous de loup séparées par des palissades; sept rangées de petits piquets ; deux larges fossés garnis de bambous pointus et remplis de trois pieds d'une eau vaseuse ; enfin une escarpe en hérisson surmontée d'une rangée de chevaux de frise très solides. Les branchages épineux accumulés sur ce dernier obstacle étaient, dessein, peu profondément fichés en terre : les mains, en s'ensanglantant, ne pouvaient s'en servir pour l'escalade.
La hauteur de l'escarpe au-dessus du fond du fossé était de quinze pieds environ. Les trous de loup étaient profonds de cinq pieds : tous étaient dissimulés par de légers clayonnages sur lesquels l'herbe avait été semée et avait poussé. Ils étaient garnis intérieurement de fers de lance ou de pieux très pointus.
C'est au milieu de ces obstacles, qui semblaient plus faits pour arrêter des bêtes féroces que des hommes, que les colonnes durent s'avancer.
À mesure que les assaillants s'engageaient sur la crête étroite des trous de loup, cheminant avec circonspection et très lentement, le feu de la mousqueterie et de l'artillerie redoublait d'intensité.
Un bruit sec de branches cassées ne cessait, et sur toute cette nappe, large de cent mètres, les balles tombaient littéralement comme des noix qu'on gaule. Qu'on imagine, s'il est possible, les difficultés que durent vaincre les porteurs d'échelles, de grappins et de gaffes, tous ceux qui étaient embarrassés d'une carabine, au milieu de tant d'embûches, lorsqu'il eût été difficile d'arriver sain et sauf, les mains libres.
La plupart des porteurs d'échelles, cheminant plus lentement que les autres, tombèrent dans les trous de loup ou furent blessés.
Leurs échelles servirent de passerelles. Elles étaient faites de bambous légers, et ne dépassaient pas un poids de trente livres. Presque toutes furent brisées en quelques secondes sous les pieds de ceux qui s'en servirent. Trois d'entre elles cependant furent portées dans le dernier fossé. Mais, devant l'escarpe, la lutte prit un caractère d'acharnement unique sans doute dans les rencontres d'Annamites et d'Européens.
Les assaillants qui parvinrent sur le sommet de l'obstacle, soit en montant sur les échelles, soit en s'aidant des épaules de leurs camarades et saisissant les branches inférieures et solides des chevaux de frise, furent ou tués à bout portant, ou brûlés au visage, ou rejetés à coups de lance.
Celui qui parut le premier sur l'escarpe put voir, avant d'être renversé, un spectacle bien différent de ce qui avait frappé ses yeux en montant à l'assaut la veille : la banquette intérieure était garnie de défenseurs ; les uns servaient leurs fusils de rempart; les autres, armés de lances ou de fusils, guettaient les premiers assaillants.
En ce moment, qui devenait critique, l'ordre fut donné de lancer les grenades.
On en lança vingt, et toutes heureusement, quoique le jet fût presque vertical et des plus dangereux. Trois matelots parvinrent à lancer leurs grappins, qui, s'accrochant solidement en dedans du rempart, par le fait même des branchages qui nous faisaient obstacle, ne purent en être rejetés malgré les efforts des Annamites dont on voyait les lances s'entrecroiser. Ces engins firent l'effet de herses, et trois brèches furent pratiquées.
Malheureusement elles se trouvèrent à dix ou vingt pieds de distance, et chacune d'elles ne put donner passage qu'à un combattant. Des trois hommes qui s'y présentèrent les premiers, l'un, qui était de la Renommée, fut tué ; les deux autres furent blessés. Leurs corps, rejetés violemment en arrière, tombèrent dans le fossé. D'autres, suivant de près, escaladèrent enfin l'obstacle et sautèrent sur la banquette, qui était glissante de sang. Tout ce qui se trouva de ce côté périt par le fer ou le feu.
Les Annamites, qui cessèrent de combattre, voyant que les passages allaient être frayés, s'éloignèrent quelques minutes avant l'irruption des Français. Ils filèrent en bon ordre et au pas le long des enceintes du camp.
Une partie des nôtres se jeta à leur poursuite, mais sans résultat; car l'ennemi put disparaître dans un fort avant d'être rejoint. Le reste des troupes victorieuses se rallia autour de ses chefs. Il en était grand temps ; car on était dans un compartiment battu de tous côtés ; et rien n'était fait, puisqu'il y avait un second assaut à livrer et qu'on se trouvait à découvert devant une ligne formidable.
Le feu, suspendu un instant par les Annamites pour permettre leur colonne d'entrer dans le fort, reprit avec une nouvelle furie. Ainsi qu'à Dettingue, à Fontenoy, c'était en champ clos que l'on allait combattre.
L'armée expéditionnaire se heurta à droite, au centre, puis à gauche de la ligne ennemie — une partie des réserves (infanterie de marine) s'étant portée sur le saillant de gauche et ayant formé une troisième attaque. Si le sort de ces trois chocs eût été le même, si la ligne eût été rompue en ces trois points au même moment, l'ennemi, se voyant entamé d'une force égale, eût cédé d'un seul coup, au lieu de céder par des mouvements successifs, droite d'abord, à gauche ensuite.
Mais le choc de la colonne de droite fut si furieux qu'elle défonça la ligne en un quart d'heure.
Les autres attaques en durèrent trois. Les marins débarqués et les Espagnols, qui combattaient ensemble ce jour-là, restèrent donc pendant la différence de temps, une demi-heure, dans l'enceinte où ils avaient pénétré et où ils étaient pris comme dans un piège. Leur contenance fut héroïque, et leurs efforts, détournant une partie considérable des ressources de l'ennemi, furent d'un puissant secours pour les attaques du centre et de la gauche.
L'amiral se tenait à cheval, très exposé, devant les premiers trous de loup. Les chasseurs de son escorte avaient presque tous été touchés. Près de lui se tenaient son chef d'état-major général, le capitaine de vaisseau Laffon de Ladébat, et le chef d'escadron d'état-major de Cools.
Les réserves venaient d'être envoyées en renfort au centre, mais surtout à droite, où le feu redoublait d'intensité. Les bagages n'étaient plus gardés que par une demi-compagnie; les trois obusiers de montagne qui devaient enfiler la face du camp annamite étaient à peine soutenus.
En ce moment la lutte, par le temps qu'elle durait, par le redoublement de violence de l'attaque et de la défense, prenait un caractère sinistre. L'indifférence et la sérénité de la nature faisaient ressortir l'acharnement des hommes, et le combat se déchaînait comme un ouragan furieux sous un ciel impassible.
Les cris de « Vive l'Empereur! » depuis longtemps avaient cessé : la crépitation non interrompue de la fusillade, le bruit aigu des balles, quelquefois, mais rarement, l'imprécation ou le cri de douleur d'un mourant, attestaient seuls le choc de deux volontés, l'acharnement de vingt-cinq mille hommes séparés par une mince barrière de terre, par la distance à laquelle on peut se tendre la main, et que les uns voulaient franchir quand les autres s'y opposaient.
À ces termes aboutissaient, dans une simplicité terrible, tant de proclamations, de mouvements d'hommes et de navires, un chemin de six mille lieues et tant d'or prodigué. Un assaut qui dure trois quarts d'heure est singulièrement compromis : après l'élan, la réaction déjà se faisait sentir.
L'énergie de l'attaque diminua et celle de la résistance augmenta.
Cependant, dans l'enceinte où les marins et les Espagnols ont pénétré, l'action a fini par se régler.
Tous les efforts se portent sur deux points principaux : à la porte du camp du Mandarin, et au centre de la courtine, à moitié chemin environ entre la porte et le premier redan. Mais tous ces mouvements s'opèrent complètement à découvert, sous des feux étudiés d'avance, et ce funeste espace se couvre de morts et de blessés. Un des aumôniers de l'armée courait d'un mourant à un autre, se penchait vers eux et psalmodiait rapidement des paroles latines. Là furent blessés, mais restèrent debout ou se relevèrent, le lieutenant de vaisseau de Foucault, l'enseigne Berger, les aspirants Noël et Frostin ; le quartier-maître Rolland, qui eut la cheville fracassée, se pansa lui-même et se traîna au feu ; le clairon Pazier, qui dans le commencement de l'action fut atteint au front, se releva et continua de sonner la charge. Près de là tomba l'enseigne de vaisseau Jouhaneau-Laregrière, qui eut le flanc gauche emporté et engagea les hommes qui voulaient le relever à le laisser et à continuer de combattre.
Dans cette enceinte furent aussi étendus mortellement blessés les Espagnols Jean Laviseruz et Barnabé Fovella, qui s'étaient distingués.
Et tant d'autres, dont les belles actions furent ignorées d'eux-mêmes et de leurs chefs !
Ce drame, jusqu'alors indécis, tirait pourtant à sa fin.
Quelques hommes, leur chef en tête, après avoir marché droit à la courtine, traversaient le fossé et touchaient l'obstacle, quand l'effort des trois attaques aboutit en même temps sur les trois points. La porte fut défoncée à coups de hache par quelques hommes intrépides que le lieutenant de vaisseau Jaurès, deuxième aide de camp de l'amiral, avait ralliés ; le fort du Centre fut enlevé par le génie, et l'infanterie de marine, les chasseurs à pied, la compagnie indigène, entraînés par le chef de bataillon Delaveau, débordèrent avec impétuosité par la gauche.
Tous les Annamites qui ne purent s'enfuir furent massacrés, et le combat finit par une scène de carnage.
Dans cette affaire l'armée eut trois cents hommes hors de combat. Douze furent tués sur le coup.
Beaucoup de blessés ne survécurent pas à leurs blessures. L'enseigne de 'vaisseau Jouhaneau-Laregnère expira dans la journée, après cinq heures de souffrances atroces. Le lieutenant-colonel Testard, de l'infanterie de marine, mourut le lendemain seulement de ses blessures. Les blessés ne se plaignirent pas, ou se plaignirent rarement. Ils étaient simples et admirables ; la vie s'en allait chez quelques-uns sans qu'il leur échappât une parole de désespoir ou de regret de mourir si loin de la France.
Leur contenance attesta jusqu'au bout fa valeur morale de l'armée de Cochinchine.
(Pallu de la Barrière, l'Expédition de Cochinchine.)
(Hachette et C, éditeurs.)
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Marine_fran%C3%A7aise_au_Mexique/02

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Mexique

L'attaque de la Frontera
(JUIN 1865)
Le rôle de la marine pendant l'expédition du Mexique se borna à la pénible et ingrate mission de transporter les troupes, de bloquer les côtes et de rapatrier les malades. Pendant le blocus nos navires eurent souvent à livrer des engagements avec les troupes insurgées qui ne voulaient pas reconnaître le gouvernement de l'empereur Maximilien, que nous protégions.
LE chef de bande Begino avait osé occuper quelques heures la Frontera et avait écrit une lettre insolente au capitaine de la Tourmente, sur le pont de laquelle un homme même avait été tué. Le capitaine avait hésité, pour répondre à cette agression, à foudroyer une ville de gens inoffensifs et s'était abstenu.
La mise en avant des questions d'humanité a fait trop souvent notre faiblesse au Mexique.
Dès qu'un nomme était tué sur son pont, le commandant eût mieux fait de tirer sans pitié sur le point d'où était parti le feu. De son côté, la Pique allait bloquer le Chillepèque et les Dos Bocas. Quant au vapeur le Tabasca, qui allait librement de Vera-Cruz à San-Juan-Bautista, on le traitait toujours avec les égards que lui valait son rôle de négociateur occulte.
Le commandant Cloué annonçait surtout son arrivée au Brandon, qui par sa position à Carmen, le grade et l'activité très belle, quoiqu’un peu remuante, de son capitaine, pouvait prendre, dans un cas donné, l'initiative des opérations. Il allait la prendre en effet, un peu à la hâte peut-être, mais fort heureusement.
Le commandant de Jonquières était un habile et vaillant homme, très ami du bruit, mais ayant la qualité de s'attacher, par l'admiration qu'il professait volontiers pour eux, ses officiers et son équipage.
Il y a habileté louable, sauf certains inconvénients, à exagérer chez un équipage la bonne opinion de soi. On le trouve, il est vrai, assez indépendant et assez volontaire d'allures dans le service intérieur du bord, mais tout disposé d'amour-propre à bien faire dans les circonstances graves.
Le Brandoh, à l'exemple de son commandant, était fort impatient d'agir, quand l'attaque de Regino sur la Frontera lui en donna l'occasion.
Un peloton de matelots et d'Autrichiens culbuta l'ennemi et se tint prêt à marcher plus loin. M. de Jonquières venait d'envoyer son second Mérida pour demander au commissaire impérial du Yucatan un renfort considérable, que celui-ci, comprenant la nécessité de frapper un grand coup, accorda aussitôt.
Le 3 juin, une colonne composée de 250 Mexicains, 180 Autrichiens et 60 matelots du Brandon s'embarqua à Carmen, sur la canonnière à vapeur la Louise, huit goélettes et les canots du Brandon armés en guerre.
Le 5, on entra dans Palizada sans coup férir : l'ennemi, prévenu à temps, l'avait évacué.
Le 6, la colonne continua péniblement sa route par les arroyos et arriva bientôt en vue du camp retranché que l'ennemi avait établi sur la rive opposée, à Jonuta.
Les remparts étaient couverts de monde, le pavillon libéral hissé.
L'ennemi ouvrit le feu immédiatement.
On attendit, pour répondre, que l'on fût à demi-portée; puis, défilant devant ces retranchements, on opéra le débarquement à 300 mètres au-delà, faute d'un autre endroit convenable, et suivi par la fusillade de l'ennemi embusqué sur la rive.
En un clin d'œil, tout le monde fut à terre et marcha sur les retranchements, où l'enseigne de vaisseau Fleuriais eut l'honneur d'entrer le premier à la tête d'un peloton du Brandon. Le capitaine Heudeman, avec un peloton d'Autrichiens, le suivit de très près. Les dissidents, ne résistant pas au choc, prirent la fuite pendant que le colonel mexicain Traconis débusquait tous les ennemis qui, à l'abri des buissons, faisaient essuyer à notre monde un feu meurtrier.
Un moment, un parti de cavalerie essaya un mouvement tournant sur notre droite, mais il fut vigoureusement accueilli par les hommes à la garde des canots. Comme ceux-ci étaient dominés par la berge, ils mirent aussitôt un obusier à terre, et, au troisième coup, l'ennemi lâcha pied.
C'était la fin de l'engagement. Alors éclata une de ces violentes tornades, si communes pendant l'hivernage. Il fut impossible de songer à poursuivre l'ennemi dans ce pays marécageux et au milieu de l'obscurité produite par un véritable déluge. On trouva seulement dix-neuf morts dans le camp et autour du camp, et on avait fait vingt-cinq prisonniers. Nous avions six morts et vingt-cinq blessés et deux officiers contusionnés.
Le 7 au matin, on procéda à la destruction des retranchements et à l'établissement des Mexicains à Jonuta, où ils se fortifièrent avec le colonel Traconis.
Les Français revinrent à bord du Brandon et les Autrichiens à Campêche.
Le résultat moral de cette brillante affaire fut très grand.
(Henri Rivière, la Marine française au Mexique.)
(Challamel, éditeur.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Strasbourg

La défense de Strasbourg
(1870)
Une flottille, placée sous le commandement supérieur de l'amiral Exelmans, devait opérer sur le Rhin. Elle s'organisait à Strasbourg, lorsqu'à la suite de nos premiers revers cette ville fut investie.
Les marins coopérèrent alors à la défense de la place.
La défense commençant à s'organiser, l'amiral renouvela par écrit sa demande d'y être employé avec le personnel placé sous ses ordres et je remis cette lettre à M. le général Uhrich. Il me dit que l'amiral était dans une position trop élevée pour qu'il pût servir en sous-ordre, mais qu'il ne manquerait pas de s'éclairer de ses conseils dans les circonstances graves et il me laissa entrevoir que le grade que nous avions, l'amiral et moi, l'embarrassait pour la répartition des rôles à distribuer aux militaires qui se trouvaient dans la place.
Je lui répondis que, militaires nous-mêmes, envoyés à Strasbourg pour combattre avec l'armée, nous ne pouvions avoir qu'une pensée : celle de partager toutes ses chances, et qu'il me semblait que le nom que portait l'amiral était de ceux qui devaient lui assurer un accueil sympathique dans les rangs de l'armée.
Le lendemain, l'amiral se rendit au conseil de défense, et occupa ainsi cette place où il n'a cessé jusqu'au dernier jour d'apporter à la résistance un élément dont personne n'a pu méconnaître la valeur. Il fut chargé de la défense des fronts nord.
Les troupes placées sous les ordres de l'amiral furent les suivantes 1er bataillon de gardes mobile de Wissembourg; 7 à 800 hommes du 74e et du 78e arrivés presque sans officiers ni sous-officiers ; 5 à 600 pontonniers et des artilleurs de la mobile ; enfin, 43 marins, puis des isolés par voie de changement de corps ou d'engagements volontaires, formant un ensemble de 117 hommes ou sous-officiers.
L'état-major se composait de M. le contre-amiral Exelmans, de son chef d'état-major le capitaine de vaisseau Dupetit-Thouars, de M. le lieutenant de vaisseau Bauer, de M. le sous-commissaire Fournier, de M. le sous-ingénieur du Buit, de M. Humann qui, enseigne de vaisseau démissionnaire, officier de la mobile, avait demandé à nous être adjoint ; enfin, de M. le médecin Grosse, en congé à Strasbourg. Le détachement de la marine était donc de 123 personnes, dont 43 seulement étaient des marins proprement dits.
Dès leur arrivée, nos hommes avaient été répartis en bordées égales en nombre, commandées par MM. Bauer et Humann, et l'instruction des recrues avait aussitôt commencé avec un entrain tel qu'en peu de temps ils étaient devenus des militaires. C'est dans de semblables circonstances que l'on peut apprécier tout ce que la marine doit aux spécialités et à son administration. Après avoir été logés avec les pontonniers, les matelots furent logés à la gare, où se trouvaient déjà nos hommes du 74e et du 78e; mais ils ne profitèrent pas longtemps de cet abri, car, la première nuit du bombardement, ce bâtiment fut atteint comme les autres.
Ils purent heureusement remiser leur matériel sous une voûte de la porte d'entrée et ils y trouvèrent eux-mêmes un abri fort précaire, puisque plusieurs d'entre eux y ont été atteints d'éclats de projectiles dans le courant du siège.
Mais rien ne pouvait ébranler nos marins, soutenus par l'exemple de MM. Humann et Bauer.
Dès que, dans la nuit du 23, leur caserne avait été détruite, ces braves jeunes gens s'étaient entièrement consacrés chacun à sa bordée, ne la quittant ni de jour ni de nuit, mangeant à la même gamelle que leurs hommes, et il s'était ainsi établi dans chaque groupe une solidarité que rien ne pouvait rompre....
Les derniers jours furent rudes !
Nos hommes, continuellement chassés de leurs abris provisoires par les obus qui fouillaient toutes les directions, ne savaient plus où se réfugier pour trouver du repos et faire cuire les aliments; les communications étaient des plus difficiles, puisque les portes étaient successivement détruites, les ponts défoncés, de sorte que le service des approvisionnements devenait presque impossible ; enfin, les ouvrages étaient écrasés sous une pluie de projectiles, et la lunette 56, que défendaient les marins, n'était plus qu'un amas de débris, où il fallait creuser de plus en plus pour se couvrir.
Bien des tentatives furent faites de nuit pour nous enlever au Contades ; mais, grâce à Dieu, nous ne fûmes jamais surpris et les Allemands se retirèrent chaque fois sans avoir pu nous entamer, tandis que nous ne cessions de les inquiéter, pendant leurs travaux d'approche, par notre mousqueterie et par le tir de mortiers légers et de batteries volantes qui se déplaçaient continuellement.
Les travaux d'attaque avançaient avec une rapidité désespérante. Chacun tait harassé. Je passais toutes les nuits à veiller, allant constamment d'un point à un autre du Contades pour juger de l'importance des fusillades qui s'engageaient et de l'opportunité qu'il pouvait y avoir à faire avancer les petites réserves dont je disposais.... Mais l'œuvre de destruction des batteries de brèche marchait si régulièrement qu'il n'y avait plus à se faire d'illusions !
Le 27, le feu de l'artillerie allemande redoubla encore.
Ayant été rudement contusionné dans la matinée, j'avais été obligé de rester à la mairie, où logeait l'amiral Exelmans, pour prendre un peu de repos. La canonnade était furieuse et à chaque instant les murailles étaient ébranlées par les projectiles, tandis que les éclats tombaient avec un bruit sinistre sur le pavé de la cour.
Vers 5 heures, l'amiral fut appelé au quartier général : nous nous regardâmes sans échanger une parole, car le même trait nous avait traversé le cœur.
Peu d'instants après, il rentra.
Strasbourg et l'Alsace étaient perdus pour la France!
M. le général Uhrich avait exposé au conseil la nécessité de capituler immédiatement pour éviter à la population civile, déjà si éprouvée, les chances peu douteuses d'un assaut, et l'amiral Exelmans s'était retiré en disant « qu'ayant offert son concours pour la défense, il n'avait plus rien à faire, alors que le général jugeait qu'elle était arrivée à son terme ».
J'envoyai l'ordre de cesser le feu sur les fronts nord, et peu à peu il se fit un grand silence comme celui qui suit la mort d'un être qui vous est cher.
C'est que c'était bien la mort qui s'abattait sur cette noble cité, arrachée, sanglante et toute palpitante encore de patriotisme, des bras mutilés de la France !
Le soir, j'allai au Contades y donner quelques ordres et je poussai jusqu'à la lunette 56 pour préparer nos marins à ce qui allait se passer.
Quand les Prussiens, en voyant le drapeau blanc sur la cathédrale, avaient poussé des hourras, ils s'étaient précipités sur les banquettes, croyant à une attaque ; le bruit avait ensuite couru qu'il y avait un grand armistice pour toute la France, mais la vérité.... Non, ils ne la soupçonnaient pas!
Comme leurs camarades étaient tombés sur ce sol défoncé par les boulets, ils étaient prêts à tomber et ils attendaient leur sort tranquillement… Mais la reddition de Strasbourg, quand ils vivaient encore ! oh non ! cette idée-là, ils ne l'avaient pas, et après être resté assis un instant au milieu d'eux, je sortis suffoqué sans avoir le courage de ne rien dire !
Le lendemain 28 septembre, il faisait un temps splendide.
Quand l'heure fut venue où M. le général Uhrich devait sortir, l'amiral, après l'avoir loyalement assisté durant le siège, voulut encore se placer à ses côtés pendant cette dernière épreuve, et je l'accompagnai, pensant ne m'en séparer que sur les glacis, pour rejoindre notre petit détachement quand il défilerait.
Mais le désordre était si grand que nos hommes se trouvaient dispersés, et je restai quelque temps en ville pour les grouper sous la conduite de MM. Humann et Bauer.
Puis nous primes ensemble le chemin de l'exil !
(Amiral du Petit-Thouars, Notes sur le siège de Strasbourg.)
(Revue Maritime, Baudoin et Cie.)
L'infanterie de marine à Bazeilles
(1er SEPTEMBRE 1870)
LE jour se lève enfin, mais lentement, comme à regret d'éclairer une journée plus terrible que la précédente et où le village sera trois fois perdu et trois fois repris.
Les Allemands, qui, le 1er septembre, veulent prendre leur revanche de la veille, arrivent sans inquiétude dans le village après avoir passé le viaduc du chemin de fer et franchi deux ponts jetés devant Bazeilles. Une compagnie bavaroise est chargée d'entreprendre cette marche silencieuse, d'exécuter cette fronde soudaine. Elle a pour but d'atteindre, sans coup férir, l'extrémité septentrionale du bourg et de surprendre ses habitants et leurs défenseurs au milieu de leur sommeil et de leur repos, alors que les uns et les autres, plus que jamais tenus en éveil, se mettent sur leurs gardes. Aussi les Bavarois viennent-ils inopinément se heurter contre les barricades du bourg, au moment où les huit compagnies d'infanterie de marine de la division Vassoigne les reçoivent par une fusillade incessante qui part de toutes les maisons, transformées en autant de fortins.
Les batteries allemandes tirent des hauteurs de Remilly.
Force est à l'ennemi, qui se présente du côté de la route de Monzon vers 4 heures 1/2, de se rejeter brusquement dans les rues latérales pour y chercher un abri, qu'il ne rencontre pas. On s'y bat alors corps à corps, coups de crosse, à la baïonnette et comme on peut!
Les compagnies des capitaines Pomerelle, Guillery, Clercaut luttent héroïquement.
Le 1er bataillon d'infanterie bavaroise ainsi que la 56 compagnie du 2e régiment soutiennent les premières colonnes, et la lutte devient encore plus acharnée. De toutes parts on s'entr'égorge et l'on s'enferre. À chaque coin de rue, l'on s'entre-tue. On se poursuit dans chaque ruelle sombre, l'on se cherche jusque dans les maisons ou sous les hangars, qu'il faut prendre d'assaut un par un.
Chaque lieu devient le théâtre d'un combat meurtrier.
C'est une guerre de buissons dans les jardins, de guérillas derrière les arbres et les murs de clôture. Partout enfin, c'est une lutte effroyable, une cohue indescriptible et inimaginable, où le brouillard, assez épais pour ne pas voir à deux pas, ajoute à l'horreur et à la confusion générale, tandis que les six compagnies du 2e régiment bavarois entrent en lice au secours de leurs semblables.
Cependant la 2e compagnie de ce régiment est parvenue à. remonter la Grand-rue. Elle s'avance jusque sous les fenêtres de la villa Beurrmann — une villa située au nord-ouest du village et à l'angle des routes de Balan et de la Moncelle — où elle succombe à son tour devant la brigade d'infanterie de marine Reboul, qui, à six heures du matin, est remplacée par celle du général Carteret-Trécourt. Presque tous les officiers bavarois sont mis hors de combat et le major qui les commande est fait prisonnier.
Il est cinq heures et demie, six heures ; le maréchal de Mac-Mahon vient d'être blessé, à quelque distance du champ de bataille, d'un éclat d'obus reçu à la cuisse.
Nos troupes, avec plusieurs bataillons de renfort qui perdent aussitôt leurs commandants (le lieutenant-colonel Domange et le chef de bataillon de la Broue ainsi que le capitaine Vigne, aide de camp du général des Pallières), continuent de mettre en fuite les Bavarois, qui dans leur débandade culbutent leurs propres frères d'armes.
Vers sept heures, la colonne commandée par M. de la Broue, tombé frappé d'une balle dès les premiers pas, s'est élancée au pas de course dans la Grande-Rue de Bazeilles, sous les yeux du général Reboul, et sous la conduite du capitaine Bourchet. Elle est arrivée jusque sur la place.
Cette charge à la baïonnette nous coûte une cinquantaine d'hommes blessés ou tués, et parmi eux le lieutenant Sériot. Mais les Bavarois n'attendent pas l'attaque et s'enfuient, perdant un grand nombre des leurs.
Le mouvement de recul s'achève.
Notre infanterie de marine fait encore des prodiges de valeur.
Les capitaines Maurial, Ortus et Farcy, avec les trois compagnies placées sous leurs ordres, peuvent atteindre le commandant Lambert et lui prêter main-forte, mais ils sont bientôt forcés, malgré un combat acharné, de céder devant des forces supérieures en nombre.
L'église tombe au pouvoir des Allemands, qui, vers 8 heures, nous délogent avec plusieurs pièces de leur troisième batterie de 4.
Le flot bavarois déborde alors comme d'une écluse ouverte. Il envahit toute la largeur de la rue. Il se précipite sur notre petit Gibraltar de la villa Beurrmann et se brise une fois encore contre sa digue infranchissable.
Les balles tombent comme de la grêle.
L'artillerie ennemie tire du chemin de fer, ainsi que du Liry, situé sur la rive gauche entre Wadelincourt et Remilly, et elle bombarde Bazeilles.
On s'entre-tue de tous côtés, vers dix heures, avec une frénésie qui tient du délire. On ne cède le terrain que pied à pied, on n'avance que pas à pas. La victoire demeure incertaine, et le gros de la lutte se centralise sur la place du marché.
Du côté bavarois, le général von der Thann se trouve à deux cents mètres en arrière du front de bataille. Il excite les siens au combat, il entraîne avec lui et pousse sur nous des masses formidables, mais ne parvient pas à enfoncer nos rangs.
Durant ces efforts opiniâtres de part et d'autre, les têtes s'échauffent. Elles s'exaltent davantage devant la résistance qui se montre invincible, et des prodiges d'héroïsme se multiplient. Ils ne se comptent plus. Les héros tombent, mais pour ne plus se relever. Nos pertes sont énormes, celles de l'ennemi plus graves encore.
Maintenant, toute l'armée bavaroise englobe Sedan, qu'elle menace de sa voix tonnante et de ses feux roulants d'artillerie.
Il est onze heures et Bazeilles est livré aux Allemands, qui viennent de nous l'enlever, après sept heures de combat acharné et six mille hommes perdus sur trente mille engagés pendant les deux journées.
Midi sonne et Bazeilles est la proie des flammes. Les lueurs sanglantes de l'incendie montent de la fournaise ardente et se reflètent dans le ciel, colorant l'azur en rouge et éclairant cet horrible drame, où le feu dispute au fer le choix de ses victimes ....
... Mais une poignée de braves, séparés du gros de l'armée, environ soixante-quinze officiers et soldats de l'infanterie de marine, et parmi eux : MM. Herre-Win, de Maudhuit, Merson ... deux sous-lieutenants, MM. Escoubé et Saint-Félix, quatre capitaines, Bourgey, Picard, Delaury, etc., se sont fait un refuge d'une maison isolée sur la route en battant en retraite devant l'ennemi. Ils s'y rencontrent avec le commandant Lambert, cruellement blessé, qui y a été transporté par trois ou quatre soldats.
Immédiatement ils organisent la défense de ce blockhaus où ils s'enferment. Mais le rez-de-chaussée est reconnu impropre à cette défense et ils gravissent un escalier étroit, raide et sombre, pour se répandre dans les chambres du premier étage et jusqu'aux greniers. Aux fenêtres du premier pendaient encore des rideaux, et les lits étaient garnis de leur fourniture habituelle, moins les draps, qui avaient été emportés. Une modeste lithographie ou des gravures enluminées ornaient les murs.
La fusillade crépite de toutes les fenêtres et par toutes les ouvertures.
Cette maison occupe perpendiculairement à la route de Balan une trentaine de mètres environ. C'est une auberge qui avait pour enseigne : Vins, Bière, Eau-de-vie.
Elle forme comme deux corps de bâtiment contigus l'un à l'autre, avec huit fenêtres en haut, autant dans le bas, et trois portes, qui toutes s'ouvrent sur la façade orientale, aux flots de l'invasion séculaire. C'est par la porte qu'ils ont pénétré à l'intérieur. Devant elle s'étend un jardinet avec des tonnelles, derrière lesquelles s'abritent les Bavarois qui dirigent une incessante fusillade.
Les nôtres ripostent avec énergie pendant plusieurs heures et tiennent en respect toute une division, la 15e brigade du 1er corps bavarois.
Déjà on a évacué les greniers, la place est intenable; elle est labourée par les obus. Les chambres sont remplies d'une fumée intense et âcre, et quiconque penche la tête près de la fenêtre est certain de s'y faire loger une balle. Mais si le courage chez ces hommes énergiques est inépuisable, les ressources ne le sont pas et les munitions manquent. Elles font même défaut complètement, car les revolvers ont été déchargés.
Le parti est décisif. Le général allemand, impatienté de cette résistance prolongée, envoie une pièce de canon qui vient se mettre en batterie à quelques centaines de mètres de la maison. Les courageux soldats voient le train d'artillerie galoper sur la route.
Il n'y a plus que deux moyens à prendre. Il faut se rendre à merci ou se résigner à descendre dans les caves et y attendre la mort, puisqu'on va au-devant d'elle et qu'elle ne vient pas à vous.
Quelques-uns y sont même rendus déjà et leurs mains ensanglantées ont maculé les murs de larges taches rouges.
On tint conseil alors, conseil où chacun, même le plus humble d'entre tous, fut admis à donner son avis. Quelques-uns émirent le vœu de sortir à la baïonnette. Il allait prévaloir, malgré le grand nombre des assiégeants, quand il fut rejeté, dans la crainte qu'après avoir abandonné le commandant Lambert, l'ennemi n'usât de représailles, en se livrant sur lui à des actes de cruauté.
Mais le commandant insista pour qu'on ne s'occupât pas de lui. Sur le refus de ses hommes, il leur dit alors : « Eh bien, je vais sortir. Si l'on me tue, il n'y aura plus rien à espérer pour vous et il sera temps de vendre chèrement votre vie. »
En effet, il sortit et s'engagea sous une tonnelle de houblons, occupée de chaque côté par les Bavarois, qui ne pouvaient tirer sur lui sans tirer sur leurs camarades. Grâce à cet abri il put parvenir jusqu'à eux. Ceux-ci se ruaient déjà sur lui et allaient le mettre en pièces quand intervint, au péril de sa vie, un officier bavarois, qui éleva son bras protecteur entre cent autres prêts à le transpercer : c'était celui du généreux capitaine Lissignolo.
Cette sortie fut le signal de la reddition; car tous nos soldats d'infanterie de marine franchirent un à un le seuil de cette porte, par laquelle, entrés soixante-dix ou quatre-vingts, ils sortaient quarante environ, qui venaient déposer leur arme mutilée.
L'ennemi, furieux d'avoir été arrêté par un si petit nombre d'hommes, crut à un piège et vint décharger ses armes par les soupiraux des caves.
Les officiers prisonniers, conduits ensuite auprès du prince royal de Prusse, furent autorisés par lui, « n'admettant point, dit-il, qu'on désarmât d'aussi braves soldats », à garder leur épée et furent dirigés du côté de Remilly : mais ils exprimèrent le désir de partager la captivité avec leurs soldats et partirent le lendemain matin pour l'Allemagne, les uns pour Neubourg, les autres pour Ingolstadt.
(G. Bastard, la Défense (le Bazeilles.)
(0llendorff, éditeur.)
Les marins au siège de Paris
La situation normale des marins à Paris était pleine d'inconnu.
Le tempérament de ces hommes vigoureux, leurs habitudes à terre dans les ports, les exemples qu'ils avaient sous les yeux, l'instillation pernicieuse produite par la lecture de certains journaux, furent, dès les premiers jours, notre principale préoccupation. La situation intérieure ne pouvait qu'ajouter à nos inquiétudes.
C'était en effet la première fois que des marins venaient opérer si loin du littoral, dans des conditions tellement en dehors de leurs habitudes, et dans des circonstances si exceptionnelles.
En 1854 et 1855, ils avaient mis pied à terre devant Sébastopol.
L'infanterie et l'artillerie de marine y figuraient en nombre. M. l'amiral Rigault de Genouilly, qui y commandait les batteries débarquées de la flotte, avait su leur faire acquérir une juste renommée.
Au Mexique, on avait joint aux troupes de terre un contingent de marins qui, s'ils ont été peu aptes à la marche, par manque d'habitude, ne s'en sont pas moins montrés durs aux privations, âpres au combat, dociles à leurs chefs. Et l'infanterie de marine, reléguée aussi, sans répit, dans les Terres-Chaudes, a dû s'y voir stoïquement décimée par la maladie et par d'incessantes et obscures rencontres avec l'ennemi.
Elle a pu lire dans les documents officiels de l'époque cette appréciation qui est son honneur : « Que les familles se rassurent ; il n'y a de malsain au Mexique que les Terres-Chaudes, et elles sont occupées par la marine. »
En Cochinchine, en Chine, au Japon, au Sénégal, sur cent autres points du globe, des faits analogues se sont produits. Mais à Sébastopol les marins étaient sur une langue de terre, en vue de leurs vaisseaux. Au Mexique et partout ailleurs, ils étaient sur un territoire ennemi où tout écart était un danger.
À Paris, ils se trouvaient en présence d'autres écueils, des écueils non moins périlleux qu'offrent les entraînements de la grande capitale, de ceux que présentaient les excitations populaires dont tout militaire était alors systématiquement l'objet, excitations fomentées de longue main, habilement ourdis, et s'essayant sans répit sur la naïve droiture de nos hommes. Ces braves gens ont pu, sous la direction de chefs dévoués, s'éloigner des uns et éviter les autres. Ils ont su, ces nobles natures, rester étrangers aux écarts d'une révolution qui dans un tel moment excitait leur surprise, et aux ambages de la politique qu'ils ne voulaient pas comprendre, et qui, dans ces suprêmes moments de crise, répugnaient à leur honnête bon sens.
Dans la marine, l'obéissance est passive.
Le matelot ne discute pas l'ordre de l'officier, dans lequel il a une confiance absolue, et qu'il sait n'agir que dans ses intérêts. Son officier, c'est son tuteur. Insouciant comme tout homme qui est souvent au danger, il sent qu'il a besoin d'être conduit, et sa docilité pour l'exécution de tout travail n'a d'égale que son abnégation, d'autant plus entière que le travail est plus périlleux. Il a l'instinct et l'orgueil du dévouement. S'il reconnaît la supériorité de son chef, il sent en même temps son affection. C'est un trait caractéristique de la vie du marin que cet attachement réciproque des hommes et des officiers. Il prend sa source dans cette vie pour ainsi dire commune au milieu d'un espace restreint, où les qualités comme les défauts des uns et des autres ne tardent pas à paraître au grand jour, et engendrent une indulgence mutuelle.
Les caractères se jaugent alors et les affinités se développent.
Dans l'espace restreint des forts, la vie commune a produit la même indulgence, les mêmes affinités que dans l'espace restreint des vaisseaux.
Nos règlements placent constamment l'officier à côté du matelot. Ils exigent de plus que tout le monde à bord soit continuellement occupé ; il n'est pas une heure du jour ou de la nuit dont l'emploi ne soit fixé d'avance. Ces deux principes comptent parmi les éléments de notre puissance disciplinaire. Nous ne pouvions manquer de les faire scrupuleusement observer dans les forts.
Le public, restant encore sous l'impression d'anciens préjugés, est porté à croire que l'obéissance absolue ne s'obtient chez nous que per les punitions les plus sévères, par les traitements les plus draconiens. Il n'en est rien. L'époque des sévérités légendaires est passée depuis longtemps, et on ne devra plus s'étonner d'apprendre que les peines contre l'insubordination sont de celles qui ont le plus rarement lieu d'être appliquées.
Il en a été ainsi parmi nous.
Dès leur arrivée à Paris, nous avons enseigné aux marins à considérer un fort comme un vaisseau, à y observer les mêmes règlements, à y prendre les mêmes habitudes, à y suivre le même régime, en un mot. On y employait le même langage qu'à bord : on faisait partie de l'équipage de tel ou tel fort, et on ne pouvait sortir du fort sans demander la permission d'aller à terre. Les parapets étaient les bastingages, les embrasures les sabords. Le dimanche, c'étaient les mêmes distractions qu'à bord.
Outre les jeux gymnastiques et les assauts, triomphe des prévôts et des maîtres d'armes, le loto, ce whist des matelots, en faisait le plus souvent les frais. Et la marchande venait tous les jours, comme à bord, à des heures prescrites étaler à une place déterminée, aux yeux de l'équipage, des vêtements, des vivres et de menus objets de luxe, soigneusement contrôlés d'avance par le capitaine d'armes et l'officier en second.
Ces habitudes, ces distractions ont suffi aux marins. Paris ne leur a pas présenté les attraits que nous redoutions tout d'abord. Il n'est pas aisé d'étonner nos hommes. Ils n'ont pas tardé de voir avec répugnance que, dans une partie de la population, plus soucieuse de ses droits que de ses devoirs, l'ardeur de la guerre à la société se dissimulait derrière l'ardeur de la guerre à l'Allemand.
Paris fut ainsi pour eux un pays non moins étrange qu'étranger, et lorsqu'ils furent enfin renvoyés dans leurs ports ou dans leurs familles, ils auraient volontiers dit qu'ils allaient rentrer en France.
Quoi qu'il en soit, la marine avait insensiblement, et presque à son insu, provoqué de la part de la population parisienne, toujours si impressionnable, un engouement de plus en plus marqué, et les journaux, se faisant les échos de cet engouement, dépassaient souvent la mesure de l'éloge. Ils rabaissaient de cette manière tant d'autres efforts, tant d'autres dévouements, tant d'autres sacrifices, et laissaient méconnaître ou tomber dans l'oubli des services effacés peut-être, mais non moins dignes d'appréciation.
Étrangers à toutes les péripéties de la politique, les marins ne garderont que le souvenir du devoir accompli. Chacun d'eux pourra dire avec orgueil : "J'étais au siège de Paris".
Sous la conduite de chefs intrépides et hardis, sous la conduite des amiraux Saisset et Pothuau, qui n'ont pas moins puisé dans les élans d'une vieille amitié pour nous que dans les règles de la hiérarchie l'inspiration du concours sans relâche qu'ils nous ont prêté, ils coururent au danger l'âme pleine comme eux des plus nobles sentiments que fasse naître le saint amour de la patrie. Nous avons à cœur d'avoir mérité l'estime de ces chefs vaillants. Celle qu'ils nous ont inspirée n'a fait qu'accroître la sympathique affection qui nous unissait à eux depuis de longues années.
Que Paris, dans ses amers retours vers les faits accomplis, conserve dans son cœur la mémoire de ces braves gens qui sont venus concourir à sa défense.
Que Paris le sache, que la France le sache, les matelots n'oublieront jamais qu'au milieu de tant de douleurs — dans les succès comme dans les revers — ils ont vu des poignées d'enfants inexpérimentés de la mobile, ou leurs aînés de la garde nationale, les seconder dans ces luttes stériles, les accompagner dans ces fatigues à chaque instant renouvelées, et combattre avec eux comme des hommes de cœur, beaucoup comme des héros!
Que l'armée sache que dans ces régiments, où tout, officiers et soldats, fut improvisé, les marins ont puisé de salutaires exemples et rencontré des frères dont l'union a été cimentée par les dangers et les privations partagés! Et si quelque jalousie eût pu se faire jour, elle se serait traduite, en maintes circonstances, parla rivalité du devoir, ou se serait transformée dans la confraternité du patriotisme et la douleur commune de l'insuccès.
Que la marine enfin, qui, elle, avait le privilège de son organisation et de sa discipline, que la marine sache que dans l'armée de Paris tout fut à créer par des efforts inouïs! L'artillerie, le train, l'administration, tout dut être constitué. Un matériel entier fut à construire. Deux grandes armées, une artillerie formidable sortirent de ces efforts. Que la marine s'incline avec respect devant de telles entreprises!
Et, édifiée par ces exemples, elle voudra toujours être prête, au premier appel de la patrie menacée, à verser son sang pour son salut et sa grandeur, à racheter ses douloureux désastres et faire revivre ses gloires évanouies !
La marine n'a fait d'ailleurs que renouveler devant Paris les combats lointains qu'elle livre chaque jour dans ces contrées au climat meurtrier, que l'indifférence publique se refuse à connaître, et où les maladies font dans nos rangs des victimes inconnues, mais non moins regrettables. D'aussi dignes que ceux qui ont succombé devant Paris sont morts, que l'on ne connaîtra jamais.
Et l'infanterie de marine, si héroïque à Bazeilles; et l'artillerie de marine, si vigoureuse à Paris, ces armes modestes et vaillantes qui dans cette guerre n'ont pas déchu de leur passé, veut-on savoir leur lendemain ? Elles vont partir pour quelque colonie lointaine, et là, morcelées en petits détachements, elles vont s'en aller dans l'intérieur, le plus souvent sans nouvelles, sans écho de la patrie. Après quelques mois, on apprendra que le détachement est réduit à moitié par le climat, par la maladie, ou qu'il a été décimé dans quelque obscur combat. La mort marche à grands pas dans leurs rangs. Voilà le vrai dévouement, l'abnégation, le devoir dans toute sa rigueur.
Tant de sang généreux apaisera la colère divine. Dieu pardonnera à notre chère patrie ses erreurs et ses fautes, et la marine ira bien loin encore, portant toujours le front haut, sur des navires qui plus tard recevront les noms d'Avion, de Rosny, du Bourget, de Montrouge, dire au monde entier que la France, blessée à mort, se relèvera cependant un jour, et, déchirant son linceul, reparaîtra plus jeune, plus puissante, et aussi plus sage qu'autrefois.
(Vice-Amiral de la Roncière-Le Noury, la Marine au siège de Paris.)
(Pion, Nourrit et Cie, éditeurs.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_du_Bourget_(1870)

Attaque du Bourget
(21 DÉCEMBRE 1870)
Dès quatre heures et demie du matin, les troupes sont en mouvement et vont prendre les positions qui leur ont été assignées. La nuit est encore obscure, et la brume, extrêmement épaisse, ralentit leur marche.
Un bataillon de mobiles, de la brigade Lamothe-Tenet, se trompe de route. Le chef de bataillon Gruigon, qui commande le 138e, est grièvement blessé d'un coup de pied de cheval.
L'heure de l'attaque est retardée jusqu'à ce que la brume se dissipe, vers sept heures trois quarts.
À ce moment, les wagons blindés, qui se sont avancés jusqu'au point où la voie est interrompue, donnent le signal, et le feu des forts commence.
Un quart d'heure après, les colonnes d'assaut de la brigade Lamothe-Tenet s'élancent en avant.
La batterie de 4, commandant Durand, qui accompagne la colonne d'attaque, dirige un feu vif contre le village, jusqu'au moment où les troupes s'y précipitent.
Le 3e bataillon de marins-fusiliers, capitaine de frégate de Valessie, est en tête, puis le 138e de ligne. Ce régiment enlève vivement le cimetière, puis les barricades qui défendaient les rues adjacentes à l'église. En même temps, le 3e bataillon de marins attaque le village par la partie ouest, et y pénètre en enlevant également les barricades.
Le capitaine de frégate Lamothe-Tenet, qui dirige l'attaque avec une rare énergie et une bravoure qui fait l'admiration de tous, a son cheval frappé au poitrail à bout portant, à la première barricade.
Les rues, les jardins, les maisons s'enlèvent successivement.
À neuf heures et demie, nous étions maîtres de la partie du village que la deuxième colonne avait mission d'occuper. Il ne restait plus que quelques ennemis qui tiraient encore des maisons et que l'on poursuivait activement.
Nous avions déjà une centaine de prisonniers.
L'attaque dirigée par le général Lavoignet sur la partie sud éprouve une grande résistance. Ses troupes, après être entrées dans les premières maisons du village, sont arrêtées par un feu très vif des barricades et des murs crénelés, tiraillent longtemps et ne peuvent pousser plus loin. Elles s'établissent dans les maisons et les hangars, ainsi que dans les champs à gauche de la voie, sans pouvoir franchir le mur de fer qui leur est opposé.
Le lieutenant de vaisseau Peltereau, appréciant la situation, et voulant faciliter à la brigade Lavoignet l'entrée qu'elle ne peut franchir, fait le tour du village et attaque à revers, avec la compagnie de marins qu'il commande, les barricades du sud.
Les enseignes de vaisseau de Vilers et de la Panouse, officiers d'ordonnance de l'amiral, s'avancent à l'est du village pour s'assurer si de ce côté on peut passer la rivière. Ils sont accueillis par une vive fusillade des murs crénelés, et trouvent la rivière, marécageuse sur ce point, difficile à franchir.
L'ennemi alors, massé au nombre de 300 environ derrière un mur, envoie des tirailleurs le long de la Molette pour nous défendre l'accès du parc du Bourget.
À dix heures, un premier bataillon de renfort lui arrive ; il est suivi successivement de plusieurs autres. Une batterie d'artillerie accourt en toute hâte du Pont-Iblon.
Un retour offensif se dessine.
Dugny, Larges et Pont-Iblon ouvrent un feu violent sur la partie du village que nous occupons et où nous nous barricadons.
Alors s'engage une lutte terrible dans laquelle le capitaine de frégate Lamothe-Tenet, ses héroïques marins et les solides soldats du 138e s'acharnent à garder leur position pendant plus de deux heures, dans l'espoir que la brigade Lavoignet pourra vaincre de son côté la résistance de l'ennemi, qui assurerait la possession du village.
Dans la position périlleuse qu'il a prise avec sa compagnie, le lieutenant de vaisseau Peltereau se trouve bientôt séparé de tous. Il succombe avec elle : l'ennemi seul a pu être le témoin de leur héroïsme.
Dès neuf heures, le gouverneur, suivi d'un nombreux état-major, était arrivé par la route de Flandre à la Suiferie.
C'est de là que vont rayonner ses ordres.
À six heures, voyant que la résistance des murs crénelés, d'où partent les terribles fusillades qui arrêtent la brigade Lavoignet, ne peut être vaincue, il prescrit d'amener une batterie d'artillerie.
Cette batterie se place près de la route et commence un feu très bien dirigé contre ces murs. Plusieurs brèches y sont faites. Mais ce feu d'artillerie devient funeste à nos marins et aux autres troupes qui tiennent toujours dans le village. Ceux des obus qui dépassent les murs crénelés viennent tomber au milieu d'eux et se joindre aux projectiles que font pleuvoir Dugny, Garges et Pont-lblon. Le fort d'Aubervilliers, qui a l'ordre de tirer au-delà du Bourget pour arrêter les renforts prussiens, a un tir incertain. Plusieurs de ses obus tombent dans le village. Enfin une batterie, établie à Drancy, qui devait également tirer sur la route de Lille, à droite du village, apercevant encore des Prussiens dans les maisons, tire sur le village même, et quelques-uns de ses projectiles viennent encore tomber au milieu de nos troupes.
Le capitaine de frégate Vignes et le sous-lieutenant de Sagan, aides de camp de l'amiral, reviennent rendre compte de cette situation.
À ce moment, la colonne du général Hanrion, tenue en réserve, s'élançait pour soutenir la colonne du commandant Lamothe-Tenet. Mais la colonne Lamothe-Tenet s'aperçoit que des boulets français se mêlent aux boulets prussiens. Se voyant doublement décimée, à onze heures et demie elle se retire en ordre et va se former dans un pli de terrain vers La Courneuve, derrière la batterie de 4.
Les renforts ennemis arrivent par masses; il est impossible de songer à rentrer dans le village. Les forts et les batteries reçoivent alors l'ordre de le couvrir de leur feu.
À midi et demi, le gouverneur retourne à Aubervilliers, après avoir informé te général Ducrot à Drancy que, « l'attaque du Bourget paraissant avoir échoué, il ne devait encore prononcer aucun mouvement, et en informer le vice-amiral Saisset ».
La brigade Lavoignet tient son poste jusqu'à deux heures et demie, où elle reçoit l'ordre de cesser le combat inutile que soutiennent ses tirailleurs.
À trois heures, toutes les troupes ont repris leurs cantonnements.
Pendant l'opération sur Le Bourget, le colonel Dautrement, commandant le 4e régiment des mobiles de la Seine, dirigeait une diversion sur Stains. Cette opération, à laquelle concourent le 10e bataillon, commandant Jenny, le 12e, commandant de Neuvier, le 15e, lieutenant-colonel Roussan, le 14e, commandant Jacob, un détachement du 62e bataillon de marche de la garde nationale de Saint-Denis, lieutenant-colonel Arthur de Fonvielle, a été menée très énergiquement. Elle s'est vaillamment engagée au-delà même des instructions du vice-amiral, qui prescrivaient, puisqu'il ne s'agissait que d'une diversion, de ne pas pousser à fond.
Enfin, le 68e bataillon de marche de la garde nationale de Saint-Denis, commandant Escarguel, a fait une démonstration devant Épinay.
En même temps, les batteries flottantes 1 et 4, commandées par les lieutenants de vaisseau Rocomaure et Pougin de Maisonneuve, descendent la Seine jusque devant le même village, qui les accueille par un violent feu de mousqueterie auquel se mêlent les batteries d'Orgemont et du Cygne d'Enghien. Elles rentrent à Saint-Denis avant la nuit sans qu'aucun boulet ait atteint leur pont, partie essentiellement vulnérable de cette sorte de navire.
Les pertes de nos marins sont des plus sensibles.
Nous avons deux cent cinquante hommes hors de combat. Six hommes seulement de la compagnie Peltereau revinrent. Les lieutenants de vaisseau Morand, Peltereau, Laborde, les enseignes de vaisseau Duquesne, Wyts, sont tués. Le lieutenant de vaisseau Bouisset, aide de camp du commandant Lamothe-Tenet, succombe le lendemain à ses blessures. Le lieutenant de vaisseau Patin succombe également quelques jours après.
L'enseigne de vaisseau Gaillard, blessé, parvient à s'échapper après l'évacuation, et traverse en rampant la Molette jusque près de l'emplacement des ambulances, qui le recueillent épuisé. En somme, dans cette journée, la marine perd 8 officiers et 254 hommes sur 15 officiers et 689 hommes présents au début de l'action.
Le 158e a 1 officier tué, le lieutenant Charpentier, 7 officiers blessés et un total de 565 hommes tués, blessés ou disparus.
Dans la brigade Lavoignet, le 154e a 1 officier tué, 7 officiers blessés, dont le chef de bataillon Bouquet de la Jolinière.
Les francs-tireurs de la Presse ont 2 officiers tués et 55 hommes tués ou blessés.
Enfin les troupes sous les ordres du colonel Dautrement perdent le chef de bataillon Jenny, commandant le 10e bataillon de mobiles de la Seine, qui est tué ; le commandant de Neuvier du 12e, et 7 officiers sont blessés. Le 15e a un officier blessé. L'ensemble de la troupe a 9 tués et 150 blessés.
Les ambulances de la Presse, sous la conduite de M. le docteur Ricord, secondé par M. l'abbé Bauer et M.de la Grangerie, se sont avancées près du Bourget, et leurs brancards, portés par les frères des écoles chrétiennes, sont allés chercher les blessés au milieu du feu. C'est là que le digne Néthelme a été frappé mortellement.
Le lieutenant de vaisseau Fournier (François-Ernest), officier d'ordonnance du vice-amiral commandant en chef, déploie un courage et une énergie dignes des plus grands éloges, et est mis à l'ordre du jour.
(Vice-Amiral de La Roncière-Le Noury,
la Marine au siège de Paris.)
(Pion, Nourrit et Cie, éditeurs.)
L'amiral Jauréguiberry à l'armée de la Loire
L'amiral Jauréguiberry fut envoyé à l'armée de la Loire comme commandant d'une division. Il y devint plus tard commandant en chef du 16e corps sous les ordres du général Chanzy.
LA guerre de 1870 l'a placé hors de pair.
Pendant toute cette campagne, il a été admirable. Il était sans cesse occupé du bien-être des soldats, jamais du sien. Bien qu'il souffrît beaucoup du froid et que la température de cet hiver fût exceptionnellement rigoureuse, il ne s'inquiétait jamais de son installation personnelle. N'importe quel toit lui suffisait, pourvu qu'il fût placé bien au centre de ses divisions, à un point lui permettant d'exercer une surveillance de chaque instant.
Après la bataille de Coulmiers, alors que ses troupes étaient campées à Saint-Péravy, il couchait comme elles et au milieu d'elles sur la paille.
Pendant l'action, on le voyait partout, même sur la ligne des tirailleurs, soutenant les soldats par sa présence, excitant leur courage par ses paroles.
Au combat de Vendôme, comme on lui faisait observer qu'il s'exposait beaucoup trop, il répondit qu'avec des troupes aussi jeunes et aussi inexpérimentées, la place du général devait être au premier rang.
Son sang-froid était incomparable. Le feu le plus vif ne lui donnait aucune émotion. Son âme ardente et passionnée se cachait sous une enveloppe impénétrable.
Il travaillait sans cesse, bien avant dans la nuit ; puis, avant de s'endormir, il lisait la Bible et écrivait aux siens.
Le matin, dès le point du jour, il était à cheval, donnant ses ordres, se montrant à ses troupes, leur parlant, développant une activité de chaque instant.
Au lendemain de la bataille du Mans, où il donna tant de preuves de valeur, il réussit à communiquer à son corps un peu de sa ténacité et de sa résolution. De 11 heures du matin jusqu'à minuit, il disputa le passage d'une vallée à un ennemi dont le nombre augmentait sans cesse. À ses côtés le colonel Béraud, son chef d'état-major, était tué par un obus. Le même projectile traversait le cou du cheval de l'amiral, qui s'abattait sous son cavalier. On crut l'amiral mort et on se précipita pour le relever. L'instant d'après il continuait à donner des ordres avec un calme inaltérable.
Son corps d'armée, bien que composé d'éléments très faibles, fut un des plus résistants, notamment la première division, dont il avait eu le commandement jusqu'au 6 décembre; mais les circonstances l'ont mal servi. À la tête de vieux soldats, il eût été de taille à changer la face de la guerre et eût acquis une des plus hautes renommées militaires qu'un homme puisse atteindre.
(Contre-Amiral Dupont,
Notice historique sur l'Amiral Jauréguiberry,)
https://books.google.be/books?id=dXcpDwAAQBAJ&pg=PT441&lpg=PT441&dq=cyclone+octobre+1871&source=bl&ots=zygZVwCWx9&sig=ACfU3U2mQN4MTwslWyu-8s01nDweONCZ-A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitk-P3nrPqAhWG2aQKHbQSD8sQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=cyclone%20octobre%201871&f=false
Le cyclone de l' "Amazone"
(10 OCTOBRE 1871)
PARTI de la Martinique pour Rochefort le 5 octobre, l'Amazone débouquait des Antilles par le canal de la Dominique, à la vapeur et sous les voiles-goélettes. Après avoir doublé l'île de la Désirade, on établit toute la voilure, et les feux de la machine furent éteints.
Nous filions ainsi six nœuds au plus près du vent.
Le 8, le temps commença à se couvrir vers l'est ; les nuages passant à l'ouest par le nord nous amenaient quelques grains, pendant lesquels le vent sautait de l'E.-N.-E. au N.-E. Aux nuages blancs et arrondis, caractéristiques des alizés, succédaient peu à peu des cirrus et des nimbus.
Pendant la nuit, des grains devinrent fréquents; de fortes rafales et une pluie torrentielle les accompagnaient.
On commença à prendre des ris dans les voiles.
Dans la journée du 9, le vent força ; une grosse houle soulevait la mer, et pendant les grains, la brise refusait momentanément. Avant la nuit, nous avions déjà deux ris aux huniers, un ris aux basses voiles et deux aux voiles-goélettes ; nous portions en outre l'artimon et le petit foc.
Les étoiles disparaissaient sous un rideau de nuages grisâtres, et des éclairs se montraient dans la partie ouest. Le baromètre commençait à descendre, mais si lentement, que nous n'avions aucune inquiétude.
Dans la matinée du 10, le vent se fixa au N.-E. et les grains se succédèrent presque sans interruption, amenant une pluie à larges gouttes. La mer tourmentée, marbrée d'écume, élevait de grandes vagues dont le sommet transparent se recouvrait d'une légère poussière blanche ; le ciel, couvert d'épais nuages d'un gris de plomb, était menaçant.
L'Amazone poursuivait toujours sa route.
Notre unique souci était la perte de temps que nous occasionnait ce coup de vent qui, directement contraire à notre route, nous rejetait dans l'ouest.
Le 10, midi, nous étions par 25° 52' de latitude nord et 67°41' de longitude ouest. Le vent redoublait, sa violence était devenue telle que les vagues ne pouvaient plus élever leur crête : elles étaient renversées dans leur propre sillon. De longues stries blanches couvraient la surface de la mer, surmontées à une grande hauteur d'une poussière d'écume entraînée par le vent.
C'est alors seulement qu'on songea à la possibilité d'un cyclone. Étions-nous en présence d'un de ces ouragans ou d'une tempête rectiligne?
La manœuvre étant opposée dans chacun de ces deux cas, il importait d'avoir le plus tôt possible une certitude. Une forte houle, la violence croissante du vent et la baisse du baromètre, qui sont les indices d'un cyclone, sont aussi ceux d'une tempête ordinaire, avec cette différence que la baisse barométrique est plus prononcée dans le premier cas. Or le baromètre, qui le 9, à midi, marquait 764 millimètres, était descendu progressivement jusqu' à 759 millimètres le 10, midi, baisse qui n'avait rien d'alarmant et pouvait faire croire à un simple coup de vent.
Nous étions, il est vrai, dans les parages les plus fréquentés par les cyclones, mais ces phénomènes sont rares, et comme nous savions qu'il en était récemment passé deux (l'un le 21 août, et l'autre le 2 octobre) qui avaient détruit une grande partie de la ville de Saint-Thomas, nous ne pensions pas qu'un troisième les suivait de si près. D'ailleurs le vent gardait une direction constante, et à l'approche d'un cyclone il tourne dans un sens bien connu.
Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, c'est lorsqu'on se trouve directement sur le passage du centre, ce qui est le cas le plus dangereux.
Des nuages gris de plomb envahissaient l'horizon et le zénith ; une brume épaisse nous entourait peu à peu. La mer grossissait toujours, et les grains se succédaient avec une rapidité remarquable.
À midi et demi, la voile du grand hunier est déchirée par son milieu et emportée en mille morceaux.
Vers deux heures le temps était si couvert, que de l'arrière on distinguait à peine l'avant du bâtiment. On ne voyait plus qu'une faible partie de la mer autour de nous, c'est-à-dire les deux ou trois lames les plus voisines, dont la hauteur était effrayante.
Le baromètre donnait les indications suivantes :
Midi, 759 millimètres; — une heure quarante minutes, 757 millimètres; — quatre heures quarante-cinq minutes, 747 millimètres. Devant une baisse aussi rapide, le doute n'était plus possible. Nous étions en présence d'un cyclone, et comme nous avions marché jusque-là dans le N.-O., que de plus le vent n'avait pas changé de direction et soufflait au N.-E., le cyclone courait sur nous ; son cercle mouvant se transportait, du S.-E. au N.-O., et son centre devait passer sur nous.
La manœuvre à faire était donc de fuir vent arrière, le plus rapidement possible, afin de gagner le demi-cercle maniable, c'est-à-dire le côté du cyclone où la vitesse de translation, étant en sens inverse de la vitesse de rotation, la modère un peu.
Nous avions déjà perdu un temps précieux, et à cinq heures du soir, alors que le centre n'était plus qu'à dix lieues et se rapprochait avec une vitesse double de la nôtre, nous hésitions encore, et nous avions bien lieu d'être pleins d'anxiété. D'après les derniers devis de l'Amazone, il était reconnu que ce bâtiment était encore très bon dans ses parties avant, mais que l'arrière était mauvais, et qu'il ne fallait guère compter sur sa solidité.
Si donc, malgré les apparences, nous nous trouvions en présence d'une tempête rectiligne, en fuyant devant le temps nous courions le risque de perdre notre gouvernail et de rester à la merci de la tempête, ou de démolir notre arrière, d'engager peut-être, alors qu'à la cape le bâtiment ne courait aucun risque. — Dans cette grave situation, le commandant demanda aux officiers leur avis ; tous furent d'accord pour dire que nous étions incontestablement en présence d'un cyclone, et qu'il fallait en conséquence courir les chances de fuir vent arrière, malgré l'état de la mer et la violence des lames.
Vers cinq heures du soir, on commença donc à laisser porter. L'évolution fut fort lente. Ce n'est qu'à six heures que nous nous trouvâmes vent arrière, au S.-O., fuyant devant le temps sous la trinquette et la misaine avec deux ris. Le baromètre marquait 749 millimètres à quatre heures et demie, et à six heures il était descendu à 730 millimètres. Malheureusement nous ne pûmes courir ainsi qu'une demi-heure.
Vers six heures trente minutes, le navire refuse d'obéir à son gouvernail; il embarque et vient au S.-E., nous ramenant ainsi dans le cyclone.
Il est probable que le gouvernail avait été démonté par les lames.
Nous étions donc à la merci de l'ouragan !
Il faisait déjà nuit noir.
Le vent avait acquis une violence si prodigieuse qu'à chaque instant nous nous disions qu'il ne pouvait plus forcer, et cependant il augmentait encore ! Il ne fallait plus songer à manœuvrer sur le pont, au milieu d'une nuit épaisse et d'un fracas étourdissant. Le commandant et l'officier de quart seuls restaient encore en haut, mais ce n'est qu'en se parlant à l'oreille qu'ils parvenaient à échanger quelques paroles.
Au lieu d'avoir le cap au S.-0., nous l'avions successivement au.S.-E., au sud, etc., au gré de la tempête, nous rapprochant toujours du centre de l'ouragan. Les hauteurs barométriques étaient : à six heures cinquante minutes, 725 millimètres ; — à sept heures quinze minutes, 712 millimètres ; — à sept heures vingt-cinq minutes, 702 millimètres.
À sept heures et demie, le commandant prit la détermination de sacrifier les mâts supérieurs au mât d'artimon. Trois gabiers se présentent pour en couper les galhaubans. Touchante fraternité ! avant d'affronter la mort, ils s'embrassent, puis, la hache à la main, ils s'élancent dans l'obscurité et exécutent l'ordre donné.
Un instant après, le mât d'artimon tout entier est emporté, entraînant dans sa chute les embarcations suspendues aux flancs du navire et une partie des bastingages de l'arrière.
Le bruit du choc des lames contre les murailles qui se déformaient, s'inclinaient, était épouvantable. Notre masse entière était soulevée par intervalles, puis on sentait le navire, couché sur le flanc, plonger sous l'effort réuni de la mer et des vents.
Plus d'une fois le commandant crut que nous étions perdus. Dans les batteries on avait de l'eau jusqu'à mi-jambe : la mer entrait de tous les côtés. Afin de ne pas épouvanter davantage les passagers, nous disions que l'Amazone avait une coque assez solide pour résister au cyclone ; mais nous ne savions que trop qu'elle était en mauvais état et que notre perte était presque certaine.
Personne cependant ne perdait courage ; on avait à cœur de faire son devoir jusqu'au bout. Je dois rendre d'ailleurs cette justice aux passagers : c'est que pendant la tourmente je n'entendis aucun cri de désespoir ou de détresse. Le commandant sur le pont, les officiers, disséminés partout pour faire exécuter ses ordres, donnaient l'exemple du sang-froid, et l'équipage montrait un dévouement admirable. Les hommes passagers étaient aux pompes ; les femmes s'étaient rassemblées dans les cabines qui n'avaient pas été envahies par la mer, et priaient.
Je me trouvais à quelques mètres du grand mât quand j'entendis dire qu'il avait été emporté comme le mât d'artimon. Je voulus m'assurer de cette chute, dont le fracas avait été assourdi par le bruit de la tourmente, en montant sur le pont.
Au haut de l'échelle du grand panneau, je fus assailli par les bourrasques d'une pluie si dure, si serrée, et me fouettant le visage avec une telle force, que j'aurais pu croire à de la grêle si cette pluie n'eût été tiède, presque chaude. Le vent qui la chassait ainsi par rafales, avec cette vitesse terrible, faisait entendre un rugissement continuel. Rien ne saurait exprimer cette rage de destruction.
On n'entendait distinctement ni le grondement du tonnerre, ni celui de l'océan, ni le bruit des débris de mâts s'entrechoquant. Les éclairs sillonnant les nues presque sans intervalles, avec une vivacité extraordinaire, faisaient succéder à la profonde obscurité une lumière éblouissante, éclairant le ciel chargé d'épais nuages et la mer qui bouillonnait et menaçait à chaque instant de nous engloutir.
Le grand mât avait été brisé par le vent : il n'en .restait qu'un tronçon. Les mâts supérieurs de misaine étaient aussi tombés, emportant le bout-dehors du grand foc. La moitié de la vergue de misaine avait été emportée par sa voile.
La foudre tombait presque sans interruption, et les aigrettes lumineuses couraient sur l'extrémité des mâts comme des feux follets.
À sept heures quarante-cinq minutes, le baromètre était descendu à 698 millimètres. Baisse incroyable, et l'une des curieuses observations faites pendant cette nuit terrible.
À sept heures cinquante-cinq minutes, le calme le plus complet succéda sans transition à la tourmente. La pluie cessa, le vent et la mer tombèrent à la fois. Ceux qui ignoraient la marche ordinaire d'un cyclone se félicitaient de voir la fin de la tempête. Mais nous, nous comprenions que nous étions dans le centre; nous savions que le danger allait devenir plus imminent que jamais.
On s'empressa de profiter de l'accalmie, qui devait être bien courte, pour dégager, autant que possible, le pont des débris qui l'encombraient. Les matelots travaillaient avec ardeur sous la direction de leurs chefs, éclairés par la pâle lumière que répandait maintenant le ciel étoilé.
Le baromètre marquait toujours 698 millimètres; il était affolé et ses oscillations étaient de plus de 10 millimètres. On entendait au loin un grondement sourd.
De légères fraîcheurs, sans direction déterminée, venaient frapper le visage.
La mer était tourmentée dans tous les sens.
Une brume épaisse la recouvrait, et des nuages grisâtres s'élevaient au-dessus de l'horizon jusqu'à une hauteur de 40 degrés environ, laissant à découvert au-dessus de nos têtes un cercle de ciel pur, d'un bleu transparent, étincelant de la lumière des étoiles. Ce cercle s'étendait davantage sur tribord que sur bâbord, ce qui nous indiquait la zone centrale de calme, et l'ouragan passait sur nous suivant une petite corde de sa circonférence et non suivant un diamètre. Au bout d'un quart d'heure à peine, une brise folle de l'ouest commença à se faire sentir, de légères vapeurs envahirent le zénith ; en un clin d'œil le ciel s'assombrit, et à ce calme d'une majesté indescriptible succédèrent les plus violentes bourrasques. La pluie balaya de nouveau l'espace avec sa prodigieuse vitesse, les explosions électriques retentirent; ce fut pour nous l'heure suprême ! Nous savions que si le navire pouvait résister à ce premier choc, notre salut était presque assuré, la tempête devant ensuite diminuer rapidement.
Mais résisterait-il?
Notre gouvernail ne tarda pas à être emporté. Il n'y avait plus aucune manœuvre à faire ; la machine ne fut utilisée que pour pomper l'eau de la cale. L'équipage était soit aux pompes à bras, soit à faire la chaîne, soit à veiller les voies d'eau pour les aveugler. Nous nous laissions entraîner par l'ouragan.
Le vent, aussi terrible que celui qui avait précédé notre entrée dans le centre, imprimait cependant au bâtiment des mouvements moins violents, parce qu'il n'avait plus d'appui sur les mâts de l'arrière, dont la chute nous sauva. Le grondement de la tempête était plus sourd. Quant à sa direction, elle était opposée à celle observée dans la première partie du cyclone, ce qui doit être quand on passe dans le centre.
Le commandant et l'officier de quart étaient encore sur le pont; mais, pour ne pas être emportés, ils étaient contraints de se cramponner des deux mains, et bientôt ils furent obligés de descendre aussi. Au moment où ils quittaient le pont, une lame monstrueuse s'avançait, dominant le navire d'une dizaine de mètres, et semblant le menacer d'une perte certaine. Cette lame nous prit par les travers, nous enveloppa dans son tourbillon et, passant pardessus le pont, arracha les bastingages de chaque bord sur une grande longueur, emportant les embarcations suspendues par le travers du grand mât.
On renaissait toutefois peu à peu à l'espoir ; nous parvenions à étaler l'eau qui entrait dans la cale, et le baromètre remontait à vue d'œil, par saccades.
À deux heures dix minutes, il était encore à 698 millimètres, comme dans le centre; mais à trois heures quinze minutes il remontait à 705 millimètres ; à trois heures quarante minutes, à 715 millimètres; à quatre heures et demie, à 732 millimètres.
Dès ce moment on pouvait se considérer comme sauvés ; et en effet le baromètre continua à remonter rapidement; à six heures du matin, il était à 757 millimètres. Pendant cette terrible nuit, on ne s'occupa que de vider l'eau qui entrait à torrents de tous les côtés. À chaque moment, il semblait que le bâtiment allait s'entr'ouvrir sous les chocs furieux de la lame.
Quand enfin le jour vint nous éclairer, quel affligeant spectacle il offrit à nos yeux! Partout des désastres et un incroyable désordre. De toutes nos embarcations, il ne restait plus que la chaloupe à vapeur. Les manœuvres s'entrelaçaient dans tous les sens avec les débris hachés des mâts et des parois. Ces cordages retenaient encore des tronçons de mâts flottants, qui formaient bélier contre les flancs du navire à chaque coup de roulis.
On s'empressa de se délivrer de ces dangereuses épaves, on déblaya un peu le pont, et l'on travailla immédiatement à installer un gouvernail de fortune.
Par un bonheur inouï, nous n'avions perdu qu'un seul homme, un Annamite, qui s'était réfugié sous la chaloupe et avait été écrasé par sa chute.
Notre situation était grave.
Nous n'avions plus de mâts, plus de gouvernail, plus d'embarcations, et les voies d'eau étaient toujours à craindre, avec le fort roulis qui nous secouait par suite de l'absence de mâture.
La machine, heureusement, n'avait pas trop souffert, et c'est en elle que nous mettions tout notre espoir. Nous nous trouvions à 180 lieues de Saint-Thomas, terre la plus voisine. Le plus beau soleil brillait, sur nos têtes ; on respirait avec joie l'air calme et tiède.
Le 17 octobre, après six jours de nouvelles fatigues et d'inquiétudes, l'Amazone entrait à Porto-Rico, où arrivèrent bientôt la frégate amirale la Magicienne et l'aviso à vapeur le Talisman, de la station des Antilles, qui l'escortèrent jusqu'à la Martinique. Le 30, elle mouillait de nouveau sur rade de Port-de-France, où une commission supérieure procédait immédiatement à la visite de sa coque. L'Amazone fut condamnée, rayée de la liste des bâtiments de la flotte, et transformée en ponton.
(Récit d'un officier de l'Amazone.)
La prise de Sfax
(16 JUILLET 1881)
L'expédition de Tunisie, qui ne devait nécessiter d'abord que le concours de la division navale du Levant, ne tarda pas à prendre de plus grandes proportions, et l'escadre de la Méditerranée, commandée par le vice-amiral Garnault, reçut l'ordre d'attaquer le port de Sfax.
MALGRÉ l'irrégularité de son enceinte, Sfax a, en résumé, la forme d'un carré placé presque à toucher la mer au sommet d'un angle de la plage juste au point où le lais de basse mer a le moins d'étendue. Dans le sud-est de la ville, les bâtiments français semblaient groupés, bien qu'ils fussent séparés en raison de leur tirant d'eau.
Ainsi, les cinq canonnières avaient mouillé par les fonds de 3 mètres, les trois cuirassés de deuxième rang de la division du Levant, la Sarthe et le Desaix étaient par les fonds de 7 mètres, l'Intrépide par ceux de 8 mètres et les six grands cuirassés de l'escadre d'évolutions par ceux de 9 mètres.
Nos premiers bâtiments étaient à 2 200 mètres de la ville, les derniers à 6 000.
Les troupes à débarquer, au nombre de 4 000 hommes environ, étaient constituées par les six bataillons du 92° et du 136e de ligne, aux ordres du colonel Jamais, et les compagnies de débarquement accompagnées de leur artillerie légère organisée en trois batteries de pièces de 65 millimètres.
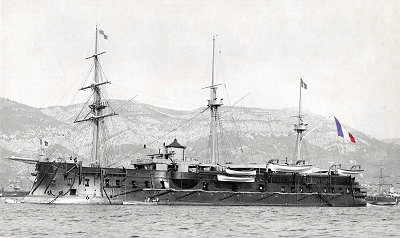
Les embarcations des navires et quelques barques du pays ou mahonnes, qu'on avait réquisitionnées, permettaient de mettre à terre à la fois 3 000 hommes, dont 1 600 marins et 1400 soldats, en résidence, les uns sur l'Intrépide, les autres sur la Sarthe; les hommes d'infanterie restés sur ces grands transports devaient être débarqués par les embarcations devenues libres.
L'amiral avait à se préoccuper de garantir l'ordre, la rapidité et la sécurité du débarquement, de façon qu'une fois à terre les troupes, immédiatement formées, pussent, sous le commandement général du colonel Jamais, accomplir chacune l'objectif assigné.
Les fonds croissant très lentement, il n'y avait qu'un point où les embarcations pouvaient approcher la plage; partout ailleurs elles s'échouaient, et ce point était exposé aux feux de la ville.
Aussi l'amiral avait ordonné la préparation d'une sorte de grande jetée flottante, en faisant dégréer et mettre à l'eau les vergues de hune des six cuirassés de l'escadre que M. le capitaine de frégate Juge, du Marengo, était chargé de conduire à terre et d'assembler perpendiculairement à la côte, ce qui rapprochait de plus de 100 mètres le point d'accostage.
Les embarcations de trois cuirassés, munies de leur armement de guerre, devaient flanquer la flottille et la protéger aussi près de terre que possible par leurs feux d'infanterie et d'artillerie. On leur avait même adjoint deux chalands empruntés à la Sarthe et à l'Intrépide, et portant chacun une grosse pièce.

M. le capitaine de frégate Trillot, du Friedland, commandait ces embarcations. Dès la veille, les fractions du pont-radeau avaient été confiées aux canonnières mouillées plus près de terre, et chaque bâtiment avait reçu les mahonnes destinées à porter son contingent.
M. le capitaine de vaisseau de Marquessac, de la Reine-Blanche, avait le commandement de la plage; et les compagnies de débarquement étaient, réparties en trois bataillons commandés respectivement par MM. les capitaines de vaisseau Miot, de l'Alma, Marcq Saint-Hilaire, du Colbert, et M. le capitaine de frégate Maréchal, du Trident; l'artillerie de l'escadre était sous les ordres de M. le capitaine de frégate Tabareau, de la Revanche.
Pour terminer l'exposé des préparatifs, il reste à dire que l'escadre avait formé un détachement de torpilleurs, chargé de faire sauter les obstacles, et que les baleinières étaient réservées pour remorquer le pont-radeau et faciliter ensuite l'approche des embarcations chargées de monde.
Enfin, comme plan général, les troupes de terre opéraient à droite avec le concours de la batterie de 65 millimètres de la division du Levant; les marins agissaient à gauche.
Le 16 au matin, entre deux heures trente et trois heures, les diverses actions commencèrent :
D'un côté, l'escadre bombardait la ville; les baleinières et un canot à vapeur allaient chercher le pont-radeau ; des embarcations armées en guerre se formaient en ligne de combat à 500 mètres dans l'est de la batterie rasante :
Enfin les troupes quittaient le bord. Le pont fut établi rapidement dès qu'on eut réussi à porter à terre une ancre qui servit de point d'appui pour se haler;
Outre les défenses permanentes de la place, les Arabes avaient constitué avec des tranchées et des amas d'alfa des avancées bien armées qu'il fallut battre. Ces tranchées furent fouillées par les projectiles des embarcations, qui incendièrent les amas d'alfa. Le vent d'est rabattait la fumée sur la ville, et les tranchées durent être, évacuées par leurs défenseurs. En même temps, les embarcations et les canonnières, par leur tir, gênaient l'arrivée des Arabes du dehors.

M. le contre-amiral Conrad avait mis son pavillon sur le Léopard. Quand il jugea le moment opportun, il fit hisser un signal convenu d'avance, et les embarcations, qui étaient massées non loin de terre et qui subissaient le feu de l'ennemi, heureusement mal dirigé, précipitèrent leur mouvement, et le débarquement s'opéra, chaque détachement étant aussitôt engagé.
L'enlèvement rapide de la batterie rasante et de la tranchée sud par les hommes du Trident, débarqués les premiers avec M. Couturier, enseigne de vaisseau, permit la formation du corps de débarquement sur la plage, et à partir de ce moment, l'opération se continua par une série d'actions isolées. En effet, on avait en face de soi une enceinte continue dont il fallut forcer les portes.
Le bombardement des jours précédents et de la matinée avait éloigné beaucoup des Arabes, mais n'avait pas donné de brèche praticable. C'est alors que les pièces de 65 millimètres et les torpilles portées rendirent de grands services en permettant d'abattre les portes qui donnèrent accès dans la ville à droite et à gauche.
Une fois entrée, la colonne d'attaque s'avança sous le feu en occupant les maisons l'une après l'autre.
Le bataillon de la division du Levant, ayant comme objectif la prise de la Casbah, avait plus de chemin à faire; M. le commandant Miot, après avoir fait sauter deux portes intérieures, était maître de la Casbah à sept heures et demie.
Pendant toute l'action, les divers détachements ont été constamment reliés les uns aux autres; de la droite, où combattaient le 92e et le 136e, à la gauche, où opérait le commandant Miot; les communications étaient assurées par M. Marcq Saint-Hilaire, qui était sans cesse en relations avec le colonel Jamais.
En résumé, cette affaire, qui a coûté à la marine 8 hommes tués et 33 blessés, dont 3 ont déjà succombé, a été exécutée avec ordre et entrain.
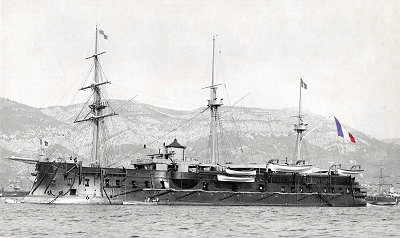


Vice-amiral GARNAULT.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escadre_d%27Extr%C3%AAme-Orient_(France)

Fou-chéou et la rivière Min
(25-50 AOÛT 1884)
L'Empire Chinois qui, dans le traité de Tien-Tsin, avait montré la plus insigne mauvaise foi à l'égard du Gouvernement Français, vient de recevoir le juste prix de sa duplicité, et nos braves soldats tombés dans le guet-à-pans de Bac-Lé ont été victorieusement vengés.
— Le grand arsenal de Fou-Tchéou, où la Chine avait accumulé un matériel de guerre considérable, et où stationnait aussi une flottille chinoise de vingt et quelque bâtiments, viennent d'être complètement anéantis par la flotte française sous les ordres de l'amiral Courbet.
— Le 23 août à deux heures du soir, le feu commença à bord des canonnières : le Volta, le Duguay-Trouin, la Triomphante, le Villars, le d'Estaing, la Vipère, l'Aspic, le Lynx, et les torpilleurs 45 et 46. À six heures du soir, l'arsenal était en flammes, de plus 9 vaisseaux et 12 jonques composant la flotte chinoise étaient coulés bas.
— Outre les pertes considérables du matériel de guerre et des vaisseaux, le Chinois ont eu 3 à 4000 hommes tant tués que blessés; tandis que de notre côté on signale la perte de 10 hommes tués et 27 blessés, dont 14 légèrement.
— En transmettant par télégramme cette grande victoire au gouvernement Français, l'amiral Courbet fait le plus grand éloge de l'état -major et des équipages de la flotte qui, dit-il, ont déployé un courage à toute épreuve.
— Notre gloire navale n'a donc jamais brillé d'un plus vif éclat, et l'amiral Courbet et nos braves matelots, en se couvrant de gloire, sont restés les dignes émules des vieux loups de mer que commandait autrefois l'illustre Jean-Bart.
LE 22, vers cinq heures du soir, arriva par télégramme l'autorisation d'ouvrir le feu.
Se trouvaient au mouillage de Pagoda : Volta, portant mon pavillon; Duguay-Trouin, Villars, D'Estaing, Lynx, Vipère, Aspic, plus les torpilleurs 45 et 46.
Les Chinois y avaient rassemblé 11 bâtiments de guerre, savoir :
Le croiseur Yang-ou; 5 transports-avisos, Tchen-Hang, Yong-Pao, Fou-Po, Fey-Yûne, Tsi-ngan; 1 aviso de flottilles, I.-Sing; 1 canonnière-aviso, Tchen-oueï; 5 canonnières, Fou-Sing, Fou-Sheng, Kien-Sheng, ces deux dernières du type alphabétique.
Plus, 12 grandes jonques de guerre. Ils avaient, en outre, armé 7 canots-torpilles à vapeur, 3 ou 4 à l'aviron, et disposé un certain nombre de brûlots.
Le Château-Renaud et la Saône, détachés au mouillage de Quantao, en amont de la passe Kimpaï, avaient pour mission de s'opposer à ce que les Chinois obstruassent cette passe, soit en coulant une trentaine de jonques chargées de pierres, réunies aux environs, soit en mouillant des torpilles.
M. de Bezaure, le vice-consul de France à Fou-chéou, que j'avais prié de se rendre en temps opportun à bord du Volta, apprit immédiatement les décisions du gouvernement et remonta à Fou-chéou pour amener son pavillon et pour prévenir le vice-roi et les consuls que je comptais ouvrir le feu dans la journée du lendemain.
De mon côté, j'informai l'amiral anglais le soir même, le commandant de la corvette américaine le lendemain de grand matin, et j'invitai le vice-consul anglais de Pagoda à avertir les bâtiments marchands. La plupart de ceux-ci étaient d'ailleurs, ainsi que les bâtiments de guerre, déjà mouillés hors des limites où, suivant toutes probabilités, l'action devait se passer.
Le 23 au matin, M. de Bezaure revint, m'informa que son pavillon était amené, que les consuls recevraient à huit heures du matin l'avis de mes intentions, que le vice-roi le recevrait à dix heures. Ces avis étaient pure formalité, car personne n'ignorait, dès le 22, que le 23 j'ouvrirais le feu.
En règle vis-à-vis de tout le monde, il ne me restait plus qu'à choisir le moment le plus favorable pour détruire d'abord les bâtiments de guerre, les jonques de guerre et les canots-torpilles dont ceux-là s'étaient flanqués. En vue de ce premier objectif, le commencement du jusant était tout indiqué par les positions respectives des forces navales sur une rade étroite où l'espace et la violence des courants rendaient les évolutions très difficiles. Le jusant commençait, du reste, quelques heures après le moment où vice-roi et consuls seraient officiellement avisés. Je fixai donc deux heures de l'après-midi.
Dès le matin, les bâtiments des deux nations étaient sous les feux, prêts à filer les chaînes et à marcher.
Pendant toute la durée du flot, de neuf heures et demie à une heure et demie, les Chinois firent ostensiblement leurs préparatifs d'appareillage et de combat; plusieurs même de leurs canots-torpilles vinrent faire autour du Volta des feintes d'attaque, se retirant dès qu'ils apercevaient un canon ou un hotchkiss braqué sur eux.
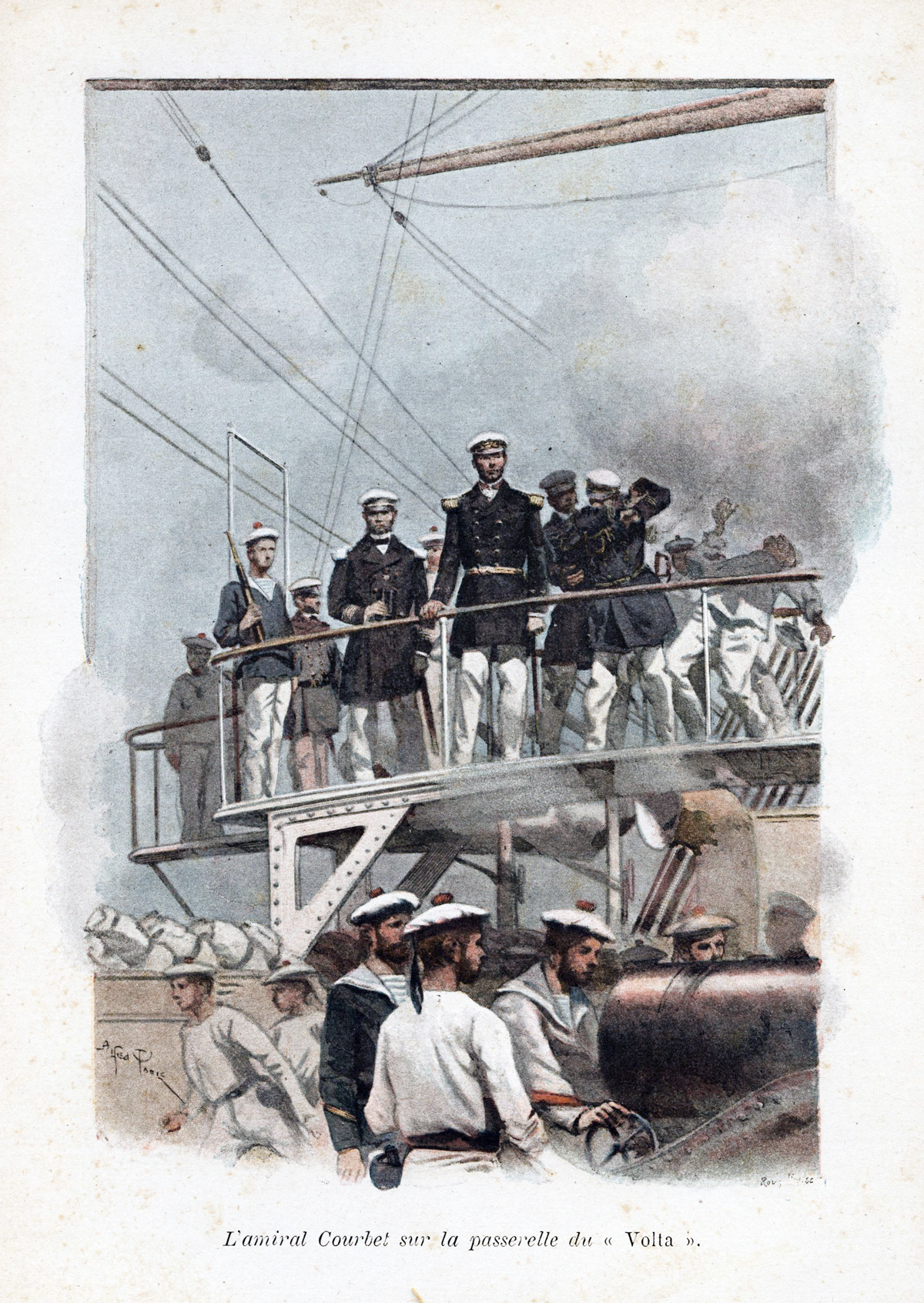
Vers une heure quarante-cinq, je signalai, de lever l'ancre et de se tenir prêt à attaquer conformément au plan.
Voici en quoi il consistait :
Dès le début, les torpilleurs 45 et 46 s'élanceraient respectivement sur le Fou-Po et le Yang-Ou soutenus par l'artillerie et la mousqueterie bâbord du Volta; ce croiseur ouvrirait aussi le feu par tribord sur les jonques de guerre dont il était le principal point de mire.
En même temps, les trois canonnières Aspic, Vipère, Lynx, laissant sur tribord le Volta, les torpilleurs, le Fou-Po et le Yang-Ou se porteraient rapidement à la hauteur de l'arsenal et livreraient combat aux trois canonnières et aux trois transports avisos qui s'y trouvaient.
Quatre canots à vapeur armés en guerre, sous les ordres de M. le lieutenant de vaisseau de Lapeyrère, devaient protéger le Volta, la Vipère, le Lynx et l'Aspic contre les canots-torpilleurs chinois. Duguay-Trouin, Villars, D'Estaing devaient réduire les trois bâtiments mouillés auprès d'eux avec leur artillerie d'un bord, battre les jonques de guerre en enfilade avec l'autre bord, plus une batterie de trois krupps voisine de la Pagode et les trois batteries, de krupps également, qui dominaient l'arsenal.
Leurs canots à vapeur armés en guerre pareraient aux attaques des canots-torpilles ennemis.
Aussitôt après que les trois bâtiments seraient hors de combat, le D'Estaing devait se placer à l'ouvert de l'arroyo de la Douane, afin d'y couler un certain nombre de jonques qu'on disait armées pour l'abordage.
Ce plan fut exécuté avec un ensemble parfait. Tous les bâtiments ouvrirent le feu pendant que les torpilleurs attaquaient; les Chinois répondirent immédiatement. Il faisait presque calme; pendant quelques minutes un nuage de fumée enveloppa les combattants, une grêle de projectiles siffla autour d'eux.
À la première éclaircie, nous aperçûmes le Yang-ou qui se jetait à la côte après avoir été crevé par le torpilleur 46, capitaine Douzans, plusieurs jonques de guerre en parties coulées; le Fou-Po atteint par le torpilleur 45, capitaine Latour, mais d'une façon moins désastreuse, continuait de résister; les bâtiments en amont paraissaient avoir déjà de graves avaries.
Le Fey-Yune, le Tsi-Nqan et le Tchen-Oueï, désemparés et incendiés par les obus du Duguay-Trouin, du Villars et du D'Estaing, étaient emportés par le courant, s'échouaient, puis coulaient à quelques milles en aval. Ce fut un peu plus tard le sort des canonnières du type alphabétique.
Après le premier choc, le feu se ralentit sensiblement; nos coups, très bien dirigés, achevaient la destruction de toute la flottille chinoise.
Le Yong-Pao et le I.-Sing, grâce à leur faible tirant d'eau, gagnèrent le haut de la rivière, où nos canonnières ne purent les poursuivre; mais leurs avaries étaient déjà telles que tous deux durent s'échouer d'abord, puis ont coulé.
Il ne reste donc plus que des débris de la flottille chinoise.
Les efforts de nos canonnières se concentrèrent ensuite sur le matériel flottant qui se trouvait devant l'arsenal et sur l'arsenal lui-même, pendant que les autres bâtiments éteignaient le feu des batteries de l'arsenal et de la pagode de l'Île Losing.
La Triomphante, arrivée un peu avant deux heures et mouillée en aval de la pagode; ouvrit le feu sur les objectifs qui étaient à portée de ses canons, et notamment sur ces batteries. C'est de la première que partit un obus dont les éclats tuèrent deux hommes du Volta et blessèrent mon aide de camp M. Ravel ainsi que trois matelots.
Les canots-torpilles chinois, qui paradaient les jours précédents et qui le matin même essayaient de nous menacer, disparurent un peu avant l'action, cherchant un refuge, les uns dans le haut de la rivière, les autres dans l'arroyo de la Douane. M. de Lapeyrère essaya vainement d'atteindre les premiers, puis il dirigea les efforts de ses canots contre le Fou-Po, qui aurait peut-être réussi à s'échapper dans le haut de la rivière, le prit à l'abordage et alla l'échouer en aval du mouillage, où il finit par couler.
Vers la fin de la journée, nos canots en guerre allèrent relancer les canots-torpilles refugiés dans l'arroyo de la Douane et les mirent hors de service; en même temps ils commencèrent la destruction des jonques et sampans qui paraissaient y avoir été préparés comme brûlots.
En prévision des surprises que les Chinois ménageaient la nuit suivante avec ceux de ces brûlots qui restaient encore à leur disposition, je fis prendre le soir aux bâtiments un mouillage d'où ils devaient les apercevoir à distance et pourraient s'en préserver en appareillant momentanément.
Ces précautions étaient commandées d'ailleurs par la certitude de voir remonter au flot et redescendre au jusant les épaves en feu des bâtiments coulés. On devait aussi s'attendre à ce que quelque canot-torpille se remontrât ; c'est ce qui arriva.
La nuit du 23 au 24 fut un qui-vive continuel.
La plupart des bâtiments durent appareiller trois et quatre fois. Cependant le coup d'essai des Chinois n'avait pas été heureux. Vers neuf heures du soir, à la fin du jusant, le Tchen-Hong, mis en feu par nos obus, était poussé vers notre mouillage par deux grandes jonques que montaient une trentaine de matelots ; quelques coups de canon du D'Estaing, mouillé en vedette, coulèrent les jonques et leurs équipages, mais le transport continua à dériver au courant et menaça successivement plusieurs bâtiments.
Le 24, mon premier soin fut de continuer la destruction des jonques ou épaves en ignition, des brûlots préparés soit dans l'arroyo de la Douane, soit en amont de l'arsenal. Deux séries de canots en guerre, commandées l'une par M. Peyronnet, l'autre par M. de Lapeyrère, en furent chargées.
J'appareillai avec le Volta et les trois canonnières pour appuyer le mouvement de la seconde et en même temps pour poursuivre le bombardement de l'arsenal. Pendant l'après-midi, nos obus de 28 kilogrammes démolirent tout ce qui n'était pas au-dessus de leurs forces; le tir, dirigé sur les ateliers et magasins ou sur un croiseur en achèvement, y a produit de grands dégâts, mais point autant que je l'aurais désiré. Avec du 14 centimètres on ne pouvait obtenir davantage.
La fonderie, l'ajustage, l'atelier de dessin ont des avaries considérables, la coque du croiseur est criblée de trous, etc., mais pour détruire l'arsenal, il n'eût pas suffi d'y lancer un grand nombre d'obus du même calibre, il eût fallu du 24 centimètres, tout au moins du 19 centimètres, c'est-à-dire amener à portée la Triomphante ou le Duguay-Trouin.
Les pilotes m'ont déclaré catégoriquement que cela était impossible, même pendant une seule heure avant et une seule heure après la pleine mer. Des sondes, faites par M. Renaud, dans ce but spécial, ont confirmé l'opinion des pilotes.
Je me bornai à faire enlever, le 25 au matin, par les compagnies du Duguay-Trouin et de la Triomphante, la batterie de trois krupps de la Pagode; ses défenseurs l'avaient abandonnée quand nos hommes y arrivèrent ; mais nous vîmes aussitôt descendre des hauteurs grand nombre de soldats ; le feu de nos embarcations en guerre et quelques obus de 14 centimètres les maintinrent au delà de la langue de sable qui relie à mi-marée l'île Losing au continent.
À dix heures du matin, embarcations et compagnies rentraient à bord, rapportant les trois canons.
Il ne restait plus rien à faire à Pagoda, rien du moins que nos moyens nous permissent de tenter. Je quittai le Volta et mis mon pavillon sur le Duguay-Trouin.
Tous les bâtiments appareillèrent après le diner des équipages pour entreprendre la destruction des forts de la Rivière.
À une heure trente, mouillage en amont de l'île Couding.
Le fil du télégraphe qui relie tous les forts entre eux et à l'arsenal est coupé tout d'abord ; il s'agit ensuite de démolir une batterie casematée armée d'un armstrong de 21 cent. 5, qui enfile la passe Mingan.
Les canons du Duguay-Trouin et de la Triomphante sont seuls capables de produire quelque effet; en moins d'une heure, la batterie, prise à revers, est gravement endommagée; les canons de l'île Couding, qui auraient pu nous battre, se taisent; quelques obus de 14 centimètres bien pointés nous convainquent qu'elle est abandonnée.
Les compagnies de débarquement du Villars et du D'Estaing sont mises à terre sous les ordres du commandant Sango, afin de soutenir une escouade de torpilleurs chargés de briser le canon Armstrong avec du fulmi-coton. De forts remous de courant et l'insuffisance de nos canots à vapeur augmentent beaucoup les difficultés du transport de ce personnel. Les Chinois ne songent pas à nous inquiéter. Tout le monde est rentré à bord à la nuit tombante.
Le lendemain 26, attaque des autres batteries de la passe Mingan.
Duguay-Trouin et Triomphante, principalement chargés des cinq batteries casematées, envoyèrent, chemin faisant, quelques bordées très efficaces sur les autres. La batterie Mingan fait un semblant de résistance, les obus du Villars et du D'Estaing achèvent de la désemparer, après quoi une escouade de torpilleurs, soutenue par une compagnie de débarquement, sous les ordres de M. le commandant Le Pontois, va briser les pièces.
L'opération était à peine terminée qu'une fusillade nourrie part des hauteurs voisines où s'élève la maison du Tao-Tai Fan chargé de la défense de la rivière. Nos embarcations ripostent aussitôt ; le Villars et le D'Estaing les appuient avec quelques obus de 14 centimètres et quelques coups de hotschkiss; cela suffit pour dissiper les tirailleurs ennemis.
En même temps, le Volta et les trois canonnières, mouillés près des forts de l'île Couding, soutiennent une autre escouade de torpilleurs et une autre compagnie de débarquement placées sous les ordres de M. le lieutenant de vaisseau Fontaine pour brûler les logements et briser les canons de ce fort.

Elles ne sont pas plus inquiétées que celles de la veille.
De leur côté, le Duguay-Trouin et la Triomphante démolissent toutes les autres batteries, notamment une des batteries casematées de la rive droite, blindée au moyen de 15 feuilles de tôle de 2 centimètres d'épaisseur solidement boulonnées ensemble. Les défenseurs de ces batteries les ont abandonnées et se sont réfugiés dans les montagnes environnantes, d'où nos fusils ou nos hotschkiss délogent ceux qui se montrent.
Avant la fin du jour nos torpilleurs ont brisé les six pièces de casemates de la rive gauche et deux de celles de la rive droite.
La matinée du lendemain est consacrée à Friser le reste. Il faut plusieurs heures, mais nous ne saurions appareiller avant le flot, c'est-à-dire avant une heure du soir.
Vers deux heures et demie, tous les bâtiments ont rallié le Château-Renaud et la Saône en amont de lapasse Kimpaï. Ceux-ci ont fait bonne garde. La surveillance, assez facile le jour, ne laissait pas de présenter la nuit de faire évacuer le camp de Quantao, ensuite multiplier les rondes d'embarcations, employer la lumière électrique presque constamment, etc., mais on a réussi.
Les jonques de pierre sont alignées sur la rive droite; le radeau, disposé pour compléter la fermeture de la passe, est échoué sur la rive gauche.
Le commandant Boulineau a tout préparé pour détruire les jonques; soutenues par la Vipère et l'Aspic, ses embarcations se mettent à l'œuvre; une vive fusillade part du camp retranché de Kimpaï, mais ne les force point à suspendre l'opération; à six heures du soir, toutes les jonques sont coulées ou incendiées.
C'est là que M. le lieutenant de vaisseau Bouët-Villaumez a été tué et, auprès de lui, M. l'enseigne de vaisseau Charlier et quelques hommes de la Vipère blessés.
En même temps, les croiseurs canonnent les camps en vue, et le DuguayTrouin avec la Triomphante s'avancent en aval du banc du milieu pour reconnaître les ouvrages de la passe et commencer l'attaque. À leur approche, deux batteries de 14 centimètres, récemment établies pour enfiler la rivière, ouvrirent le feu. En moins d'une demi-heure, ces batteries ne donnaient plus signe de vie, cependant elles n'étaient point démontées; force fut de remettre cela au lendemain, car il fallait remonter en amont du banc du milieu pour trouver un mouillage de nuit convenable.
N'eût été la sécurité des navires, j'aurais dû m'y résoudre pour celle des équipages; à l'ouvert de la passe, nous étions très près de la rive gauche, dominés par ses collines boisées où, sans courir le moindre risque, des tirailleurs nous auraient causé des pertes très sérieuses. Nous reconnûmes, le lendemain, que ce n'était pas un excès, de précaution.
Le 28, dès quatre heures du matin, le Duguay-Trouin et la Triomphante appareillent; au petit jour ils ouvrent le feu sur les deux batteries déjà attaquées la veille.
Celles-ci répondent d'abord avec une certaine vigueur, mais cela ne dure pas.
C'est par une fusillade que les Chinois veulent surtout nous combattre. Il faut dire que la disposition naturelle du terrain et les travaux qui y sont exécutés les favorisent à merveille dans cet étroit entonnoir. Sur la rive droite, des murs en terre crénelés et des maisons à mi-côte leur servent d'abri; sur la rive gauche, ce sont des broussailles, puis une digue épaisse et enfin le village du Fort-Blanc. Nos canons de 14 centimètres et nos hotschkiss les délogent petit à petit; nous les voyons fuir vers le camp de Kimpaï, établi sur l'autre versant de la montagne; beaucoup tombent en chemin.
Les obus des croiseurs restés en arrière inquiètent les autres jusque dans le camp même; un obus heureux produit l'explosion du magasin à cartouches : cela complète le désarroi.
Sur la rive gauche, le village leur offre d'abord un refuge, d'où l'incendie les chasse bientôt.
Pendant ce temps-là, les gros calibres font de larges brèches dans la batterie casematée, blindée avec des plaques de 45 centimètres, ainsi que dans la batterie casematée du Fort-Blanc, démontent tous les canons en barbette voisins, et notamment un canon Krupp de 21 centimètres qui bat toute la passe du côté du large. J'essaye de compléter cette œuvre de destruction en brisant les pièces au fulmi-coton.
On réussit pour une demi-douzaine de pièces de la rive droite, mais des hauteurs de Kimpaï recommence un feu de tirailleurs, auquel nous ripostons du bord sans parvenir à l'éteindre complètement.
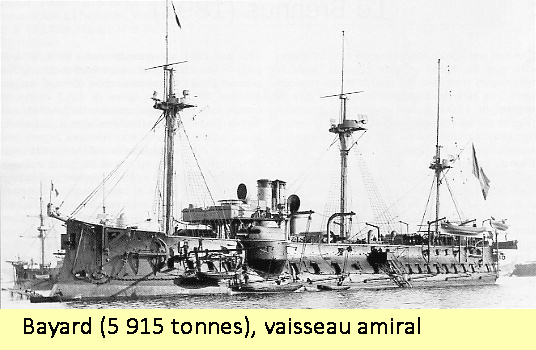
De plus, les points de débarquement sur' la rive gauche sont garnis de torpilles électriques dont nous distinguons les fils; la Triomphante en fait éclater trois à coups de hotschkiss.
Nos compagnies de débarquement auraient certainement éprouvé, de ce côté, des pertes très considérables. Le résultat à obtenir ne compensant pas les sacrifices probables, je me résigne à aller plus loin. Il nous reste à démonter sur la rive gauche les deux batteries n° 5 et n° 6, plus les canons du fort n° 1.
La batterie n° 5 paraît abandonnée; après quelques coups de canon, j'envoie briser ses pièces.
L'opération est troublée par plusieurs boulets tirés à tout hasard de la batterie n° 6 et qui ne sauraient porter; mais, au même instant, une troupe nombreuse descend du fort n° 2 et nous fait éprouver quelques pertes. Le commandant Sango, chef de l'expédition, est blessé, 2 officiers et 8 hommes ne peuvent rallier et trouvent un abri derrière la muraille d'un vapeur échoué à proximité.
Nos obus déblaient promptement la place.
J'envoie l'Aspic et le Lynx mouiller dans l'est et à petite distance de la batterie n° 5, de façon à enfiler le vallon qui conduit au fort n° 2. Sous cette protection, une embarcation armée en guerre dégage sans coup férir et ramène à bord les retardataires de l'expédition. En même temps on achève l'opération interrompue la veille, les trois canons sont brisés.
La batterie n° 6 et celle du fort n° 1 étaient encore intactes; mais je ne m'en préoccupais nullement, certain de les démonter sans difficulté.
Nous nous trouvions le 28 au soir devant un obstacle autrement sérieux, s'il fallait en croire nos renseignements puisés aux meilleures sources. Depuis longtemps, une file de radeaux avait été disposée entre l'île de la passe et l'île Salamis, de façon toutefois à laisser un passage suffisamment large du côté de celle-ci. Les pilotes affirmaient que ces radeaux soutenaient des torpilles électriques. Nous les retrouvâmes dans la même position qu'il y a un mois; le passage libre semblait toujours exister.
Cependant on y apercevait un certain nombre de bouées tout récemment posées; un vapeur allemand, qui apportait des troupes le 25, avait été averti de ne point s'y engager sans un pilote expédié du fort Kimpaï; enfin divers avis me faisaient craindre qu'il y eût là des torpilles.
Il était essentiel de dissiper toute incertitude avant de franchir cette ligne, quelque temps que nous dussions y employer. Du point où se trouvaient le Duguay-Trouin et la Triomphante, j'étais d'ailleurs en communication avec le télégraphe du Pic-Aigu, car les canonnières pouvaient suivre à haute mer le chenal au sud de l'île Salamis; c'est par là que j'envoyai l'Aspic porter de nos nouvelles, et, sur la demande de l'amiral anglais, protéger le bateau du câble contre les attaques des pirates.
Durant la nuit du 28 au 29, nos embarcations draguèrent la passe, qui nous inspirait des doutes, et constatèrent l'état des radeaux. Cette double opération fut très habilement conduite par MM. Campion et Merlin, officiers torpilleurs du Duguay-Trouin et de la Triomphante.
Les radeaux supportaient simplement des chaînes disposées pour former un barrage étendu, que nous n'aurions eu aucune peine à briser; les bouées nouvelles avaient toute l'apparence de corps morts de pêche, les dragages exécutés autour ne révélèrent rien qui pût faire soupçonner la présence de torpilles.
Le 29, dès le commencement du flot, le Duguay-Trouin alla fouiller dans l'est des radeaux, en bonne position pour canonner la batterie n° 6, le fort n° 2 et le fort n° 1; en même temps, les autres bâtiments de l'escadre sortirent de la rivière et la plupart gagnèrent, dans la même marée, le mouillage de Matson. Lorsque tous eurent franchi la passe Kimpaï, la Triomphante appareilla à son tour, et vint se placer à petite distance du Duguay-Trouin.
Deux heures plus tard, il n'y avait plus une seule pièce ennemie capable de servir; les Chinois, plus soucieux sans doute de la sécurité de leurs troupes, avaient à peine essayé de riposter.
Sur ces entrefaites arriva le La Galissonnière, qui, retenu à Keelung par un coup de vent violent, n'avait pu rallier mon pavillon à temps.
Le 25, aussitôt qu'il put avoir un pilote, l'amiral Lespès vint prendre le mouillage de Woga, d'où il espérait battre les ouvrages de la passe Kimpaï; mais, réduit, grâce à l'étroitesse du chenal et à la violence du courant, à n'employer que le canon de tourelle tribord pendant que plusieurs des batteries de la passe le menaçaient, il jugea nécessaire, après quelques coups de canon, de prendre une position moins défavorable.
Le La Galissonnière changeait de mouillage, quand un obus de 21 centimètres, lancé par le canon barbette du Fort-Blanc, l'atteignit à tribord devant, fit un trou dans la muraille en tôle, tua un homme et en blessa plusieurs autres.
Le 30, Duguay-Trouin, La Galissonnière et Triomphante mouillaient à Matsou vers la fin de l'après-midi. L'Aspic seul restait au Pic-Aigu pour garder le câble jusqu'à ce qu'une canonnière anglaise, appelée de Hong-Kong dans ce but, fût venue le remplacer.
Nous avons éprouvé des pertes cruelles : 10 tués, dont un officier; 48 blessés, dont 6 officiers.
Quant aux Chinois, impossible de songer à une évaluation un peu précise. Le chiffre fantastique inspiré par la terreur des premiers jours a fait place au chiffre très admissible de 2 à 5 000 tués ou blessés.
Les bâtiments de l'escadre sont en train de pourvoir avec leurs moyens à diverses réparations, ainsi qu'aux visites des machines, en même temps qu'ils complètent leur combustible.
La Nive les a approvisionnés de vivres jusqu'au 15 novembre.
Tel est, monsieur le Ministre, le résumé sommaire des faits accomplis pendant cette rude semaine.
Je suis heureux de vous dire que jamais états-majors et équipages ne seront mieux à la hauteur d'une semblable situation. Durant le mois précédent, j'avais eu la satisfaction de constater avec quelle énergie les uns et les autres supportaient les fatigues d'un qui-vive permanent en branle-bas de combat, les feux allumés ; la perspective d'une action prochaine était dans l'air, chacun l'attendait avec une secrète impatience, mais aussi avec une pleine confiance dans le succès.
La brillante journée du 25 a justifié toutes nos prévisions. Bien que les opérations des jours suivants fussent d'un genre moins entraînant, l'ardeur générale ne s'est calmée que le jour où le dernier canon chinois a été démonté.
Je suis vraiment fier de commander à des officiers, à des équipages que l'amour de la patrie anime à un si haut degré.
La France peut tout attendre de leur bravoure et de leur dévouement.
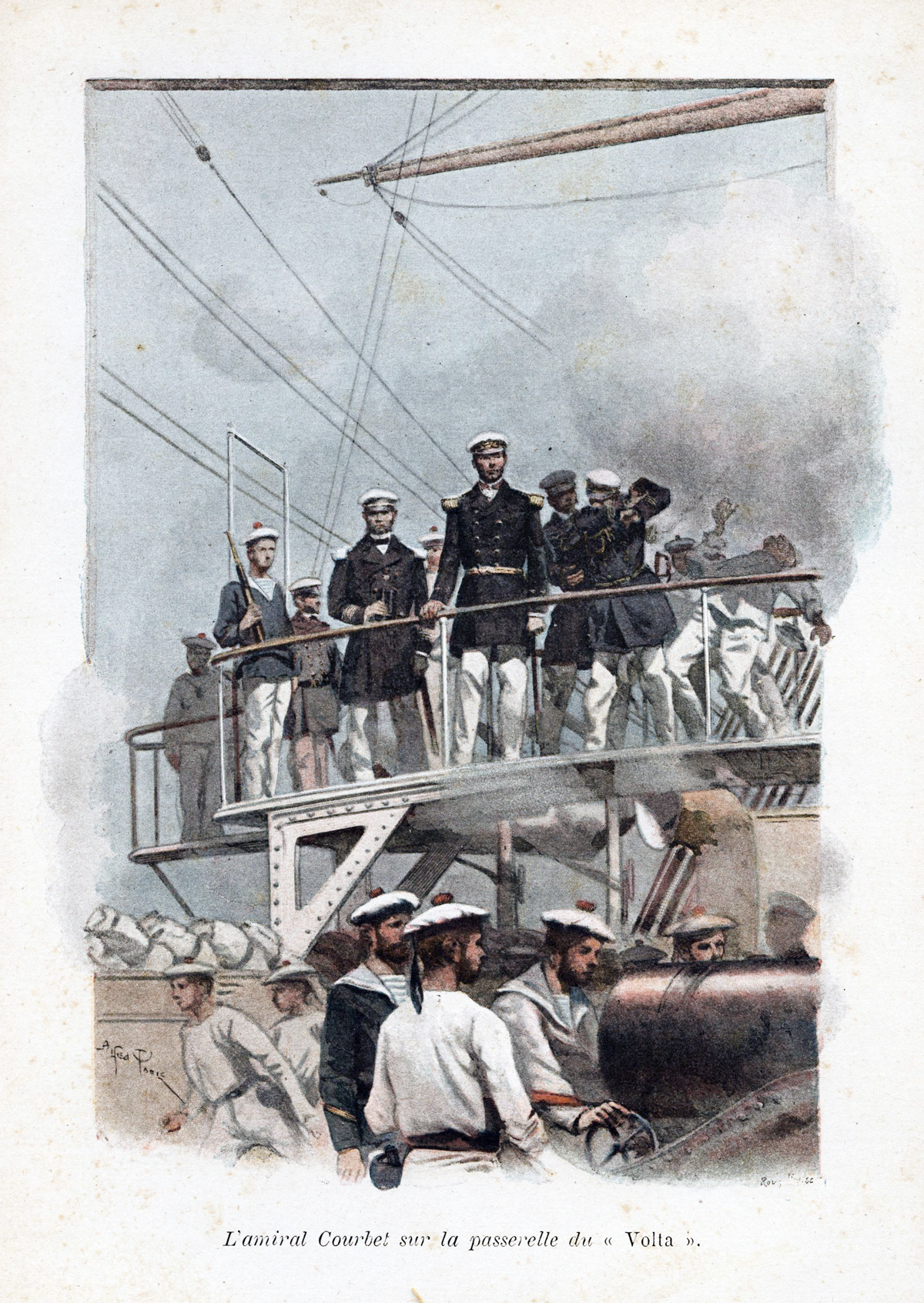

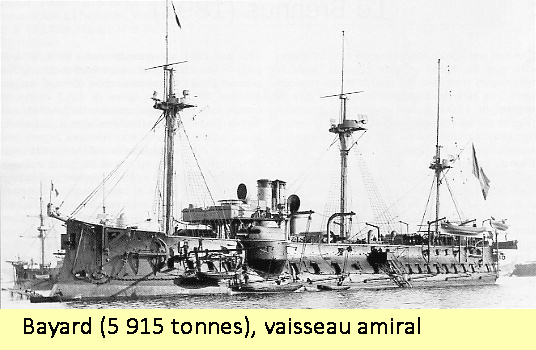
Vice-amiral COURBET.
https://www.lajauneetlarouge.com/un-x-amiral-au-musee-amedee-courbet-1847-1827-1885/

La mort de l'amiral Courbet
À bord de la Triomphante, rade de Ma-Kung, vendredi 12 juin 1885.
... Ce que j'en ai vu, moi, de cette mort, est bien peu de chose; l'écrire, c'est presque rabaisser ce malheur en mettant autour des détails trop petits.
C'était hier, à sept heures du soir, — pendant que nous étions à table dînant assez gaiement — on entendit un canot accoster le bord, et les timoniers dirent qu'il venait du Bayard avec une lettre pour le commandant. Alors il y eut une minute de curiosité impatiente, car ce devait être une communication grave : la paix signée?... ou bien la guerre reprise?...
Non, rien de tout cela, mais une chose sombre et imprévue : l'amiral était mourant, peut-être mort à cette heure même. Ce canot faisait le tour des bâtiments de l'escadre pour le dire.
Cela se répandit comme une traînée de poudre jusqu'au gaillard d'avant, où les matelots chantaient. Justement ils étaient en train de répéter une grande représentation théâtrale pour dimanche prochain, avec de la musique et des chœurs ; tout cela se tut et les chanteurs se dispersèrent ; une espèce de silence lourd, que personne n'avait commandé, se fit tout seul, partout....
Les gens qui sont en France ne peuvent guère comprendre ces choses — ni la consternation jetée par cette nouvelle, ni le prestige qu'il avait, cet amiral; sur son escadre. — Dans les journaux, on lira des éloges de lui plus ou moins bien faits: on lui élèvera quelque part une statue; on en parlera huit jours dans notre France oublieuse ; — mais assurément on ne comprendra jamais tout ce que nous perdons en lui, nous, les marins. — Je crois d'ailleurs que, pour sa mémoire, rien ne sera si glorieux que ce silence spontané et cet abattement de ses équipages.
Non, on n'avait pas prévu qu'il pourrait finir de cette manière....
Le canot repartit, de bateau en bateau, annonçant le désastre. Le commandant fit armer sa baleinière pour aller vite à bord du Bayard; puis nous attendîmes, au carré, en parlant bas.
A huit heures, je montai prendre le quart : une nuit épaisse; les tauds faits, à cause de la pluie fine qui tombait depuis le coucher du soleil ; une chaleur humide, orageuse, accablante.
Les fanaux étant parés pour recevoir le commandant à son retour, j'appelai le maître de quart, qui était précisément Yves (nos destinées nous ont réunis une fois de plus sur un même bateau), et nous commençâmes à faire ensemble les cent pas monotones des nuits de veille. Au-dehors on voyait, dans la brume noire, les feux de cette escadre jouant les lumières d'une grande ville, — ville nomade qui est venue se reposer depuis deux mois sur ce point de la mer chinoise. La pluie continuait de tomber lentement, sans un souffle dans l'air; cela ressemblait aux nuits tristes de Bretagne, à part cette chaleur toujours, cette chaleur irrespirable, malsaine, qui pesait sur nous comme du plomb. — Et c'est pendant cette soirée tranquille, au milieu de tout ce calme, que ce chef de guerre était aux prises, dans une toute petite chambre de bord, avec la mort silencieuse et obscure....
Pendant qu'il s'en allait, nous causions de lui.
Sa gloire, elle a tellement couru le monde tellement, que c'est banal à présent d'en parler entre nous. Elle lui survivra bien un peu, j'espère, car elle est universellement connue.
Mais ceux qui ne l'ont pas vu de près ne peuvent pas savoir combien il était un homme de cœur. — Ces existences de matelots et de soldats qui, vraiment, depuis deux années, semblaient ne plus assez coûter à la France lointaine, il les jugeait très précieuses, lui qui était un vrai et grand chef; il se montrait très avare de ce sang français. Ses batailles étaient combinées, travaillées d'avance avec une si rare précision que le résultat, souvent foudroyant, s'obtenait toujours en perdant très peu, très peu des nôtres; et ensuite, après l'action qu'il avait durement menée avec son absolutisme sans réplique, il redevenait tout de suite un autre homme très doux, s'en allant faire la tournée des ambulances avec un bon sourire triste; il voulait voir tous les blessés, même les plus humbles, leur serrer la main; — et eux mouraient plus contents, tout réconfortés par sa visite....
La baleinière du commandant ne revenait pas, et, en regardant les feux de ce Bayard à travers la nuit et la pluie fine, nous parlions toujours de l'amiral.
Il y a cinq ou six jours à peine, il était encore ici, à notre bord, venu pour un lancement de torpilles; et je me souviens d'avoir, pour la dernière fois, serré sa main, tendue avec une bienveillance toute simple et exquise. Ce jour-là, nous avions été heureux de le trouver si alerte, si vaillant, si bien remis de ses fatigues passées. En plein midi, en plein soleil, il était monté sur un petit bateau-torpilleur pour circuler sur cette rade unie et réfléchissante, chauffée à blanc. — Nous filions d'ailleurs si vite, fendant cet air immobile, éventé par notre propre course, qu'on respirait à l'aise, on était presque bien. Et je le vois encore là, assis à deux pas de moi, dessinant son buste haut sur tout ce bleu lumineux; correct dans sa tenue toujours, la redingote boutonnée jusqu'au col, absolument comme en France et les mains gantées de suède, suivant des yeux ces espèces de longs poissons d'acier qu'il faisait lancer devant lui....
Je le subissais, moi aussi, le prestige de cet amiral, d'une manière plus raisonnée que nos matelots peut-être, mais complète; et, comme tant d'autres ignorés, je l'aurais suivi n'importe où avec un dévouement absolu.
Je m'inclinais devant cette grande figure du devoir, incompréhensible à notre époque de personnages fort petits. — Il était à mes yeux une sorte d'incarnation de tous ces vieux mots sublimes d'honneur, d'héroïsme, d'abnégation, de patrie. — Mais l'écrivain qui se sentira de taille à faire son éloge funèbre devra bien s'efforcer de les rajeunir ces grands mots d'autrefois, car on les a aujourd'hui tellement banalisés, à propos de gens quelconques n'ayant risqué leur vie nulle part, qu'ils semblent n'avoir plus un sens assez élevé quand il s'agit de lui....
Et puis il avait son secret, cet amiral, pour être en même temps si sévère et si aimé. Comment faisait-il donc, car enfin il était un chef dur, inflexible pour les autres autant que pour lui-même, ne laissant jamais voir sa sensibilité exquise ni ses larmes qu'à ceux qui allaient mourir.
N'admettant jamais la discussion de ses ordres, tout en restant parfaitement courtois, il avait sa manière à lui, impérieuse et brève, de les donner : « Vous m'avez compris, mon ami?.. Allez ! » Avec cela, un salut, une poignée de main, — et on allait, on allait n'importe où, même à la tête d'un petit nombre d'hommes; on allait avec confiance, parce que le plan était de lui; ensuite, on revenait ayant réussi, même quand la chose avait été terriblement difficile et périlleuse.
Ces milliers d'hommes qui se battaient ici avaient remis chacun sa propre existence entre les mains de ce chef, trouvant tout naturel qu'il en disposât quand il en avait besoin. Il était exigeant comme personne; cependant contre lui on ne murmurait jamais, jamais; — ni ses matelots ni ses soldats; — ni même toute cette troupe étrange de « zéphyrs », d'Arabes, d'Annamites, qu'il commandait aussi.
Oh ! cette île de Formose!... Qui osera raconter les choses épiques qu'on y a faites, écrire le long martyrologe de ceux qui y sont morts? — Cela se passait au milieu de tous les genres de souffrances : des tempêtes, des froids, des chaleurs; des misères, des dysenteries, des fièvres.
Cependant ils ne murmuraient pas, ces hommes; quelquefois ils n'avaient pas mangé, pas dormi; après quelque terrible corvée sous les balles chinoises, ils rentraient épuisés, leurs pauvres vêtements trempés par l'éternelle pluie de Kelung; — et lui, brusquement, parce qu'il le fallait, leur donnait l'ordre de repartir. Eh bien, ils se raidissaient pour lui obéir et marcher; ensuite ils tombaient — et pour une cause stérile, — tandis que la France, occupée de ses toutes petites querelles d'élections , et de ménage, tournait à peine des yeux distraits pour les regarder mourir.
À part les familles de marins, qui donc, dans notre pays, empêchait-elle de dormir ou de s'amuser, cette pauvre glorieuse escadre de Formose?...
Dans les heures d'anxiété (et elles revenaient souvent), au milieu des engagements qui semblaient douteux, dès qu'on le voyait paraître, lui, l'amiral, ou seulement son pavillon, dans le lointain, on disait : « Ah ! le voilà, c'est tout ce qu'il faut alors; ça finira bien puisqu'il arrive ! » En effet, cela finissait bien toujours ; cela finissait de la manière précise que lui tout seul, très caché dans ses projets, avait arrangée et prévue.
Je ne crois pas que, chez nos ennemis d'Europe, il y ait un chef d'escadre qui lui soit égal, ou seulement comparable. Peut-être aurait-il fallu le garder précieusement pour quelque grande lutte nationale, au lieu de le laisser ici s'user et mourir....
... Un bruit d'avirons dehors; un canot qui s'approche. Les factionnaires le hèlent.
« À bord, commandant! »
Aussitôt un groupe se forme près de la coupée, bien que ce ne soit pas très correct : des officiers, des matelots, anxieux de savoir, d'écouter au passage et les premiers mots que le commandant va dire.
Il dit que l'amiral respire encore faiblement, mais qu'il est bien perdu; les yeux fermés déjà, ne parlant plus depuis six heures du soir, les mains croisées sur la poitrine et déjà froides; très tranquille, et probablement ne souffrant pas.
De quoi meurt-il? — on ne sait pas bien. — D'épuisement surtout et d'un excès de fatigue intellectuelle. D'abord, le bruit avait couru qu'il était pris de cette contagion innomée dont on ose à peine parler, et qui chaque jour nous enlève brusquement quelques-uns des nôtres. On dit que non, maintenant ; ce n'est plus cela. Les deux maladies lentes de ce pays jaune : dysenterie et hépatite, qu'il traînait depuis de longs mois, l'ont, paraît-il, vaincu tout d'un coup. Et puis il meurt d'autre chose encore : de travail excessif, d'écœurement aussi et de déceptions de toute sorte en présence du résultat nul que ses belles victoires ont obtenu pour la France.
Les secours humains ne peuvent plus rien pour lui; pas même réchauffer ses membres, qui s'immobilisent de plus en plus et sont couverts d'une sueur glacée, malgré la chaleur de cette nuit d'orage.... Un canot du Bayard doit venir bientôt nous avertir quand ce sera fini tout à fait.
Ensuite, nous reparlions de l'amiral, dont l'agonie était une chose présente, obsédant notre pensée :
« Aussi, disait Yves, il n'avait jamais soin de lui-même; tous les soirs, tous les soirs ! descendre à terre, entrer à l'ambulance, risquer d'y prendre la maladie... »
En effet, jusqu'à ces derniers jours, ses visites aux malades s'étaient continuées fidèlement. La semaine passée, il avait même quitté son bord à la hâte pour aller, sous une pluie d'orage, jusqu'au campement de l'infanterie de marine, embrasser un pauvre lieutenant jadis blessé près de lui, à Son-Tay, qui venait d'être atteint de cette même maladie innomée et qui en mourut dans la nuit.
Et, lundi encore, on l'avait vu, le matin, au soleil de neuf heures, suivre, découvert, l'enterrement d'un autre officier, mort aussi de cette contagion-là. Tête nue, tenant son casque à la main; boutonné, correct sans cesse et partout, il avait traversé ces ruelles désertes de Ma-Kung et accompagné le petit cortège funèbre jusqu'à ces champs de riz et de maïs où s'est improvisé notre cimetière.
Depuis deux mois, ce triste Ma-Kung en a bien vu passer de ces enterrements français dans ses rues. Au début surtout, quand les ruines étaient encore toutes fraîches, les bouddhas par terre sur les places, les maisons éventrées de la veille, sentant encore le brûlé et le Chinois mort, à la grande pagode où est notre ambulance, la maladie était venue s'installer; et l'on en voyait tous les jours sortir de ces petits cortèges d'une vingtaine d'hommes, l'arme basse, piétinant les décombres, les cassons de porcelaine, les lambeaux de soie, les débris de lanternes et de parasols. — Dans le cercueil, fait à la hâte en vieilles boiseries dorées, quelque pauvre soldat obscur s'en allait, sans prêtre ni prière, dormir au milieu des champs de maïs où nous avons déjà planté beaucoup de petites croix noires.
En les regardant passer, nous les plaignions, ceux-là, de n'avoir trouvé que cette mort pitoyable; — et voici maintenant que notre amiral, malgré toute sa gloire, va finir à peu près comme eux....
Des matelots de quart, qui n'avaient pas pu reprendre leur sommeil insouciant à plat pont, se promenaient par groupes, et on les entendait aussi qui parlaient de lui : « Enfin, on n'a pas encore dit qu'il était décédé (un mot qu'ils emploient d'habitude, le croyant plus respectueux que celui de mort), et, tant qu'un homme n'est pas défunt, n'est-ce pas?... » Ils ne voulaient pas y croire; cela n'entrait pas dans leur tête, à eux non plus, que l'amiral dût ainsi disparaître.
Vers onze heures, le maître d'équipage s'approcha pour faire les cent pas avec nous; cette nuit-là, les distances habituelles paraissaient s'être effacées devant l'attente commune de ce deuil, et tout le monde causait ensemble, indistinctement. Lui, ce brave maître, éprouvait le besoin de se remémorer et de redire la grande gloire de Fou-chéou ; après les détails mille fois racontés, il trouvait, pour l'effrayante hécatombe finale, cette image : « ... Et alors on a vu la mer se couvrir tout d'un coup d'un millier de choses qui flottaient dessus — comme si on aurait vidé sur l'eau un sac de plumes;
— SEULEMENT C'ÉTAIENT DES CADAVRES....
Quand notre quart fut fini, aucune communication nouvelle n'étant venue du Bayard, on avait presque repris espoir en voyant que c'était si long.
Mais, quelques minutes après minuit, étant déjà redescendu dans ma chambre, j'entendis le bruit d'un canot à vapeur qui s'approchait de nous et je compris ce qu'il venait nous dire.
Je me penchai à mon sabord pour écouter l'accostage. Une voix, celle du matelot de faction, demanda tout de suite : « Eh bien? » Du canot une voix répondit : « Il est décédé.... » Je m'endormis sur ces mots, et, en rêve, je revis l'amiral, mêlé à des combats et à des funérailles étranges.
On nous raconta le lendemain de quelle manière silencieuse et presque douce la mort était venue le prendre, comme un sommeil. Depuis six heures du soir, il n'avait eu ni un mouvement ni une plainte. Tous les moyens ayant été épuisés pour ramener un peu de chaleur à ses membres, qui se refroidissaient, on avait fini par le laisser en repos. Les officiers du Bayard étaient là groupés, presque aussi immobiles que lui dans leur stupeur; deux matelots agitaient des éventails au-dessus de sa tête.
Un peu avant dix heures, ne l'entendant plus respirer, on avait placé devant sa bouche son lorgnon, qui était resté suspendu à son cou; ensuite, un miroir : aucune buée sur le verre, plus trace d'aucun souffle; alors le médecin en chef avait dit à voix basse : « Messieurs, l'amiral est mort ». Dans ce premier moment, personne n'avait bougé ni pleuré ; des minutes de silence s'étaient encore écoulées avant qu'on entendît un sanglot sortir d'une poitrine.
Samedi 13 juin, la mise en chapelle et les honneurs militaires.
D'abord on avait eu l'idée de porter le corps de l'amiral à Ma-Kung, dans une des grandes pagodes, afin qu'il y eût plus d'espace pour les troupes; — on a réfléchi qu'il était mieux de ne pas le laisser reposer, même pour quelques heures, sur une terre chinoise, ni surtout dans un temple bouddhique; — et on l'a laissé sur son vaisseau, qui est une terre française.
A Ma-Kung, un peu avant sept heures du matin, tout ce qui reste de notre petite troupe d'occupation est rangé au pied des forts, face à la mer, les armes prêtes pour les salves de mousqueterie. Comme hier, par un temps gris et lourd, des canots et des baleinières amènent à bord du Bayard les officiers de l'escadre, qui sont cette fois en épaulettes et en armes. Arrivent aussi des officiers d'artillerie, d'infanterie, des détachements de matelots de tous les bâtiments sur rade, et des soldats de tous les corps campés à Ma-Kung.
Une foule compacte sur le pont du Bayard, mais toujours du silence. Le cercueil de l'amiral est là par terre, attendant sous un drap noir, à l'entrée de cette chapelle, où un prêtre va tout à l'heure l'introduire.
On se serre les uns contre les autres, dans ces coursives étroites, sous cette oppressante carapace en fer. Par ce temps sombre et accablant, tout ce qu'on touche, boiserie ou ferrure, est chaud, humide, avec des gouttelettes, comme si la sueur perlait même sur les choses, et dans cette buée d'étuve, déjà irrespirable, on sent l'odeur sinistre des substances qui servent pour les morts.
La chapelle est de la simplicité la plus extrême : deux pavillons d'amiral (tricolores à trois étoiles blanches) formant sous la dunette une sorte de tente; deux rangées de marins armés, deux rangées de flambeaux, et c'est tout. On a même voilé avec de l'étamine cette devise de Bayard, inscrite à l'arrière du vaisseau au milieu de dorures, et qui aurait aussi bien pu être la sienne : « Sans reproche, sans peur » .
Un des monstres en ébène (dépouilles de pagode) qui décorent le couronnement de cette dunette se trouve par hasard juste au-dessus du cercueil, en haut du sanctuaire improvisé, assis comme un gros chien noir. Il a l'air de rire en se moquant, avec cette intensité d'expression méchante qui est le mystère inimitable de l'art chinois. On aurait peut-être dû songer à le voiler, lui plutôt, bien qu'il représente d'une manière symbolique assez saisissante la Chine à ces funérailles.
La cérémonie religieuse est courte et se fait à voix basse. De minute en minute, on entend, plus ou moins dans le lointain, des salves de mousqueterie venues de l'escadre ou des forts de Ma-Kung; elles partent de différents côtés, avec un bruit sec de chose qui se déchire.
Pantene:
Apiquer les vergues en pantenne c'est quand elles sont apiquées à contre les unes des autres
c'est-à-dire celles d'un mât d'un bord et celles d'un mât voisin de l'autre bord : on dit dans ce cas que les vergues sont en pantenne.
Apiquer les vergues en pantenne est aussi un signe de deuil.
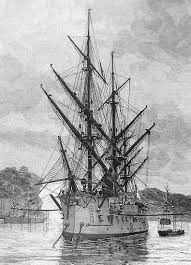 Dans les intervalles de silence, il y a un tout petit oiseau qui chante obstinément, accroché à une drisse de pavillon. Les timoniers s'excusent de sa présence : il est là depuis hier, et on a beau le chasser, secouer cette drisse, il revient toujours.
Dans les intervalles de silence, il y a un tout petit oiseau qui chante obstinément, accroché à une drisse de pavillon. Les timoniers s'excusent de sa présence : il est là depuis hier, et on a beau le chasser, secouer cette drisse, il revient toujours.
Tout près des assistants, les canons du Bayard commencent à grands coups sourds le salut final, et ensuite l'amiral Lespès, qui a pris hier le commandement de l'escadre, vient dire, en quelques mots, adieu à notre chef mort.
Il le fait avec un tel tremblement de douleur et un si visible besoin de pleurer, qu'en l'entendant, les larmes viennent. Ceux qui se raidissaient à grand effort pour garder une figure impassible s'amollissent et pleurent...
Et maintenant, après cet adieu, il n'y a plus que le défilé militaire, et c'est absolument terminé; on se retire, on se disperse dans les canots; les vergues sont- redressées et les pavillons rehissés partout. Les choses rentrent dans l'ordre, reprennent leur physionomie habituelle; le soleil aussi se met à reparaître. C'est la fin du deuil, presque le commencement de l'oubli....
Je n'avais encore jamais vu des matelots pleurer sous les armes, — et ils pleuraient silencieusement, tous ceux du piquet d'honneur.
Elle était bien modeste, cette petite chapelle; bien modeste aussi, ce petit drap noir; et, quand le corps de cet amiral reviendra en France, on déploiera, c'est certain, une pompe infiniment plus brillante qu'ici, dans cette baie d'exil.
Mais qu'est-ce qu'on pourra lui faire, qu'est-ce qu'on pourra inventer pour lui qui soit plus beau et plus rare que ces larmes?...
Pantene:
Apiquer les vergues en pantenne c'est quand elles sont apiquées à contre les unes des autres
c'est-à-dire celles d'un mât d'un bord et celles d'un mât voisin de l'autre bord : on dit dans ce cas que les vergues sont en pantenne.
Apiquer les vergues en pantenne est aussi un signe de deuil.
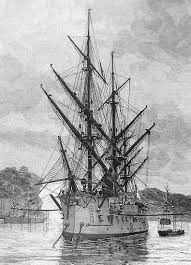
(Pierre Loti, Propos d'exil.)
(Calmann-Lévy, éditeur.)
(20 DÉCEMBRE 1886)
Le paquebot transatlantique la France allait de Saint-Nazaire à Colon, lorsque, l'incendie se déclara à bord.
MA bonne et spacieuse cabine se trouvait à l'arrière, presque au-dessus de l'hélice, et recevait la lumière par en haut. Étendu sur mon canapé, j'étais occupé à lire, lorsque, soudainement, de la fumée et des étincelles pénétrèrent par la claire-voie. À ce moment, mon valet de chambre se présenta criant : « Au feu! » Si la porte avait été fermée à clef, je n'aurais pas eu le temps de me sauver.
Je me précipitai dans le couloir : il était rempli de fumée, et, les premières flammes dans le dos, nous parvînmes avec peine à gagner la grande salle et, par le grand escalier, le pont. En y arrivant, j'aperçus des flammes qui sortaient déjà de la claire-voie de ma chambre. Les autres passagers me suivirent de près. Tout le monde semblait affolé. On courait dans tous les sens ; on s'entrechoquait, on revint sur ses pas ; on s'arma d'appareils de sauvetage ; on se réfugia dans les canots encore suspendus à leurs portemanteaux, mais tournés en dehors et prêts à être amenés.
Pauvre ressource, quand on pense que nous nous trouvions à près de neuf cents milles de terre, dans une mer solitaire où l'on voit rarement un navire en dehors de la route suivie par les paquebots et par les bâtiments à voiles qui remontent, du sud au nord, le long des côtes de l'Amérique; à quoi il faut ajouter que les quatre chaloupes qui n'étaient pas brûlées auraient pu à peine contenir le tiers des hommes (400, y compris l'équipage et les passagers) que la France portait dans ses flancs.
Il fallait l'intervention énergique des officiers pour faire, comprendre à ces fuyards que leur poids ferait casser les garants des palans de suspension, et qu'ils seraient précipités dans la mer. Ce qui ajoutait à l'horreur de la scène sinistre de ces premiers moments, c'était le silence absolu qui régnait dans cette foule si agitée.
Cette panique, au reste, ne dura pas.
L'incendie s'était déclaré sur l'arrière. Notre direction était sud-ouest. Le vent, ayant fraîchi considérablement et soufflant du nord-nord-est, non seulement neutralisait la brise du bateau, mais produisait un courant d'air très fort du nord-est au sud-ouest, c'est-à-dire de l'arrière à l'avant. Il fallait donc venir debout au vent en mettant le cap au nord-est.
Malgré la violence de l'incendie, cette manœuvre, si difficile dans les circonstances données fut, sous la direction du commandant, qui occupait sa place sur la passerelle, exécutée en quelques minutes. En même temps furent fermés les panneaux de la soute à poudre et les portes des cloisons étanches en tôle qui divisent le bâtiment en diverses parties.
Le mécanicien en chef, M. Chenu, dirigea, dès l'abord, des jets de vapeur vers le centre de l'incendie, où se trouvait la poudre, et, au dire du commandant, c'est à lui que nous devons en grande partie notre salut.
Pour faire jouer les pompes du pont, il fallait le dégager en jetant par-dessus bord les caisses qui l'encombraient, opération délicate, mais qui réussissait parfaitement.
Du moment où elle était achevée, le roulis, jusque-là assez fort, cessa complètement et fut remplacé par un léger tangage.
Cependant les voyageurs étaient revenus de leur première frayeur; des chaînes furent organisées, et beaucoup d'hommes de bonne volonté, renforcés par les récalcitrants que des gendarmes passagers empoignaient et menaient de force au travail, en un mot tout le monde se joignit aux braves soldats de l'infanterie de marine, à l'équipage et au personnel de service.
Tous, jusqu'aux petits marmitons, qui, habitués au feu, se précipitaient en avant pour verser dans les flammes leurs casseroles remplies d'eau, rivalisaient d'élan, de bravoure et de cette gaieté gauloise dans le péril qui forment un des beaux traits du caractère national. Il y eut parmi ces vaillants combattants trois Allemands : un ingénieur, un industriel et un négociant de Hambourg, tous des gens instruits et bien élevés.
Ils me parlaient avec admiration des actes héroïques qui s'étaient accomplis sous leurs yeux dans les couloirs étroits, de plus en plus envahis par l'incendie, sur le bord de la grande fournaise, dans le terrible voisinage de la poudre entourée de flammes.
Obéissant aux ordres des officiers qui combattaient à la tête de cette petite troupe dévouée, on s'élançait à travers des nuages épais de fumée, on passait près des objets embrasés avec l'insouciance du soldat qui défile à la parade.
Ce que je dis n'est pas une phrase, mais la vérité, que je puis affirmer de visu.
Mais tous ces efforts, qu'on pourrait dire surhumains, semblaient impuissants à empêcher la catastrophe. Le grand salon, l'escalier principal, la cabine des dames, située en deçà de la cloison étanche, offraient le spectacle d'un chaos de flammes. L'arrière-pont s'était enfoncé en entraînant le spardeck et le fumoir.
Le feu s'était déclaré quelques minutes après trois heures de l'après-midi, et, à trois heures et demie, plus d'un tiers du bâtiment était incendié.
À quatre heures et demie, tenant les yeux fixés sur l'arrière, je vis un éclair, suivi d'une secousse et d'une forte détonation. C'était la provision de poudre du bâtiment qui venait de faire explosion.
À cinq heures, le mât d'artimon, ainsi qu'il a été dit, s'abattit à tribord.
Pour ne pas compromettre l'hélice, le commandant se vit obligé de stopper la machine, qui, heureusement, n'avait pas été atteinte par l'incendie. Les chaînes de la barre s'étant tordues par la chaleur et en partie brisées, le bâtiment ne gouvernait plus. La direction dans laquelle s'enfuyait la fumée causée par l'explosion dont je viens de parler prouvait que le bâtiment, privé du secours du gouvernail, commençait à tomber en travers.
Si ce mouvement se maintient, dans peu de minutes nous aurons le vent à l'arrière, l'incendie gagnera le centre et l'avant, et tout sera dit.
Cependant le feu avait déjà réclamé ses victimes : le missionnaire Tavernier, qui, pendant la traversée, s'était par le fort roulis cassé une jambe, ne pouvant s'enfuir, devint dans sa cabine la proie des flammes. Pendant quelques minutes on entendit ses cris déchirants.
Un curé de la Guadeloupe, qui essaya de le sauver, eut des brûlures assez graves pour compromettre sa vie. J'ai eu la satisfaction de le rencontrer six semaines après, presque entièrement rétabli.
Un sommelier et un garçon du bord furent brûlés dans la sommellerie. Parmi les hommes occupés aux travaux de sauvetage, les blessures étaient nombreuses, mais légères.
Pendant que ces scènes se passaient sur le champ de bataille, qui était, on le sait, l'arrière du bateau, les non-combattants — des femmes, des enfants, quelques vigoureux jeunes gens de différentes nationalités, qui tâchaient de se soustraire aux regards scrutateurs d'un gendarme toutes les fois que cet hercule breton, aux yeux bleu clair, à la chevelure rousse, à la mine rébarbative, venait recruter des travailleurs, — les non-combattants, divisés en groupes, remplissaient le gaillard d'avant. Dans les canots, en grande partie évacués après la première panique, on aperçut un jeune couple pétrifié par la peur.
J'ai dit que le bâtiment, allégé du poids qui pesait sur son pont, avait cessé de rouler et que ce mouvement était remplacé par un léger tangage. Il s'ensuivit que le peu de personnes qui ne détournaient pas les yeux pouvaient, à des intervalles réguliers, embrasser du regard 'l'ensemble de l'incendie. Spectacle grandiose, magnifique, terrible!
Au-dessus de nous, un ciel bleu d'azur; au-dessous, la danse macabre des vagues qui, jetant au vent leurs longues crinières d'or, semblent impatientes de nous engloutir.
En face, les deux cheminées de la machine et le grand mât, intacts encore et comme indifférents à ce qui se passe près d'eux. Sur la passerelle, la silhouette du capitaine.
Il se promène lentement et donne, de temps à autre, quelques ordres, par un signe de la main.
Derrière lui, comme fond du tableau, le cratère ouvert vomissant des flammes qui, réunies en une seule colonne verticale rouge, s'élèvent à la hauteur prodigieuse de 40 mètres (= La hauteur de la colonne de la place Vendôme sans la statue)
. Au-dessus, un gros nuage de fumée affecte les formes d'un baldaquin, que le soleil, déjà déclinant, revêt de teintes bronzées.
À cinq heures, le commandant, comme je l'appris plus tard, avait renoncé à tout espoir. Le feu gagnait du terrain, les forces des travailleurs s'épuisaient à vue d'œil, le bâtiment, devenu ingouvernable, dérivait lentement, les soixante caisses de poudre étaient toujours entourées de flammes, et il était impossible de se rendre compte de l'état de la soute.
Le moment suprême semblait proche.
Les journaux ont parlé d'efforts faits pour rassurer les passagers en leur cachant l'étendue et l'imminence du danger. En effet, de temps à autre, arrivaient des gens disant que la poudre était complètement noyée, que tout allait à merveille, que tantôt on aurait maîtrisé le feu qui, cependant, sous nos yeux, semblait au contraire trouver à chaque instant de nouveaux aliments.
Ces pieux mensonges furent accueillis par des signes d'incrédulité ou d'impatience.
Après l'explosion de la poudre du bord, un homme vint nous raconter que c'étaient des signaux de détresse faits par ordre du capitaine ! « Pour avertir qui ? » demanda-t-on. Quelqu'un répondit : « Les requins ». Tout le monde, y compris le capitaine Collier, avait cru qu'une des soixante caisses avait 'sauté et que les autres suivraient immédiatement. Il y avait de quoi transformer en atomes le paquebot et ceux qu'il contenait.
La vérité est que personne de nous ne se faisait plus d'illusion.
Je ne parle pas des braves qui luttaient avec le feu et, semblables à des troupes montant à l'assaut, n'avaient heureusement pas le temps de réfléchir sur les périls qui les entouraient; mais, sur le gaillard d'avant, tout le monde était persuadé que l'heure de la mort était venue.
Ne pouvant me mêler aux combattants, je tâchais de me rendre utile en passant de groupe en groupe afin de maintenir le moral des pauvres femmes qui, entourées de leurs enfants ou les tenant dans leurs bras, se montraient assez courageuses.
Les unes, et c'était la majorité, les yeux levés vers le ciel, priaient avec ferveur ; d'autres se renfermaient dans le silence morne du désespoir. Un sourire, un mot encourageant, agissaient cependant momentanément comme du baume. Je ne passerai pas sous silence deux d'entre elles qui me frappaient, l'une par l'expression d'un courage physique indomptable, — c'était une grosse et robuste femme du peuple, native de Turin, la cantinière en chef du canal de Panama, — l'autre, une dame élégante de Caracas, ravissant type de la beauté andalouse, par la douceur de sa résignation.
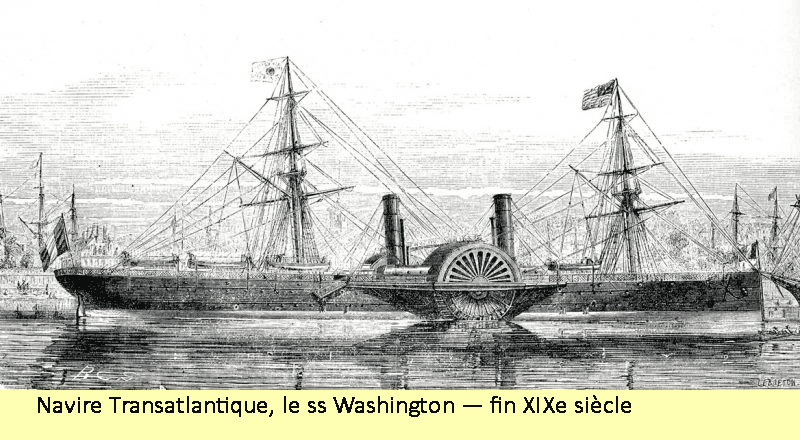
À plusieurs reprises je me rendis sur le théâtre de l'incendie; mais l'eau, qui coulait à flots dans les corridors, m'en chassait aussitôt; je craignais de me mouiller les pieds et de prendre un rhume!
Et pourtant personne n'était plus que moi convaincu que l'on touchait au moment suprême; à tel point qu'en retournant à l'avant-pont je me demandais toujours si j'aurais encore le temps de rejoindre les sœurs de charité agenouillées près du beaupré (1).
Un silence solennel régnait dans cette partie du bateau. On n'entendait que le bruissement des vagues, les sanglots étouffés d'une jeune femme enlaçant son nourrisson de ses bras, les pleurs d'une toute jeune fille qui appelait sa mère laissée dans quelque hameau au fond de la Bretagne, et les voix sonores des trois sœurs de charité qui, depuis trois heures de l'après-midi jusqu'à dix heures de la nuit, toujours à genoux, ne cessaient de prier. Ces saintes filles ne trahissaient aucune peur et offraient, dans ces circonstances terribles, le spectacle édifiant de l'héroïsme chrétien, du mépris de la vie et du parfait oubli de soi-même. Après avoir invoqué le secours du ciel pour échapper au danger, elles lui demandaient, lorsque tout espoir s'était évanoui, la grâce d'une mort chrétienne.
Mais il était écrit dans les étoiles que cette pauvre France, toute meurtrie et abîmée qu'elle était, ne devait pas périr.
À sept heures, on avait refoulé l'incendie vers son foyer; à neuf heures, on pouvait se flatter d'en être maître ; à onze heures, les dernières flammes, léchant les bords de la coque, répandaient des lueurs violacées à travers l'obscurité d'une nuit tropicale. Toute matière combustible était consumée, et, faute d'aliments, le feu finit par s'éteindre.
Un tiers du bâtiment ayant disparu, sauf la carcasse de fer, tout le monde s'entassait sur l'avant et près de la machine. De la viande froide et du vin de matelots, celui des voyageurs étant perdus, furent distribués, et l'administration fit ce qu'elle put pour subvenir aux besoins du moment.
Voyageurs, soldats, équipage étaient exténués de fatigue ou brisés par les émotions des dernières huit heures.
Personne ne témoignait sa satisfaction d'être échappé à un si grand péril, parce que personne ne se croyait hors de danger. La soute à poudre est-elle vraiment noyée? C'est la question qu'on se posait, et cette préoccupation, comme on verra bientôt, n'était pas une chimère.
En attendant, le bâtiment ne gouvernait plus, et l'on restait en cape pendant la nuit.
Le lendemain, le commandant fit, tant bien que mal, raccommoder la barre, et à midi on se mit en route vers la Martinique.
Quoiqu'elle eût à traîner son arrière rempli d'eau et presque submergé, ce qui fit que nous étions campés sur un plan légèrement incliné, cette excellente France filait ses 12 nœuds.
Heureusement un temps superbe la favorisait. Son arrière étant complètement déponté, elle n'aurait pu résister à un fort coup de vent.
Pendant ces quatre jours de navigation il n'y eut pas de désordre à bord : mais il y eut de mauvais symptômes : des bruits sinistres répandus on ne savait par qui, de fausses alarmes, de petits vols commis dans les cabines, des fouilles tentées dans les décombres. Il fallait l'attitude énergique du commandant et la présence imposante des quarante soldats d'infanterie de marine pour contenir les moins respectables de mes compagnons de voyage.
Beaucoup de passagers, je suis du nombre, n'ont sauvé que les vêtements qu'ils portaient. Par une faveur ou par une ironie du hasard, de tous mes effets brûlés dans et avec ma cabine, on n'a rien trouvé, excepté mon ordre de Léopold d'Autriche. Le cordon était presque complètement détruit, la croix ne montrait aucune trace du feu, la plaque était noircie et en partie fondue. C'est le cas de dire : « J'ai tout perdu, hormis l'honneur ».
La belle dame de Caracas a vu se convertir en cendres un grand nombre de caisses remplies de chefs-d'œuvre du grand Worth, et je dois lui rendre la justice qu'elle a subi cette cruelle épreuve presque avec la même grandeur d'âme qu'elle avait déployée en présence de la mort.
La conduite du commandant Collier était au-dessus de tout éloge.
À ce sujet, il n'y avait qu'une voix. On admirait sa présence d'esprit, son sang-froid et son habileté de manœuvre. J'ajouterai que j'admire aussi la justesse de son jugement. Et voici pourquoi.
Dans son opinion, pour parler le langage du médecin, à cinq heures, le malade était condamné.
Si, à ce moment, il avait donné l'ordre de mettre les chaloupes à la mer, tout le monde s'y serait précipité, une lutte à mort se serait engagée entre ces quatre cents agonisants, les travaux de sauvetage se seraient arrêtés instantanément, l'incendie, peut-être après des scènes épouvantables, le désespoir et le rhum aidant, car les mauvais éléments ne manquaient pas à bord, aurait fait sa dernière conquête, et la France aurait sauté.
Évidemment notre brave commandant se disait tout cela, et, d'après la maxime contra spem spero, il faisait continuer les travaux et ne donnait pas un ordre qui les aurait fait cesser.
Sans doute, les quatre canots montés par quelques matelots et une douzaine de voyageurs tout au plus, munis de vivres et d'eau, poussés par les courants et les vents alizés, pouvaient, pourvu qu'il n'y eût pas de mauvais temps, atteindre la Barbade ou la Guadeloupe dans l'espace de douze à quinze jours. Mais ces mêmes chaloupes, surchargées de monde, allaient au-devant d'une perte certaine. Et d'ailleurs, comme cela a été dit, elles n'auraient pu contenir le tiers des passagers et de l'équipage.
À tout point de vue, M. Collier a été bien inspiré.
Qu'il me soit permis de citer ici deux faits qui, autant que je sache, n'ont été racontés par aucun journal et dont je puis garantir l'authenticité.
Trois ou quatre jours après l'arrivée de notre paquebot à Fort-de-France, en remuant les décombres on vit jaillir des flammes, malgré la grande quantité d'eau qui s'y trouvait encore ! Le transport de la poudre, du bâtiment au fort, s'effectua plus tard avec toutes les précautions imaginables. Cette opération permit de constater l'état de la soute. La cloison étanche qui en formait une des parois, rougie pendant l'incendie par les flammes, avait échauffé celles des caisses de métal qui la touchaient, et plusieurs d'entre elles se trouvaient tordues et en partie ouvertes.
Le pont en bois qui couvrait la soute était en différents endroits complètement, dans d'autres jusqu'à mi-épaisseur, calciné par le feu. Le hasard, ou le sort, ou la Providence a voulu que l'eau des pompes tombât sur les caisses ouvertes et que les charbons ardents tombassent sur les caisses fermées !
Je suis arrivé à la fin de mon récit.
Le 24 décembre, précisément quatre fois vingt-quatre heures après que l'incendie se fut déclaré, la France, constamment favorisée par un temps superbe, après avoir doublé la pointe nord de la. Martinique et passé devant Saint-Pierre, mouilla à trois heures de l'après-midi à Fort-de-France, près de la jetée de la Compagnie Transatlantique.
Ce fut alors, et alors seulement que nous pouvions nous dire sauvés.
Je ne saurais mieux résumer mes impressions qu'en empruntant à M. l'amiral Vignes, commandant la station des Antilles, dont j'ai eu la malchance de ne pouvoir faire la connaissance, un mot qu'il a dit après avoir visité le paquebot et constaté l'état lamentable auquel cette terrible aventure l'avait réduit : « Le sauvetage, s'est-il écrié, tient du prodige! Il fait honneur à la marine française. »
(1). Les journaux ont publié des fragments de lettre du commandant Collier à sa femme. On y lit : « Je viens d'échapper au plus effroyable des dangers que j'aie courus de ma vie.... De 3 h. 15 jusqu'à 9 heures du soir, je me suis attendu à sauter.... Il est réellement inouï que nous n'ayons pas été entièrement détruits. »
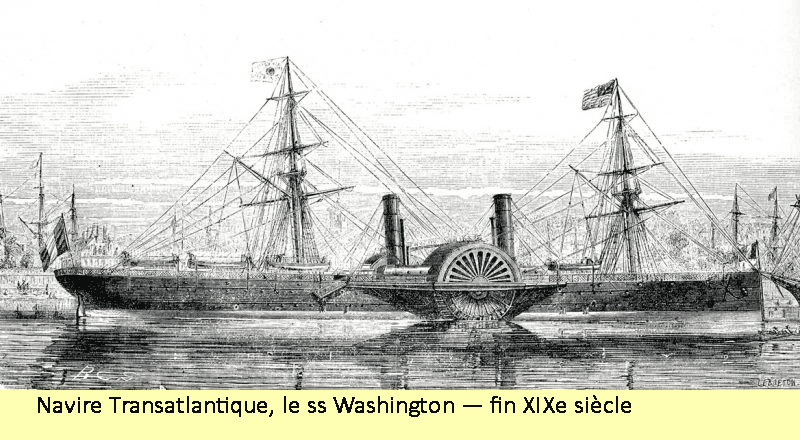
(Baron de Hübner, Incendie du paquebot la "France".)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
Le remontée du Meinam
(13 JUILLET 1893)
LE 13 juillet, à quatre heures et demie du soir, l'Inconstant, commandé par le capitaine de frégate Bory, et la Comète, commandée par le lieutenant de vaisseau Dartige de Fournet, arrivent devant la barre du Meinam, où le Pallas, croiseur anglais, commandé par le capitaine de vaisseau Mac Lied, et un navire siamois à roues se trouvaient au mouillage en dehors de la barre, ainsi que le J.-B. Say, petit navire des Messageries fluviales de Cochinchine, faisant le service entre Saigon et Bangkok et qui attendait la marée pour entrer.
Pendant que l'Inconstant envoyait sa vedette sonder sur la barre avec l'enseigne de vaisseau Houard, un officier, M. de la Pallet, se rendait à bord de ce navire pour informer le commandant Bory que M. Pavie, le ministre de France au Siam, et deux officiers du Lutin, canonnière française mouillée devant Bangkok, descendaient la rivière et qu'il était inutile de franchir la barre.
Le capitaine de port siamois, d'origine européenne, vint presque en même temps faire une communication identique. Mais, sur le refus de ce fonctionnaire de lui indiquer l'heure de la pleine mer sur la barre, le commandant Bory le congédia.
Peu après, une grande chaloupe à vapeur amena à bord de l'Inconstant un enseigne de- vaisseau du Lutin, porteur d'une dépêche de l'amiral Humann, prescrivant au commandant Bory, d'après les instructions reçues de Paris, après son départ de Saigon, de franchir la barre et d'aller mouiller à Packnam, ainsi que le traité de 1856 nous en donnait le droit.
À la vérité, il avait été expédié de Paris, ultérieurement et d'après les assurances pacifiques présentées par la légation du Siam, une autre dépêche donnant avis à nos deux canonnières de rester provisoirement en dehors de la barre.
Mais les irrégularités et les interruptions apportées par les Siamois à la transmission de nos dépêches à M. Pavie n'avaient pas permis à ce dernier télégramme de lui parvenir en temps utile.
C'est ainsi que la responsabilité des événements du 13 juillet appartient tout entière au gouvernement de Siam.
Confiant dans son droit, le commandant Bory se disposa à exécuter les ordres qu'il venait de recevoir, sans vouloir croire que les Siamois tenteraient de s'opposer par la force à son passage. À l'heure du plein, c'est-à-dire vers six heures un quart, il mit en marche à 10 nœuds, et, suivi de la Comète, fit route vers la barre.
Le J.-B. Say les avait précédés.
À six heures et demie, heure du court crépuscule tropical, comme les trois navires s'approchaient de la première bouée de la barre, le fort de la pointe Ouest ouvrit brusquement le feu sur nos canonnières sans autre avertissement.
Après avoir essuyé deux feux de file de 7 pièces de 21 centimètres qui composent l'armement de ce fort, le commandant Bory, qui s'était mis rapidement en branle-bas de combat et avait hissé un pavillon en tête de chaque mât, fit commencer à riposter à cette inqualifiable agression.
Aux projectiles du fort, qui passèrent tous au-dessus ou sur l'arrière de nos bâtiments, il fut répondu par des obus à mitraille, destinés à démonter les servants.
(Cliquer sur la gravure ci-dessus et lire le texte intégral ... )
 [ici]
[ici] [et regarder dns votre dossier "téléchargements"]
La grande distance — 4000 mètres environ — le peu de visibilité du fort très peu élevé et le rapide déclin du jour ne permettaient pas un tir plus effectif. On a su depuis que la garnison du fort siamois avait été assez éprouvée.
Une victime aussi inattendue que malheureuse des Siamois fut le J.-B. Say, auquel un projectile ouvrit une voie d'eau qui l'obligea à aller s'échouer. Ce petit bâtiment, désemparé, vit défiler à côté de lui l'Inconstant et la Comète, qui continuaient leur route.
Au tournant de la bouée, nos deux canonnières purent reconnaître aux dernières lueurs du feu la nature des obstacles qu'ils allaient avoir à affronter.
À la hauteur du bateau-feu situé au dedans de la barre, un barrage avait été constitué, formé par des jonques, de forts pieux et deux navires en fer coulés, le tout réuni par des chaînes.
Le passage laissé libre, de 80 mètres environ, était garni de torpilles dont le poste d'inflammation se trouvait sur un bateau à roues abrité au dedans du barrage. De plus, en amont, la flotte siamoise se trouvait rangée des deux bords du fleuve.
Pour franchir ce redoutable barrage, le commandant Bory estima à juste titre qu'il fallait passer le plus près possible du bateau-feu, ce qu'il fit en le laissant à quelques mètres sur sa gauche, tandis qu'une torpille fixe faisait explosion à une certaine distance sur sa droite.
La Comète, qui suivait à 300 mètres, passa avec le même bonheur.
Nos navires eurent alors affaire avec la flotte siamoise, qui les accueillit au passage par un feu nourri d'artillerie et de mousqueterie. Tous les navires avaient reçu des troupes ; on en avait même massé sur des chalands amarrés le long des berges et derrière des murs crénelés sur les rives ; cette mousqueterie était armée de fusils Mannlicher de 8 millimètres, du modèle le plus récent.
Les péripéties de ce petit combat naval furent très courtes.
Le courant s'ajoutant à la vitesse de nos canonnières leur faisait rapidement dépasser, à sept heures, les bâtiments siamois, dont, grâce à l'obscurité naissante, le tir fut loin d'être aussi meurtrier qu'on eût pu s'y attendre.
À bord de l'Inconstant, un obus de 16 centimètres, éclatant sur un bossoir de la vedette, tua le maître charpentier Gueguen et blessa le gabier Le Gall ; le fourrier Palhun et le matelot de pont Jean-Jacques furent également atteints par des éclats d'obus ou de métal.
À bord de la Comète, on eut à déplorer la perte de deux canonniers, Allonge et Jaouen, tués raides à leur pièce, de balles dans la tête.
Quant aux dommages matériels éprouvés, ils se sont bornés à des avaries sans gravité dans le gréement, les embarcations et l'accastillage.
Pendant ce court engagement, l'Inconstant donna en passant un coup d'éperon au Nirben par tribord derrière ; l'équipage siamois se précipita affolé vers l'avant, salué du feu de notre mousqueterie, tandis qu'un obus éclatant au milieu du navire l'obligeait à aller s'échouer de suite pour éviter de sombrer.
La Coronation et le Rajar-Kuhmar, atteints par nos projectiles et menaçant de couler, ont également dû s'échouer. Le Thoon-Khranon, navire-école dont étaient parties les salves de mousqueterie qui tuèrent les deux canonniers de la Comète, reçut aussi un obus en plein bois.
Dans ces conditions, le commandant Bory n'hésita pas à remonter jusqu'à Bangkok, au lieu de mouiller sous le feu des canons des forts de Paknam.
À sept heures et demie, l'Inconstant et la Comète passaient à 500 mètres de l'îlot Paknam et essuyaient pendant cinq minutes le feu des forts, mais sans souffrir.
Les deux navires ont riposté par un feu de file d'obus à la mélinite qui, bien que très difficile à diriger, vu leur vitesse et la nuit, qui s'était faite très sombre et sans lune, a, paraît-il, produit des dégâts dans les constructions des forts de l'Est.
Depuis Paknam jusqu'à Bangkok, l'Inconstant et la Comète n'ont plus été inquiétés que par quelques coups de fusil isolés, tirés des rives, et, à neuf heures et demie, ils mouillèrent auprès du Lutin, devant la légation de France.
La vedette de l'Inconstant, que l'action engagée sur la barre avait fait laisser sur rade, regagnait intrépidement son navire à minuit.
En résumé, c'est incontestablement à l'audace dont nos bâtiments ont fait preuve, aux pertes qu'ils ont infligées à l'ennemi et au découragement qu'ils ont semé parmi les conseillers du roi, qu'il faut attribuer le dénouement rapide d'une situation qui menaçait de s'éterniser.
Amiral HUMANN.
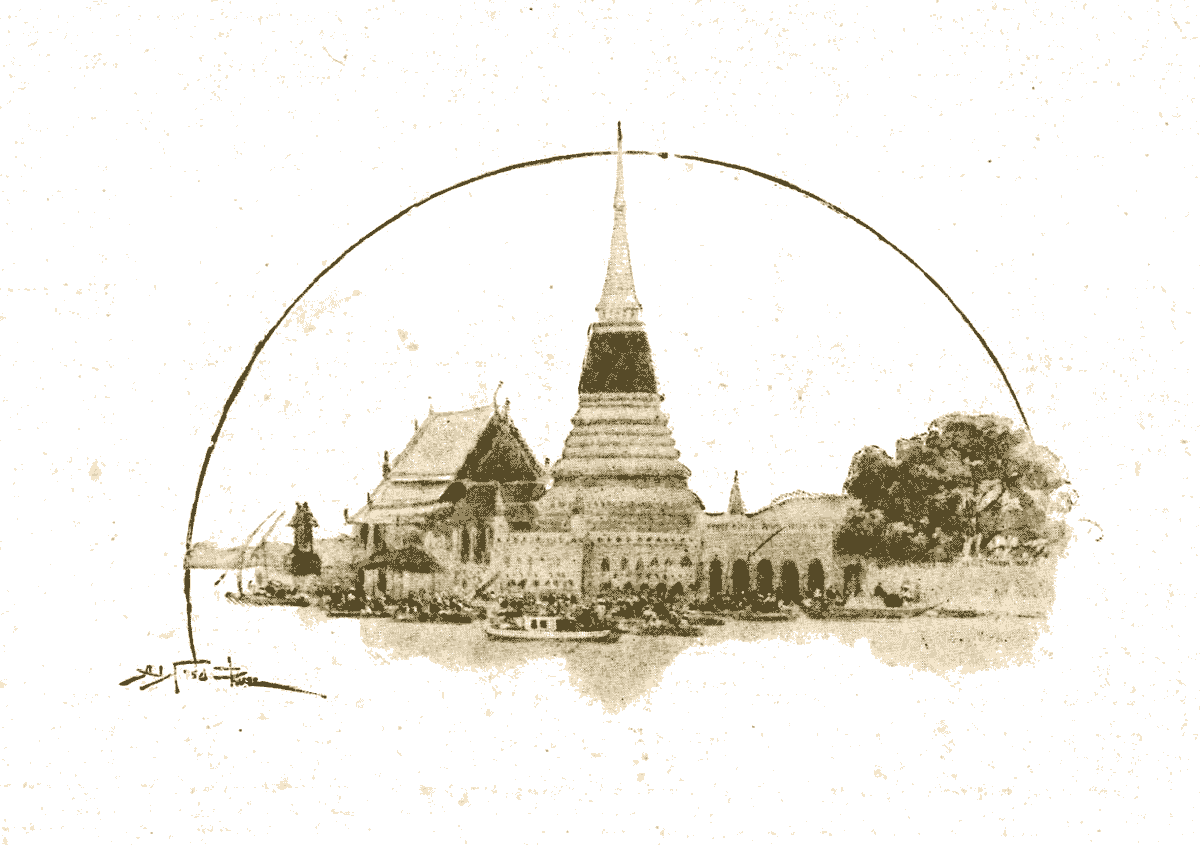
cliquer sur le texte [ci-dessus] -